 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire
 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire

Essais > Biographie
L ' A V I O N , P O U T I N E , L ' A M É R I Q U E . . . E T M O I
Marc Dugain - 2024
Albin Michel - 347 pages
17/20
Un écrivain qui dérange russes et américains
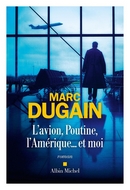 Ce livre relate le parcours de son auteur Marc Dugain. Quelle est la part de réalité ? Quelle est la part de fiction ? Je ne saurai évidemment le dire, seul l'écrivain en a la connaissance intime et se doit de cultiver à sa guise son jardin secret. Néanmoins, pour les lecteurs qui le connaissent un peu à travers ses précédentes fictions et qui s'intéressent à son parcours depuis plusieurs années, on y retrouve de nombreux détails autobiographiques intéressants qui tissent une vie faite de drames, de réussites et de questionnements.
Ce livre relate le parcours de son auteur Marc Dugain. Quelle est la part de réalité ? Quelle est la part de fiction ? Je ne saurai évidemment le dire, seul l'écrivain en a la connaissance intime et se doit de cultiver à sa guise son jardin secret. Néanmoins, pour les lecteurs qui le connaissent un peu à travers ses précédentes fictions et qui s'intéressent à son parcours depuis plusieurs années, on y retrouve de nombreux détails autobiographiques intéressants qui tissent une vie faite de drames, de réussites et de questionnements.
Trader sur les marchés financiers américains, cet homme doué en maths s'est fait rapidement et facilement beaucoup d'argent. Il ne cache pas avoir profité d'un système juteux, mais très vite il a su qu'il arrêterait pour vivre comme il l'entendait, loin du monde artificiel, hypocrite et faux qui est celui du milieu bancaire et boursier.
Son destin a été d'autant plus bouleversé sur le plan humain que sa femme est tombée malade. Une maladie mentale qui a conduit à un drame et qui a été une terrible épreuve à surmonter pour l'écrivain et ses deux enfants. Des États-Unis, il est alors revenu vivre en France au bord du lac Léman.
Son expertise professionnelle dans le milieu des affaires l'a conduit à traiter des marchés financiers entre différents continents et à se créer un solide réseau de relations dans différents pays dont la Russie. Dès que de fortes sommes d'argent circulent au niveau international dans un monde polarisé, les protagonistes deviennent, outre de simples financiers, des sources de renseignement non négligeables. Tel un Largo Winch ou un James Bond, image caricaturale certes, Marc Dugain s'est progressivement retrouvé dans un milieu où les écoutes téléphoniques, les filatures, les rendez-vous au coin d'une sombre ruelle et les menaces à peine voilées sont légion. Rajoutons à cela sa relation dans des hôtels de luxe avec la sublime et mystérieuse femme d'affaires Julia et l'image du golden boy est parfaite !
Au-delà de cette première vie, l'écrivain raconte sa passion pour l'écriture et la rédaction en quinze jours à peine d'un récit produit avant tout pour lui mais qui va devenir un énorme succès en 1998 : La chambre des officiers.
Son thème de prédilection est ainsi annoncé : écrire sur la collision entre des destins individuels et la grande Histoire. À cela s'ajoute son intérêt pour les mensonges d'État qui le mèneront à se rendre lui-même jusqu'à Mourmansk pour enquêter sur la tragédie du Koursk.
L'histoire américaine de la seconde moitié du XXe siècle le passionne aussi et il écrit sur Hoover, le FBI et les Kennedy. Certains iront jusqu'à voir en lui en véritable espion... Il faut dire que son père, physicien nucléaire, a été lié au monde du renseignement durant la guerre froide et que son oncle maternel officiait dans les services secrets britanniques. James Bond n'est finalement pas si loin !
La dernière partie de cette "fiction autobiographique" traite de la disparition mystérieuse du vol MH370 de la Malaysia Airlines survenue en 2014. Marc Dugain a lui-même dirigé une compagnie aérienne, il connaît le sujet et a de nombreux contacts dans le milieu aéronautique. À la lumière de ses convictions et des faits établis, il émet ainsi des hypothèses plausibles sans tomber dans le complotisme.
Voilà quelques années que je n'avais pas lu de titre de cet auteur. J'ai retrouvé avec plaisir son style limpide et élégant. Le rythme est également soigné et garde le lecteur en appétit de la première à la dernière page. Dans son œuvre, un titre m'a particulièrement marqué et d'ailleurs lui aussi l'aime par-dessus tout d'après ce qu'il m'avait dit un jour aux Étonnants Voyageurs de Saint-Malo : il s'agit du roman Avenue des géants qui raconte l'histoire d'un tueur dans l'Amérique des années 60. À lire pour ceux qui voudraient découvrir son univers...
[Critique publiée le 10/11/25]

O R L É A N S
Yann Moix - 2019
Grasset - 262 pages
19/20
Roman d'humiliation
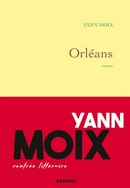 Divisé en deux parties, « Dedans » et « Dehors », Orléans raconte le quotidien humiliant subi par Yann Moix entre la maternelle et la classe de Mathématiques Spéciales. Il avait déjà évoqué et dénoncé la violence qu'il a endurée, jeune, auprès de ses parents dans de précédentes œuvres comme Panthéon, Rompre ou le phénoménal Naissance. Ici, il signe le premier volume d'une tétralogie intitulée « Au pays de l'enfance immobile » où il a décidé de raconter sans filtre l'enfer. L'enfer de la maison où les coups pleuvent et l'enfer de l'école où il est ignoré. Comme le rappelle l'auteur en quatrième de couverture, il a écrit un roman d'humiliation comme il existe des romans d'initiation.
Divisé en deux parties, « Dedans » et « Dehors », Orléans raconte le quotidien humiliant subi par Yann Moix entre la maternelle et la classe de Mathématiques Spéciales. Il avait déjà évoqué et dénoncé la violence qu'il a endurée, jeune, auprès de ses parents dans de précédentes œuvres comme Panthéon, Rompre ou le phénoménal Naissance. Ici, il signe le premier volume d'une tétralogie intitulée « Au pays de l'enfance immobile » où il a décidé de raconter sans filtre l'enfer. L'enfer de la maison où les coups pleuvent et l'enfer de l'école où il est ignoré. Comme le rappelle l'auteur en quatrième de couverture, il a écrit un roman d'humiliation comme il existe des romans d'initiation.
Né en 1968, le futur écrivain a grandi à Orléans. Et cette période clé de la vie a été terriblement malheureuse pour le petit garçon qu'il était.
Le livre permet de comprendre bien des choses sur le personnage qu'il est aujourd'hui devenu, si décrié par certains, si adulé par d'autres, car il se met à nu dans ce texte sincère et très soigné sur le plan littéraire.
Certains passages laissent sans voix et sont révoltants. Comment peut-on faire autant de mal à un être sans défense, comment peut-on écraser à ce point son fils ? La violence faite aux enfants est malheureusement commune et c'est parfois dans les familles les plus lisses en apparence qu'elle se déchaîne avec le plus de force.
L'épigraphe qui ouvre le récit annonce la couleur en reprenant les mots du grand Victor Hugo dans L'homme qui rit : « Ce qui est fait contre un enfant est fait contre Dieu. »
Le livre, à sa sortie, a évidemment fait du bruit. L'affaire est sortie du cadre purement littéraire lorsque le père de Yann Moix, José Moix, a contrebalancé les accusations portées contre lui et sa femme, que le frère est allé dans le sens du père tandis que la grand-mère prenait la défense de l'écrivain.
L'une des questions que chaque lecteur d'Orléans se posera inévitablement est la véracité du propos. Tout est-il exact, un peu déformé ou carrément inventé ? Qui ment dans l'affaire, le père ou le fils ? Chacun gardera ses secrets et jamais la réponse ne sera définitive. Mais à mon avis se tient là un faux débat. Outre le fait qu'à titre personnel je pense Yann Moix vraiment sincère et honnête, la question de la part de fiction - en supposant qu'il y en ait une - dans la biographie ne doit pas nuire à l'appréciation de ce beau texte. Peu importe finalement car cette histoire serait purement inventée qu'elle n'en serait pas moins tragique et intense. Mais encore une fois, la réalité peut dépasser la fiction et les lignes écrites ici en témoignent selon moi.
Rédiger la chronique d'un livre de Moix n'est jamais simple. Il y a tant de choses à dire sur le plan et sur la forme. Plutôt que de paraphraser, je suis bien souvent obligé de citer de nombreux extraits qui se suffisent à eux-mêmes. Car c'est lire Yann Moix qu'il faut faire pour se délecter du nectar du fruit qu'il nous offre et se débarrasser des scories de toutes ces rumeurs et autres scandales qui donnent une image biaisée du bonhomme.
Alors, allons-y, laissons le Maître parler à travers quelques extraits...
Au sujet de sa mère, digne de Folcoche, il rapporte : « La méchanceté foisonnait en elle. "Jamais tu n'aurais dû naître. Jamais ! Tu comprends, petit enculé ? Est-ce que tu comprends, dis ?" »
Quant à son père, le tableau est encore pire. Réveillant son géniteur à cause de ses cauchemars nocturnes, le petit Yann alors en CE1 est envoyé en pleine nuit dans la forêt. Voici la suite : « Je tombai dans un fossé rempli de ronces, d'orties et de gadoue pétrifiée. Je perdis un chausson et une épine me transperça la plante du pied. Le moteur rugit, puis je vis la voiture disparaître dans l'horizon noir. »
Le cauchemar est quotidien, la maison devient un lieu de souffrance absolue.
Alors en sixième, il se souvient : « La grande spécialité de mon père était d'utiliser, pour me frapper, une rallonge électrique. Telle était sa trouvaille. Il s'en allait la chercher dans le petit placard maudit où elle dormait, la faisait virevolter dans les airs à la façon d'un lasso, et m'immolait de toutes ses forces - parfois, l'embout, formé d'une prise électrique dotée de deux tubulures métalliques, venait me fracasser les os. »
En cinquième, parce qu'il sent le tabac en rentrant à la maison après y avoir goûté avec quelques copains, sa mère lui demande de s'agenouiller dans le salon les mains sur la tête. Le criminel est alors puni par le père en restant enfermé dans la cave durant un week-end entier avec pour seul repas un paquet de Gauloises : « Pendant tout un week-end, je dus uriner dans un saut de plage que je vidais dans l'évier ; dégoûté à l'avance par le partage de ma cellule avec mes propres excréments, je me retins de déféquer jusqu'au retour de mes géniteurs, le dimanche au soir. Je n'avais pas la plus petite miette à manger ; quand la faim me déchirait le ventre, je buvais comme un fou, jusqu'à ce que l'eau fût en moi semblable, par son poids, à la sensation d'un bifteck. »
À l'école aussi, les heures sont pénibles. Les tables de multiplication demeurent un mauvais souvenir de CE2. L'enfant, seul face à tous ses échecs, doit composer avec ce monde et se fait à l'idée qu'il n'arrivera jamais à rien : « L'échec, l'erreur, la nullité, l'imposture, le ratage, c'était moi - j'avais trouvé ma place au milieu des foules humaines. »
Les copains sont absents et les encouragements de l'ordre de l'illusion : « Jamais je n'eus le moindre camarade ; jamais, non plus, le moindre représentant de l'Éducation nationale ne m'avait prodigué, ni ne me prodiguerait, le plus petit encouragement, le plus infime compliment. »
L'image du raté qui finit apprenti lui est renvoyée. Mais voici comment il rend honneur aux métiers manuels qui aujourd'hui encore sont volontiers dénigrés : « Il ne fût venu à l'idée de personne, au sein de la cellule familiale, que l'artisan, en contact perpétuel avec les choses, connecté à leur matière, à leur acier, à leur bois, exerçât la plus haute activité de l'homme. Tous, comparés à celui qui usine, qui découpe, qui produit des copeaux, qui fait jaillir des étincelles, nous sommes des barbares, des prétentieux et des aveugles. Je rêvais d'être boucher. »
Pour survivre, et le mot est juste, Yann Moix se raccroche à des mondes intérieurs, des amis de papier. Il décide de consacrer sa vie à la bande dessinée car il adore le graphisme et possède de réels dons. Mais il trouve son véritable refuge dans la littérature et se met à dévorer les écrits d'André Gide durant son année de CM1 ! Il raconte : « Je pris la décision irrémédiable de me quitter moi-même, d'abandonner mes vêtements, et jusqu'à mon corps, jusqu'à mon existence, pour ne plus me coucher et ne me lever que dans les livres. À table, dans la voiture, au lit, dans le salon, chez les gens : tremblant, chancelant, absorbé par les romans que partout j'emporterais. »
Chaque classe fait l'objet d'un chapitre et Moix de continuer à égrener les humiliations parentales qu'il subit encore au collège puis au lycée...
Son père, totalement fou, balance par la fenêtre les livres et les dessins de son fils. En véritable rescapé de cet autodafé - le paternel ira jusqu'à utiliser le feu - le « grantécrivain » comme dirait Dominique Noguez savoure aujourd'hui non sans émotion et avec humilité le privilège simple de pouvoir aligner les livres chez lui sans attirer une quelconque foudre : « Devant moi, écrivant ces misérables lignes, je peux contempler, avec l'enivrante liberté de pouvoir les ouvrir à tout moment, les œuvres à peu près complètes de Jean-Paul Sartre, rescapées des années, des pères, des pneus imbéciles. »
Ses passions le sauvent : « Celui qui n'est point passionné est un homme mort. »
Insatiable, il découvre les textes de Péguy - « il est resté pour moi le plus grand » - puis de Gide, Céline et Proust. À propos de son maître absolu, il écrit : « Solide comme un bronze, fragile comme un enfant, Péguy ressemble à l'idée que je me fais de moi : injuste, irascible, caractériel, mais attachant, touchant - enfantin. » Voilà exactement la personnalité de Moix décrite en quelques mots. Il est en effet caractériel, tête à claques pour certains, mais il est sensible, passionné et fragile également. Tout ce qu'il a écrit le prouve. Écrire c'est se mettre à nu. Un écrivain ne triche pas. Contrairement aux plateaux de télévision, où il s'amuse à être agaçant pour le plaisir de l'audimat, ses livres révèlent sa vraie nature avec beaucoup d'acuité. D'autant plus qu'ils posent les idées de façon précise, claire, construite et argumentée. Quant à la langue, peu d'écrivains contemporains arrivent à son niveau...
Son panthéon personnel s'enrichit encore avec l'astrophysique et le jazz. Il aime observer le ciel et, victime de la pollution lumineuse, dénonce ce qu'il appelle un sacrilège. Pour apprendre à reconnaître les étoiles, il n'a pas le choix, il va devoir se plonger dans les mathématiques et s'accrocher car cela ne constitue pas sa matière favorite : « Je me répétais que, sans le support des équations, des fonctions et des espaces vectoriels, je ne saurais jamais me repérer parmi les galaxies. Fred Hoyle, Richard Feynman, Jean-Claude Pecker, Evry Schatzman avaient, en leur temps, été des cadors en mathématiques ; il me faudrait par conséquent en passer par là. »
Le jazz éveille d'autres sens. Évidemment, pour son père, ce style musical n'est que « beuglement de jeune veau, hurlement de coyote ou couinement de cochon en passe d'être égorgé ». Le jeune Moix voit au contraire une subtile délicatesse dans les compositions du pianiste Bill Evans qu'il adule. Il écrit magnifiquement les choses à ce sujet : « Evans paraissait si fragile, si éphémère, si bancal et vacillant, qu'une rayure sur mon 33 tours eût certainement pu le tuer. »
Après le lycée, il entame des études scientifiques. Son père veut la voie royale pour son fils. Il enchaîne donc les classes de Mathématiques Supérieures et Mathématiques Spéciales jusqu'à saturer et faire une dépression nerveuse. Le simple fait d'en parler à la maison conduit son géniteur à lui fracasser la tête contre la baie vitrée du salon et à lui mettre un coup de pied dans les côtes... La violence gratuite et brute, tant physique que morale est à son paroxysme.
Cet événement marque un tournant, le dépassement d'un point de non-retour. Le jeune homme renverse alors tout ce qu'il peut dans la maison, perdant toute peur d'exprimer sa colère même s'il doit mourir sous les coups de ses parents : « Mon père sentit que ç'avait été la fois de trop. J'étais prêt à mourir, cette fois, pour défendre mon intégrité. Les coups, les mathématiques : c'était terminé pour moi ; j'en avais trop ingéré. Je saturais. »
C'est précisément là que le lecteur va à nouveau comprendre, avec plus de lucidité que jamais, les raisons qui expliquent le comportement de cet homme qui aurait pu devenir totalement fou : « Il m'apparut que l'humanité se montrait trop étroite, trop sérieuse, trop grave ; qu'il fallait, dans l'existence que je décidai de commencer sur-le-champ et qui serait la mienne si je me donnais le droit, le courage et la liberté de la vivre, ne jamais subir les règles des autres. [...] Plus jamais on ne me forcerait à trafiquer ma nature, à la faire ployer, jusqu'à s'humilier, pour qu'elle se configure selon le goût, la morale ou l'intérêt d'autrui. [...] Nul, jamais, ne pourrait plus m'infliger ce que je refusais de tout mon être. Quiconque m'éloignerait de mes penchants, de mes impulsions intimes, de ma personnalité profonde, représenterait désormais un ennemi que je n'aurais aucun scrupule à éliminer. Ma patience était dépassée ; je naissais avec vingt ans de retard. »
Les livres ont certainement sauvé l'enfant et l'adolescent de l'enfer. Moix est devenu dingue de littérature et lui rend finalement un bel hommage dans ce récit bouleversant. Lire et écrire sont depuis des années ses passions absolues.
Toujours, il a tissé sa voie en se confrontant à plus de difficultés. La découverte de la philosophie et, à travers elle, la compréhension de textes arides et de concepts complexes lui ont arraché des larmes d'émotion et de satisfaction. Pour fuir la triste réalité il s'est mis à aller de l'avant, tel un alpiniste fasciné par l'Himalaya, et a gravi seul les difficiles échelons qui lui permettent aujourd'hui d'écrire des textes chaque fois fascinants.
« Je possédais, en livre de poche, l'Ulysse de Joyce dont la difficulté, doublée d'une typographie de mouche, me ravissait. Je rêvais de laisser derrière moi, dans la nuit des siècles, un parpaing littéraire incandescent, savant, opaque, impénétrable, à la limite de la lisibilité, qui forcerait le respect des humains jusqu'à la mort de l'univers. Il était hors de question de produire plusieurs tomes, façon Zola, Romains, Proust, mais de construire un monument unique et surépais, saisissable avec une seule main. Il s'agissait d'inventer un monde burlesque. » Pour les connaisseurs, ce « parpaing » à venir est certainement le prodigieux Naissance publié en 2013 et mettant en scène un personnage totalement farfelu et inoubliable par son caractère burlesque prénommé Marc-Astolphe Oh.
Orléans entame l'autobiographie d'un écrivain qui sort des cases, qui surprend sans cesse en n'hésitant pas à clamer son amour pour la philosophie et les bandes dessinées Spirou, à considérer Michel Polnareff comme un Dieu tout en écrivant à côté de longues pages sur le compositeur Conlon Nancarrow que seuls quelques férus de musique classique connaissent, à juxtaposer dans une même phrase le théorème de Thalès et les « seins dodus et frais » d'une certaine Sylvaine dont il tombe éperdument amoureux en cinquième. À mêler le populaire et le savant, à focaliser autant sur le général que le détail, à réconcilier au-delà des chapelles qui divisent et découpent injustement la culture.
Le récit permet de comprendre le personnage, ses états d'âme, ses coups de colère, ses provocations qui ne s'arrêteront pas, ses positions tranchées, ... Moix n'a pas fini de faire parler de lui et, malgré une œuvre déjà prolifique, ne semble être qu'au début de sa production littéraire. En mai 2021, il a ainsi annoncé vouloir sortir une série de 40 romans sur les dix prochaines années. Définitivement excessif comme les personnages de ses histoires et génial !
[Critique publiée le 20/06/21]

R E I M S
Yann Moix - 2021
Grasset - 285 pages
17/20
Misère et décadence morales d'une bande d'étudiants
 Après son échec aux concours d'entrée des grandes écoles scientifiques, Yann Moix parvient à intégrer l'École Supérieure de Commerce de Reims.
Après son échec aux concours d'entrée des grandes écoles scientifiques, Yann Moix parvient à intégrer l'École Supérieure de Commerce de Reims.
Dès le début, il a le sentiment de croupir dans un lieu où d'inutiles matières sont enseignées. Déjà la ville elle-même ne l'enchante guère : « Reims était une boîte de conserve dans laquelle nous étions emprisonnés. »
Naturellement, il lie connaissance avec une bande de paumés : « J'avais toujours aimé la compagnie des cancres, des ravagés, des excessifs, des démantibulés, des cas sociaux, des déchets, des inadaptés - des infréquentables. »
Il y a parmi eux Caillette qui se punit d'exister en faisant des pompes et collectionne ses ongles, Garabédian qui écrit des poèmes pour séduire et cacher son bégaiement ou encore Gillon qui se lève à dix-neuf heures pour boire ou se droguer.
Tous broient du noir, pleurent de ne rencontrer aucune fille et pensent régulièrement au suicide. « J'étais pénétré de mort » écrit ainsi l'auteur. Même leur tentative de se reprendre en main à travers un défi stimulant se termine par une terrible tragédie : lors d'un saut en parachute organisé entre copains, Martinoff s'écrase laissant ses amis dans le plus grand désarroi.
Les filles sont là pourtant, vibrantes de légèreté, leur faisant miroiter un avenir radieux même si elles demeurent désespérément inaccessibles... C'est par exemple le cas d'Irena Domack, étudiante en seconde année : « Une immense angoisse s'empara de moi : il était scandaleux que cette fille ne m'appartînt pas, que je ne découvrisse pas le monde à ses côtés. Je repris goût à la vie grâce à elle sans qu'elle se doutât de quoi que ce fût. »
Sur le plan intellectuel, les compères veulent s'inspirer de lycéens, dont Roger Gilbert-Lecomte maintes fois cité, qui avaient créé en 1927 à Reims un groupe de réflexion et une revue tous deux appelés Le Grand Jeu. Mais leur objectif ne les mène nulle part. Aucune matière concrète ne sort, aucun livre n'est écrit malgré les tentatives de Moix qui rêve d'apporter un premier manuscrit à Bernard-Henri Lévy ou Philippe Sollers.
Il échoue tellement à réussir quelque chose qu'il décide d'être haï pour exister : « J'avais gagné mes galons de psychopathe. Je m'étais inoculé, par l'obscénité, grâce à l'abjection, l'illusion d'être "quelqu'un". »
Il relate ainsi ce fameux épisode de jeunesse rendu public en 2019 avec une grosse polémique à la clé pour l'intéressé : son voyage en train à travers l'Europe de l'est avec son copain Pichon d'extrême-droite afin de visiter des lieux aux noms tragiques comme Dachau ou Berchtesgaden (lieu de villégiature de Hitler). Puis cette triste revue Ushoahia se moquant ouvertement de la Shoah, de l'abbé Pierre ou encore des myopathes... Comme il l'avait expliqué sur les plateaux de télévision et à nouveau ici dans Reims, c'était une façon de se détruire, de se suicider socialement.
Dans cette sombre ambiance, dans ce cloaque permanent et putride réside tout de même une lueur en provenance des grands textes : « Je me réfugiai comme toujours dans les livres. » Passionné de littérature et philosophie, le futur écrivain dévore ceux qui deviendront ses maîtres : Francis Ponge, Georges Bataille, Franz Kafka, Martin Heidegger ou encore Michel Foucault.
Et malgré la morbidité ambiante du récit, Yann Moix se pose en digne héritier des grandes plumes françaises avec toujours cette qualité d'écriture, cette richesse du vocabulaire et cette finesse du style inégalables !
[Critique publiée le 01/01/24]

V E R D U N
Yann Moix - 2022
Grasset - 254 pages
16/20
La période militaire
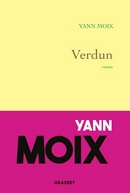 Tout commence à Angers. Yann Moix a vingt-quatre ans et intègre, dans cette « ville plate, floconneuse », le peloton préparatoire à l'école des officiers de réserve.
Tout commence à Angers. Yann Moix a vingt-quatre ans et intègre, dans cette « ville plate, floconneuse », le peloton préparatoire à l'école des officiers de réserve.
Après des études à Reims sans saveur ni réel objectif qui lui ont confirmé une fois de plus que tout ce qu'il entreprenait dans la vie était voué à l'échec, il est lucide dès le début de cette nouvelle période d'un an : « L'armée elle-même m'apparut comme un ratage : nous faisions la guerre pour de faux. »
Les premiers instants, boule à zéro de rigueur et rassemblement sous un préau froid, annoncent la couleur : « J'eus envie de pleurer. »
Rapidement, il rejoint son école d'application sise à Draguignan dans le Var. Formé dans l'artillerie, il se demande comment il va survivre à cette période et supporter les ordres des supérieurs, leurs brimades quotidiennes, les visages tristes de ses compagnons : « J'allais vivre un an avec d'autres, mélangé à leur sueur, à leurs bruits, à leurs odeurs, à courir et souffrir. »
Cette comédie tragique se tient au cœur d'une caserne, un monde à part, un microcosme militaire où les dimanches sont pires que partout ailleurs semble-t-il : « C'était un dimanche comme je les haïssais : écrasé de soleil, de silence, un dimanche lourd de mort, sans mémoire ni horizon. » Et plus loin, de rajouter sans ambages : « Aucune porte, ni pour sortir d'ici, ni pour sortir de moi. J'étais foutu. »
Les journées, parfois cocasses, parfois déprimantes, se succèdent. Les longues marches de trente kilomètres dans la boue avec un encombrant paquetage sur le dos, un casque lourd sur la tête et le Famas en bandoulière sont entrecoupées par de faux combats déclenchés par des grenades à plâtre ou par des insultes et humiliations qu'il faut encaisser sans broncher. Moix se voit affublé du sobriquet "Couille-de-loup" par le capitaine Wittkovski.
Dans ces moments, il se réfugie dans ses pensées : « [...] je rêvais à Paris, aux queues devant les cinémas, aux Tuileries, à des couples faisant l'amour dans des chambres de bonne ; à la pluie grise sur le zinc, aux Champs-Elysées, aux hauteurs de Montmartre, à l'église Saint-Sulpice - ses Delacroix. Je pensai au Louvre, au Couronnement de la Vierge de Fra Angelico. »
Lorsqu'il intègre le 3ème RAMa (Régiment d'Artillerie de Marine) à Verdun, une ville qu'il décrit comme « un amas de rectangles entrelacés », il est chargé de la formation des nouvelles recrues. Il ne se trouve donc plus tout en bas de la chaîne de commandement et a de l'ascendant à son tour.
Mais dans cet univers où le champ lexical se limite aux termes de sergent, caporal, lieutenant, aspirant, bigor, capitaine, chef de section ou colonel, la littérature et la culture plus généralement demeurent le seul point de fuite : « Je crois n'avoir jamais supporté la réalité, préférant celle, tout aussi légitime, des romans, des bandes dessinées, des films, des œuvres musicales et des tableaux. »
Il en profite d'ailleurs pour citer et relire des auteurs liés à la guerre comme Maurice Genevoix, Charles Péguy mort sur le champ de bataille en 1914 ou encore Franz Kafka qui publia La métamorphose en 1912.
Féru de livres denses, tels ceux de Proust ou Joyce, il rêve d'œuvrer plus tard dans la littérature et d'écouler sa « triste mélancolie par jaillissements permanents, dans une œuvre sans bornes et fourre-tout » à travers laquelle il pourra exprimer ses obsessions et sa folie du langage.
En attendant, bloqué dans cette année faite de boue, de ronces et de dortoirs sommaires, il s'escrime à écrire des lettres enflammées à des créatures qui lui répondent de façon laconique ou l'ignorent simplement. Même Youki, une jolie blonde fascinée par sa tenue militaire, profite de son invitation au restaurant et en boite de nuit puis l'abandonne au cours de la soirée pour se réfugier dans les bras musclés d'un parachutiste. Une fois de plus grand perdant à cette loterie de l'amour dont seules les filles désignent les gagnants, il s'imagine finir dans la solitude totale, enfermé à lire Voltaire et Corneille...
Yann Moix nous livre le troisième roman d'humiliation de sa tétralogie intitulée « Au pays de l'enfance immobile ».
Celui qui est souvent décrié pour son assurance et son égocentrisme sur les plateaux télévisés montre ici un tout autre visage. C'est celui de l'écrivain qui se met à nu et se livre sans le filtre de la mise en scène que le monde audiovisuel prend un malin plaisir à exploiter pour des histoires de rentabilité commerciale bien souvent.
Écrire permet de prendre du recul, de réfléchir, de construire avec précision un argumentaire, d'organiser calmement une pensée. Ces qualités sont toujours présentes dans les livres de Yann Moix tant son écriture est limpide. À travers ce texte, il se révèle une fois de plus être un personnage fragile, subissant les brimades et les défaites, se questionnant sur le sens de sa vie. Tel est le lot de beaucoup d'humiliés et Verdun a ce mérite d'y accorder de l'importance, de partager des états d'âme pouvant aider à se sentir moins seul et enfin de dénoncer l'absurdité du monde comme toujours chez Moix.
[Critique publiée le 29/03/24]

P A R I S
Yann Moix - 2022
Grasset - 255 pages
19/20
L'écriture du premier roman !
 Après son service militaire à Verdun, Yann Moix arrive à Paris sans le sou. Son objectif, dans cette ville qu'il trouve sale, laide, pleine de détritus et « néfaste à l'équilibre nerveux », est de cesser d'être lui pour devenir quelqu'un. Ses premières nuits ont lieu dans le centre Beaubourg, entouré de livres « formant un bouquet d'étoiles » grâce au gardien qui lui accorde un peu de bonté.
Après son service militaire à Verdun, Yann Moix arrive à Paris sans le sou. Son objectif, dans cette ville qu'il trouve sale, laide, pleine de détritus et « néfaste à l'équilibre nerveux », est de cesser d'être lui pour devenir quelqu'un. Ses premières nuits ont lieu dans le centre Beaubourg, entouré de livres « formant un bouquet d'étoiles » grâce au gardien qui lui accorde un peu de bonté.
Lors d'une soirée alcoolisée dans un bar glauque, il fait la connaissance d'un ancien malfrat qui lui trouve une solution de dépannage : un appartement sordide au cœur du dixième arrondissement de la capitale.
Son rêve est d'écrire en s'inspirant de ses auteurs fétiches qu'il a lus et relus comme Péguy, Giono, Tolstoï, Gombrowicz ou Kafka. C'est décidé, son premier roman sera sur le thème de l'amour fou que voue un homme à une femme. Jubilations vers le ciel n'est qu'une ébauche mais existe déjà dans le cœur de l'apprenti écrivain...
À côté de son rêve demeure cependant la réalité. Celle économique qui nécessite de travailler à Norwich Union pour survivre et celle sociale qui se résume à des amours fantasmés et des copains désemparés ou totalement excentriques.
À ce sujet, il retrouve d'ailleurs deux anciennes connaissances : Caillette et Garabédian.
Le premier s'apprête à entrer dans l'administration mais demeure totalement névrosé comme l'illustre l'épisode durant lequel il se livre à Yann Moix qui lui est redevable d'une malheureuse dette de trente francs : « Rien ne m'atteint, rien ne me concerne, le monde entier est obstrué par cette tache qui me paraît gélatineuse et moche, géante, visqueuse : la somme que tu me dois. Mes trente francs. Je n'en dors plus. Ce n'est pas le montant de cette somme qui me hante, ce n'est pas sa valeur numérique qui m'empêche de vivre : c'est le principe même que tu me la doives. » Il avoue d'ailleurs penser au suicide à cause de cela !
Le second ne voit pas en quoi il mérite de vivre, s'est réfugié dans la lecture des œuvres de Baudelaire et consulte quatre psys simultanément. À l'un d'entre eux, il laisse des menaces de mort sur le répondeur lorsqu'il tente de le joindre sans succès : « Je l'appelle quand je suis en détresse, il ne décroche pas. Ça me rend fou. Hier, j'ai voulu le joindre pour lui demander qui j'étais. Il n'a pas décroché. D'accord, il était deux heures du matin. »
Enfin, côté amour, c'est le désert total : « Aborder une fille m'était un Everest. » Alors qu'il doit subir le bruit de ses voisins forniquant derrière la cloison, le jeune Yann se désespère de cette vie monacale qui l'attend désormais à Paris : « J'allais passer ma vie à lire Proust et Suarès au lieu que de me frotter au ventre des femmes. Reims allait recommencer à Paris, en plus grand, en plus désolant. »
Il fait quelques rencontres tout de même mais sans succès. Avec Majoly par exemple, rencontrée dans une boîte de nuit, qui s'avère finalement être une prostituée lui réclamant son dû et dont les frères ne sont pas très commodes ou avec Wanda qu'il invite au restaurant avant de s'enfuir lorsqu'il voit la jeune fille s'enfiler un côte de bœuf avec de la mayonnaise de façon peu reluisante...
Puis arrive Delphin Drach, ce type qu'il croise par hasard dans un fast food de la gare du Nord et qui est en repérage pour sa société de production.
Laid mais ayant une confiance démesurée en lui, Delphin ne jure que par les filles ; et contrairement à Yann, il parvient à séduire n'importe quelle femme et s'est même constitué une sorte de harem. Roi de la manipulation, entrant aux Bains aussi facilement qu'un David Bowie d'après lui, il s'avoue encore plus décomplexé lorsque la fille à séduire est très belle : « Avec une moche - que Dieu me garde de sortir avec une moche ! - je serais peut-être gêné. Tandis qu'avec une déesse, je me sens comme une carpe du château de Fontainebleau dans son bassin. »
Le prince de la drague décide d'éduquer son élève à l'art de la séduction. Même s'il le trouve moche, il lui accorde cependant un fort potentiel. Afin de l'aider à aborder des filles, il lui conseille de mieux se chausser, de se tenir droit, de jeter à la poubelle sa vieille eau de Cologne et d'arrêter de parler de sujets intellectuels : « Ce que voudra Marion, dont les seins sont gorgés de bon lait frais et parsemés de roux confettis, ce n'est pas que tu lui apportes un éclairage sur le doigté de B.B. King ou la carrière diplomatique de Saint-John Perse, mais que tu plantes ta tête dans son string et que tu lui mordilles l'entrecuisse jusqu'à ce que sa petite tête de linotte se dévisse. »
Le ton est donné.
Delphin se demande quelle enfance le jeune Yann s'est coltinée pour en arriver désormais à s'excuser d'exister. Il ne comprend pas non plus cette volonté de persister dans le monde littéraire. Pour lui qui connaît bien Jean-Edern Hallier, voir en soi un génie ne peut pas fonctionner : « Tu as vu le résultat ? » A la rigueur, l'écriture peut être une voie à condition de n'avoir pour objectif que l'argent à la manière de Sulitzer : « Tu devrais t'inspirer de ce gros lard. »
Delphin "prête" même des filles de sa "collection" à Yann pour l'aider et lui passe un savon lorsqu'il n'arrive à rien à part évoquer Joyce ou Péguy devant la mine éberluée d'une superbe créature à sa disposition... « Tu pues l'alexandrin. [...] Lâche le stylo. Lâche la plume ! C'est par le mandrin, par le mandrin seul, qu'on pénètre le cœur des femmes. Tu n'accèdes pas au Graal en récitant du Saint-Pol-Roux. Réveille-toi ! »
Il livre aussi quelques-uns de ses secrets expliquant ses réussites permanentes auprès des femmes. Ainsi, pour les séduire, ce Don Juan invétéré plonge ses demoiselles dans le monde de l'enfance en leur faisant écouter la musique de Mary Poppins, offre du mauvais vin qu'il fait passer pour un grand cru et utilise un vibromasseur conçu par des ingénieurs du CNES !
Il lui intime tout de même, à côté du sujet féminin, de hanter les cocktails des maisons d'édition : « Montre qui tu es. C'est d'autant plus facile que tu n'es rien. Quand on n'est rien, on peut tout être. »
Tandis que Drach qui se dit vicieux et fou - « chaque seconde de ce bas monde qui s'écoule en dehors d'une femme me semble scandaleux. Chaque minute passée sans baiser semble me rapprocher dix fois plus de la mort » - poursuit sa quête des plus belles demoiselles, Yann Moix noircit les feuilles seul dans son appartement miteux et finit par écrire un premier texte « dans une société désertée par les lecteurs ».
Il prend la peine de relier son roman qui lui fait « l'effet tantôt d'un chef-d'œuvre, tantôt d'une mouche à merde » et de se rendre apeuré devant les maisons les plus prestigieuses que sont Grasset et Gallimard. Ce sera l'une ou l'autre, ce sera Bernard-Henri Lévy ou Philippe Sollers. La suite, on la connaît : c'est Grasset qui éditera en 1996 Jubilations vers le ciel dont François Busnel dira que c'est « l'un des plus grands premiers romans du vingtième siècle ».
Voici le tome de clôture de cette tétralogie racontant un parcours d'humiliation depuis les premières années dans le berceau familial jusqu'à la montée à la capitale.
Qu'en aurait-il été si le jeune Yann avait été élevé dans un univers de sécurité affective, si ses parents l'avaient aimé comme cela devrait toujours être le cas ? Son parcours aurait certainement été tout autre.
Les livres lui ont indéniablement sauvé la vie et lui ont donné cette rage d'exister et de recoller les morceaux qu'il pouvait : « Tous les malheurs qui m'avaient frappé jusque-là avaient déterminé ma vocation, m'insufflant une volonté particulière et la sensation, riche de jouissance, que sur la feuille je devenais un titan. »
Paris annonce ainsi la sortie du tunnel et cela est notamment renforcé par l'apparition d'un personnage plus léger, plus fantasque que dans les opus précédents à travers le fameux Justin Drach.
On retrouve avec ce phénomène les saillies géniales de Moix et ses qualités incroyables d'auteur burlesque. Personnellement, j'adore lorsqu'il met en scène des types aussi fous, excessifs et drôles ! Pour ceux qui ont adoré Bernard Frédéric dans Podium ou encore Marc-Astolphe Oh dans Naissance, ils retrouveront le même caractère déjanté chez ce Justin Drach.
À côté de cette partie de grande rigolade, l'écriture de Yann Moix est aussi profonde et puissante comme toujours. Il parvient à exprimer simplement des sensations que nous ressentons tous et qui sont particulièrement vertigineuses comme ce sentiment d'enfermement dans notre existence qu'il avait déjà abordé dans de précédents livres : « Chacun, sur les trottoirs, dans le métro, le bus, la queue, les magasins, les bureaux, s'imaginait être différent de tous les autres, eux-mêmes persuadés d'être parfaitement uniques, les personnages principaux de l'aventure humaine. Tous autant qu'ils étaient se voyaient au premier plan, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, les anonymes ne servant que de vaste décor à leur séjour sur la Terre. »
On retrouve aussi ce rapport très particulier au temps que cet écrivain aime étirer et dilater comme il l'a si bien fait dans Anissa Corto pour ne citer qu'un autre exemple. Peu d'auteurs s'amusent avec cette notion à mes yeux car, en règle générale, c'est davantage l'espace et la géographie qui permettent spontanément de voyager ou d'explorer.
Moix parvient, lui, à s'introduire, à s'immiscer dans une année précise ou même dans une poignée de secondes bien déterminées pour y vivre une éternité de bonheur.
Voici ci-après un extrait jouant avec le temps et l'attente délicieuse d'une femme lors d'un rendez-vous galant : « J'avais adoré la demi-heure de retard qu'elle eut ; cela m'avait permis d'être ni tout à fait seul avec moi-même, puisque la perspective de la voir servait d'imminence joyeuse à mon existence, ni tout à fait en sa compagnie - compagnie que je redoutais une fois établie, consacrée, réalisée. Tant que Valérie Darule n'était point arrivée, je me trouvais en sa présence ; or, la présence m'a toujours mieux convenu que la compagnie. La présence est une compagnie d'où l'autre est absent. »
En parlant du retard de l'être attendue : « La suspension de temps qu'il offre, tandis que nous commandons un autre café, est un don du ciel - il fait de nous un solitaire sans nous éprouver en homme seul. »
Et finalement, quand la rencontre se concrétise : « Elle arriva enfin, brisant sa présence et m'imposant sa compagnie. »
Devant la mine dépitée de Yann, Valérie lui demande s'il va bien et s'il est content de la voir. Il lui répond alors cette phrase si déroutante et grandiose à la fois : « Tu m'empêches de te rêver... [...] Je t'apprécie tellement que lorsque tu es là, tu ne remplis pas autant l'instant que lorsque tu n'y es pas. »
Évidemment, l'écriture extrêmement soignée fait honneur à la langue française et se revêt d'une parure poétique jusque dans les dernières lignes lorsqu'il parle de la nuit « dont le noir est moucheté de diamants poussiéreux, de micas concassés, scintillants ».
[Critique publiée le 29/06/24]

L ' Â M E S E U L E
Hervé Vilard - 2006
Fayard - 385 pages
11/20
La mode des biographies continue...
 À travers l'évocation de sa jeunesse, le chanteur Hervé Vilard nous conte son errance dans les méandres de l'Assistance Publique.
À travers l'évocation de sa jeunesse, le chanteur Hervé Vilard nous conte son errance dans les méandres de l'Assistance Publique.
Placé dans une famille paysanne ou dans un milieu bourgeois, il sera finalement et miraculeusement recueilli par Daniel Cordier qui sera son mentor et lui ouvrira les portes d'une carrière dans le show-biz. Son histoire rocambolesque nous dévoile son intimité, ses frasques et ses succès. Sa passion pour Dalida, sa rencontre autour d'un saucisson avec La Callas, sa fréquentation de Malraux sont autant d'anecdotes sympathiques à lire.
Sa vision presque surnaturelle de Jacques Brel sur scène reste un beau souvenir : « A l'Olympia, j'ai vu un dieu moitié démon, cracher et se battre à mains nues [...]. Au pied du micro, sa transpiration forme une flaque traversée par son ombre. Il vide ses poumons dans l'humanité. Je n'en ai pas dormi de la nuit. »

L A D E R N I È R E F E M M E
Jean-Paul Enthoven - 2006
Grasset - 221 pages
17/20
Une écriture belle comme de la dentelle
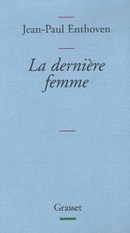 « Ce qui me plaît, c'est quand on met le moins de mots possible entre la rencontre et ce qui doit suivre. »
« Ce qui me plaît, c'est quand on met le moins de mots possible entre la rencontre et ce qui doit suivre. »
C'est le genre de phrases qui ponctuent ce livre. Chacune a, dirait-on, été ciselée dans de la dentelle. Enthoven manie avec dextérité notre langue.
Il s'amuse, pour mieux comprendre nos contemporaines, à brosser le portrait de huit femmes célèbres et disparues depuis bien longtemps déjà. On plonge ainsi dans les vies étonnantes et souvent dépravées de Zelda Fitzgerald, Françoise Sagan ou encore Nancy Cunard. L'auteur sait observer les travers de l'âme humaine et se tord également l'esprit en tant qu'homme si proche et si loin à la fois de la sensibilité féminine. Il nous fait regretter de ne pas avoir connu l'actrice Françoise Dorléac et jalouse terriblement ses amants : « Ils avaient, ils ont, le prestige des héros qui, ayant su se faire aimer ou désirer par une créature céleste, ont connu des plaisirs inaccessibles aux humaines ordinaires. »
À la fin de ces évocations, le lecteur termine l'ouvrage par une femme bien présente : l'italienne Flaminia. Enthoven se plaît à cultiver le mystère autour de cette sublime créature.
Il parvient à nous faire imaginer une rencontre plus que sensuelle uniquement à travers de fines suggestions. S'imaginant entre l'amant et le mari de cette femme, il écrit : « On est troisième larron comme Louis Jourdan était french lover dans les vieux films américains. »

Dernière mise à jour :
[ - Site internet personnel de chroniques littéraires. Mise à jour régulière au gré des nouvelles lectures ]

Copyright MAKIBOOK - Toute reproduction interdite
contact [at] makibook.fr


