 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire
 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire

Romans > Histoire
L ' I N C R O Y A B L E H I S T O I R E D E W H E E L E R B U R D E N
Selden Edwards - 2008
Le Cherche Midi - 647 pages
19/20
Un roman magistral sur un rythme endiablé
 Nous sommes en 1988. Wheeler Burden vit à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. Gloire du rock dans les années 70, il s'est depuis retiré du show-biz et vient de consacrer de longues années de travail à la rédaction d'un essai sur la ville de Vienne à l'aube du XXe siècle.
Nous sommes en 1988. Wheeler Burden vit à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. Gloire du rock dans les années 70, il s'est depuis retiré du show-biz et vient de consacrer de longues années de travail à la rédaction d'un essai sur la ville de Vienne à l'aube du XXe siècle.
Agressé alors qu'il rentrait tranquillement à son domicile, un phénomène extraordinaire survient : Burden se retrouve subitement propulsé dans la capitale de l'Empire austro-hongrois en 1897 !
Désemparé et démuni devant cette situation inconcevable, l'américain commence par voler les habits d'un citoyen de la ville afin de se fondre rapidement dans l'époque. Heureusement, sa connaissance approfondie de Vienne à cette période historique lui permet de trouver rapidement des repères. En effet, sa mémoire est intacte et il a en tête toutes les informations de son livre qui est en réalité une mise au propre des nombreuses notes d'Esterhazy, son professeur d'histoire durant ses études à Boston, qui a longuement vécu à Vienne.
Malgré la terrible perturbation occasionnée par ce voyage temporel, Wheeler a un énorme avantage sur ses concitoyens : il connaît tous les événements qui vont survenir entre 1897 et 1988. Il a conscience que l'Europe est au bord du gouffre, qu'une crise économique majeure va se déclencher, que deux guerres mondiales vont ravager une partie de l'humanité et que l'atroce extermination des juifs va être ordonnée par Hitler, encore gamin en 1897 !
Cette prise de conscience vertigineuse provoque en lui d'interminables questions métaphysiques sur la neutralité qu'il doit conserver par rapport aux événements majeurs qui se préparent ou l'action qu'il doit mener pour éviter le cataclysme.
Afin d'obtenir la meilleure des aides, il décide d'aller consulter celui qui deviendra mondialement célèbre quelques années plus tard : un médecin encore inconnu qui loge au 19 Berggasse et qui se nomme Sigmund Freud. Ce dernier se passionne vite pour ce patient hors du commun, intelligent et extrêmement clairvoyant sur de nombreux sujets.
Wheeler rejoint également la Jung Wien qui est un mouvement d'artistes et d'intellectuels d'avant-garde à Vienne. Au cœur de cette communauté, il croise des personnalités passionnées par la politique et l'avenir de leur pays et de ses voisins.
Il rencontre aussi Weezie Putnam, une jeune américaine venue écrire des articles sur la musique de Mahler, dont il tombe très vite amoureux.
À partir de là, Selden Edwards, l'auteur qui a écrit ce roman sur une période de trente années, s'amuse à relier un tas d'événements, à se faire croiser entre passé et futur de nombreux personnages dans un subtil découpage du récit qui offre au lecteur des chapitres jamais avares de révélations incroyables. Wheeler Burden est en effet loin de se douter de l'identité de certains individus qu'il croise à Vienne et de la situation plus que complexe dans laquelle il s'est fourré.
Emporté dans le rythme haletant d'une valse temporelle infinie, le lecteur suit tout cela d'un œil gourmand, lâchant de moins en moins le livre et se délectant de chaque instant passé en sa compagnie.
J'ai vibré avec le héros de ce récit, j'ai aimé avec lui, j'ai réfléchi à ses côtés, j'ai enrichi mes connaissances sur la période charnière située entre les XIXe et XXe siècle en Europe centrale, j'ai appris sur la naissance de la psychanalyse, sur la construction des cathédrales, sur la mythologie, ... J'y ai même aperçu un jeune garçon prénommé Adolf dans un petit village de la campagne autrichienne...
Il est difficile de commenter davantage cette histoire sans la dépouiller de ses trouvailles ni y détruire la magie qui attend son futur lecteur.
L'incroyable histoire de Wheeler Burden est un roman érudit et incroyable. Son originalité est rafraîchissante dans un univers où beaucoup de livres se ressemblent et confinent au déjà vu. De plus, la narration est fluide et l'auteur veille à ne jamais perdre son lecteur dans le dédale incroyable de rebondissements qu'il distille au fil des pages. Chaque chapitre apporte quasiment un revirement de situation, une tension qui appelle à connaître la suite.
Quelques efforts de mémoire et de concentration pour recouper les informations sont parfois nécessaires bien évidemment mais le jeu en vaut la chandelle car l'évasion qu'offre ce pavé est unique.
Sur le plan de la forme, le talent littéraire de l'auteur est également à signaler ainsi que le soin apporté à la traduction française.
Bref, un sacré bouquin à tout point de vue et qui fait partie des rares livres que je relirai pour rêver à nouveau et en saisir toutes les subtilités !
[Critique publiée le 13/01/15]

S E U L D A N S B E R L I N
Hans Fallada - 1947
Gallimard - 556 pages
18/20
Deux héros unis face à Hitler
 Dans un immeuble de la rue Jablonski à Berlin vivent quelques personnages ordinaires dans ce début des années 40 durant lesquelles le IIIe Reich cherche à étendre son empire à l'est comme à l'ouest : Frau Rosenthal, vieille femme juive dont le mari a été déporté, les Persicke, famille dont les fils s'épanouissent dans les Jeunesses hitlériennes, les Quangel, paisibles ouvriers sans histoires, ou encore Fromm, magistrat à la retraite.
Dans un immeuble de la rue Jablonski à Berlin vivent quelques personnages ordinaires dans ce début des années 40 durant lesquelles le IIIe Reich cherche à étendre son empire à l'est comme à l'ouest : Frau Rosenthal, vieille femme juive dont le mari a été déporté, les Persicke, famille dont les fils s'épanouissent dans les Jeunesses hitlériennes, les Quangel, paisibles ouvriers sans histoires, ou encore Fromm, magistrat à la retraite.
Suite à l'annonce de la mort de leur fils au front, Otto et Anna Quangel décident de ne plus cautionner la folie hitlérienne et d'agir. Laminé par la disparition de leur enfant parti défendre des idéaux peu reluisants, le couple se lance dans l'écriture et la distribution secrètes de cartes comportant des messages anonymes dénonçant le régime au pouvoir.
Terrorisés à l'idée de se faire démasquer, l'homme et la femme vont longuement réfléchir à la meilleure stratégie à adopter pour la confection de ces messages et leur distribution. En effet, la tâche est rude dans ce climat nauséeux où chacun épie son voisin et n'hésite pas à le dénoncer à la moindre incartade dans l'espoir de s'attirer les bienveillances du parti fasciste.
« Brûlant » les mains de ceux qui les ramassent, les messages subversifs ne circuleront pas suffisamment comme escompté initialement par leurs auteurs ; au contraire, ils seront la plupart du temps sagement remis aux autorités, lesquelles s'emploieront à trouver le ou les coupables dans cette affaire dite du « trouble-fête ».
La résistance des Quangel va alors mobiliser le commissaire Escherich durant de nombreux mois. Lui aussi, à son niveau, subira les foudres de son supérieur hiérarchique pour incompétence dans la résolution de cette énigme berlinoise.
Cette histoire, trame principale du roman, relatant la descente aux enfers de simples habitants nous présente également une galerie de personnages ayant un lien plus ou moins direct avec Otto et Anna Quangel. L'auteur nous démontre à quel point chaque individu était épié sous le régime national-socialiste ainsi que la disparition totale de toute confiance unissant les allemands entre eux.
Le mot d'ordre demeurait la méfiance la plus totale, le repli sur soi inconditionnel car tout lien ou relation entre deux individus devenait suspect aux yeux de la Gestapo.
Ce livre, inspiré de faits réels, est étonnamment mature si l'on considère la période à laquelle il a été écrit.
Hans Fallada, de son vrai nom Rudolf Ditzen, termina sa rédaction en 1946 avant de mourir l'année suivante. Et malgré le manque total de recul et d'analyse sur cette période atroce de l'histoire, il évoque déjà les camps de concentration et la torture permanente dans les prisons allemandes.
L'auteur, qui souffrait de ses fortes dépendances à l'alcool et à la morphine, décrit également tous les rouages pernicieux qui sous-tendaient le régime politique nazi.
Quant à la ville de Berlin, il y fait ressentir avec brio la peur qui régnait à chaque coin de rue et le climat pesant des délations quotidiennes dans chaque quartier ou même chaque immeuble.
Enfin, ce récit rappelle aussi que l'écriture reste une arme accessible à tous, même aux gens simples comme les Quangel, dès lors qu'il s'agit d'entrer en résistance contre une dictature. Ainsi, Seul dans Berlin est un hommage à tous ces écrivains ou journalistes qui à travers leurs livres, journaux ou blogs aujourd'hui parviennent à mettre en difficulté des pouvoirs totalitaires. De Victor Hugo dénonçant la peine de mort dans ses romans jusqu'aux jeunes gens ayant utilisé les nouvelles technologies pour asseoir les révolutions arabes, l'écrit et l'art plus généralement demeurent des outils de liberté inégalables.
Seul dans Berlin a connu un énorme succès depuis sa parution.
La dernière partie, où l'amour et la mort deviennent les uniques leitmotivs narratifs, est bouleversante. Fallada nous fait toucher du doigt l'horreur absolue des cachots, prisons et maisons de la mort dans l'Allemagne nazie. Les images évoquées sont absolument effroyables et inoubliables.
Dans un subtil jeu d'équilibre, cette noirceur est contrebalancée avec talent par des images d'amour, de paix et de sérénité intenses.
La tension finit par monter crescendo pour nouer un drame digne d'une pièce de Shakespeare...
Un livre à lire et prescrire pour ne jamais oublier...
[Critique publiée le 06/03/14]

R O U G E B R É S I L
Jean-Christophe Rufin - 2001
Gallimard - 551 pages
19/20
Le souffle de l'aventure dans un roman exceptionnel
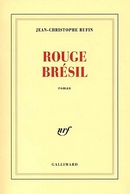 Le récit se déroule durant la période de la Renaissance et débute en 1555 précisément. À cette époque, le Portugal est le pays européen le plus en pointe dans l'exploration géographique par voie maritime. Son hégémonie est particulièrement visible en Amérique du sud où le Brésil compte déjà un grand nombre de comptoirs portugais.
Le récit se déroule durant la période de la Renaissance et débute en 1555 précisément. À cette époque, le Portugal est le pays européen le plus en pointe dans l'exploration géographique par voie maritime. Son hégémonie est particulièrement visible en Amérique du sud où le Brésil compte déjà un grand nombre de comptoirs portugais.
Face à cette position dominante dans le Nouveau Monde, la France, représentée par son roi Henri II, cherche à s'implanter aussi dans ce grand pays. Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de Malte et vice-amiral de Bretagne, est chargé de fonder au Brésil une nouvelle France qui se nommera « France Antarctique ».
Purement romanesque, la présence de deux enfants, Just et Colombe, enrichit le roman dès le début. Recrutés dans leur Normandie, ils sont nommés « truchements » et seront ainsi chargés d'apprendre la langue des indiens autochtones pour servir d'interprètes entre ceux-ci et les colonisateurs. C'est le vague espoir de revoir leur père, François de Clamorgan, disparu peut-être aux Amériques qui finit de les convaincre de prendre part à l'aventure.
Trois navires quittent ainsi le port normand du Havre-de-Grâce pour atteindre après une traversée éprouvante la baie de Guanabara de l'autre côté de l'Atlantique. Les portugais sont déjà implantés dans cette zone depuis une cinquantaine d'années. Pour l'anecdote, c'est durant un mois de janvier qu'ils ont découvert cette splendide baie ; croyant qu'elle constituait l'embouchure d'une rivière, ils l'ont injustement nommée « Rio de Janeiro ».
Six cents personnes dont une troupe de chevaliers armés en guerre débarquent alors sur l'île de Serigipe située dans la baie du Pain de Sucre, cette montagne imposante devenue si célèbre aujourd'hui.
Villegagnon, personnage haut en couleur et convaincu d'être investi d'une mission christique, s'attelle rapidement à assurer la sécurité de ses hommes en construisant une fortification, le Fort-Coligny. Découvrant que le père de Just et Colombe est un ancien chevalier de Malte ayant combattu à ses côtés en Italie, il prend l'éducation militaire et philosophique de Just sous sa responsabilité.
Malgré la relation fusionnelle qu'elle entretient avec son frère, Colombe est, quant à elle, chargée d'établir un contact solide avec les indiens. Elle s'enfonce ainsi dans les forêts luxuriantes de la baie de Guanabara et construit sa personnalité au contact d'un peuple respectueux représenté par Pay-Lo. Pour cet ancien docteur en philosophie européen tombé amoureux du mode de vie amérindien jusqu'à en devenir l'un des leurs, « il faut toute la prétention des Européens pour croire que ce continent attendait leur venue pour exister ».
Au sein de la colonie que tente d'établir Villegagnon dans la sueur et le dur labeur, les tensions s'exacerbent autour du manque d'alcool et de femmes que des contrebandiers basés sur la côte prennent plaisir à monnayer.
C'est dans ces moments de désenchantement que la fougue de Villegagnon prend toute son ampleur :
« - Regardez-les ! Ils s'enivrent. Ils forniquent. Ils vont à terre à tout propos et je sais bien pourquoi, corps-saint-Jacques ! Ces damnés truchements leur vendent des garces auxquelles ils ne savent résister. Et pendant ce temps-là, l'ouvrage ne se fait pas. Les pluies vont venir, rien n'est couvert. Rien n'est défendu. Que les Portugais nous attaquent et c'en est fini ! [...]
- La Femme, s'emporta Villegagnon en redressant le torse, est l'instrument de la Chute, le véhicule de la Tentation et du Mal. Pensez-y sans cesse et détournez-vous de la chair lorsqu'elle paraît sous les espèces de la licence et du contentement. [...]
- Plus j'y pense, déclara l'amiral, et plus je comprends que le sacrement principal, dans notre situation, est le mariage. C'est lui et lui seul qui sanctifiera ces unions et fera rentrer ces débordements dans l'ordre. Qu'ils prennent des femmes, qu'ils aillent chercher ces sauvagesses de force, qu'ils les paient, qu'ils les violent s'ils le veulent, mais que tout cela soit consommé devant Dieu ! »
Dans ce contexte tendu, le vice-amiral écrit à Calvin pour demander l'envoi de nouveaux convertis afin de remettre dans le droit chemin ses hommes. Et un an plus tard, un navire accoste avec à son bord des protestants dont quelques femmes, des pasteurs et du Pont, un ministre de Genève lui aussi avide de pouvoir dans cette nouvelle colonie.
Rapidement, de nouveaux débats autour des questions religieuses sont ouverts et, chacun choisissant son clan, une scission entre catholiques et protestants naît. Les huguenots quittent ainsi l'île et rejoignent la terre ferme.
Tout comme dans le royaume de France, la guerre des religions a lieu ici, à petite échelle, certes, mais avec beaucoup de hargne et de rancœur. L'auteur décrit ci-après cette tragédie qui paraît impossible car nichée au sein d'un décor idyllique : « Ainsi les beautés pâles du matin tropical, la mer d'émeraude et le ciel métallique sans nuages, recouvraient tant de terreurs et de haines qu'elles faisaient presque horreur, comme un fard grimaçant appliqué sur la peau d'un mourant par dérision. »
Pendant que Villegagnon, lui-même, doit rejoindre la France afin de plaider sa cause et obtenir de nouveaux renforts, Just est nommé gouverneur de la France Antarctique. De son côté, Colombe, devenue Œil-Soleil chez ses amis indiens joue un rôle de plus en plus important auprès du pacifique Pay-Lo. Le frère et la sœur, si proches durant leur enfance, symbolisent chacun à leur façon une position extrême dans l'appréhension du Nouveau Monde : Just devient l'ambassadeur de Villegagnon dans la conquête sanglante de Rio de Janeiro tandis que Colombe s'est totalement intégrée au mode de vie autochtone au contact permanent de la nature et a pris conscience de tous ses bienfaits fondamentaux.
À l'aune de ce choc entre Nouveau et Ancien Mondes, que deviendra cette relation d'amour ambigüe qui les a toujours animés ?
Voici à nouveau un extrait d'une scène magistrale pour laquelle il faut avoir lu le livre intégralement afin d'en saisir toute la teneur : « Colombe se leva et fit quelques pas sur la terrasse. Quand elle revint vers lui, Just la contempla toute entière, dans sa robe de velours. Elle était, à elle seule, toute l'Italie bleue, la source où puisaient ses artistes, une parente, par sa chevelure tressée, de ces beautés romaines dont le marbre seul parvient à rendre la frémissante splendeur. [...]
Il frôla son cou, son épaule, son bras nu. Immobile, elle ferma les yeux, plongée dans le délice de cet instant rêvé et unique, mystérieusement familier tant il avait été désiré et qui, si innombrablement qu'il se reproduise par la suite, n'aurait plus jamais le goût incomparable de cette première fois. [...]
Avant de plonger dans le plaisir, il regarda l'œil de Colombe et y vit l'image renversée du monde : un soleil dans lequel brillait un grand ciel bleu.
Et sans plus rien redouter, il s'y élança. »
Ce roman, publié en 2001, a obtenu le prix Goncourt la même année. C'est une récompense largement méritée tant le livre est riche de détails sur une partie méconnue de l'histoire française, tant l'auteur a su y insuffler un souffle romanesque. Jean-Christophe Rufin écrit dans une langue brillante, voltairienne, collant parfaitement à son propos. Pour autant, ce texte érudit est très facile d'accès, fluide, découpé en épisodes, ce qui confère une certaine nervosité dans le rythme de lecture. C'est là tout le talent du grand Alexandre Dumas dont Rufin revendique volontiers l'héritage.
Avec plus de 750 000 exemplaires vendus dans le monde, Rouge Brésil a rencontré une énorme notoriété suite à l'obtention de la plus haute distinction littéraire en France. Le Goncourt, décerné par un jury de professionnels a, comme un grand nombre d'autres prix, une propension à récompenser plutôt un éditeur qu'une œuvre suivant une guerre des chapelles qui anime depuis longtemps les différentes maisons d'édition. Cette fois-ci, le célèbre bandeau rouge qui a rehaussé la couverture sobre des éditions Gallimard est le bienvenu car il contribue toujours aujourd'hui à populariser un excellent roman riche de mille promesses entre aventure, exotisme, grande histoire, amour et complots.
Suite à une idée venue lors de la visite d'un petit musée à Rio de Janeiro dix ans auparavant, Jean-Christophe Rufin s'est appuyé, pour retranscrire cet épisode de la Renaissance lors de l'écriture de son livre, sur deux ouvrages témoignant directement de la grande expédition de Villegagnon : Voyage faict en la terre du Brésil publié en 1578 par le protestant Jean de Léry et Les singularitez de la France Antarctique, autrement nommée Amérique écrit en 1557 par André Thevet, cosmographe de Henri II.
[Critique publiée le 15/02/13]

L A P A R T D E L ' A U T R E
Éric-Emmanuel Schmitt - 2001
Le Livre de Poche - 503 pages
18/20
Un sujet casse-gueule traité avec brio
 D'emblée, c'est un chef-d'œuvre.
D'emblée, c'est un chef-d'œuvre.
Ce livre, à la dimension philosophique, se base sur une uchronie. Imaginez ce que serait devenu Hitler, et par la même le monde d'aujourd'hui, si celui-ci avait été reçu à l'Académie des beaux-arts en 1908.
Éric-Emmanuel Schmitt construit à partir de cette hypothèse deux Hitler. L'un, celui que l'on a malheureusement connu et l'autre, celui qu'il aurait pu être. Une biographie précise et détaillée entremêlée à une fiction totalement crédible.
On apprend dans ce pavé qui se lit d'une traite que le jeune Adolf était un être très correct, passionné par les arts et plutôt renfermé sur lui-même. Son échec aux beaux-arts est vécu comme une erreur et il reste persuadé qu'il est un génie incompris. À partir de là, il n'aura de cesse de se croire exceptionnel et de négliger sa socialisation parmi les hommes. La première guerre mondiale qui lui donnera une place dans la communauté humaine valorisera l'armée à ses yeux. La défaite de l'Allemagne exacerbera sa haine du juif, pour lui responsable de cet échec. Son putsch raté, la rédaction de son livre en prison, son élection à la tête de l'Allemagne feront de lui un homme qui va se conforter dans son idée de regrouper les peuples d'origine germanique dans la Grande Allemagne.
Et l'on connaît la suite... Les camps de concentration, la fin dans le bunker souterrain et le suicide près de sa femme Maria Von Braun.
L'autre Adolf est celui qui a su faire face à ses problèmes, celui qui a su, sans honte, accepter ses défauts et les soigner. Celui-là aura des enfants, deviendra peintre puis professeur et finira tranquillement en Californie, un goût amer dans la bouche car jamais vraiment reconnu sur le marché de la peinture...
Le livre est savamment orchestré, les deux parcours intelligemment décrits, et, sans doute le plus important aux yeux de l'auteur, cette œuvre donne à réfléchir sur le monstre qui sommeille au fond de chacun d'entre nous et sur les circonstances qui peuvent amener celui-ci à prendre le dessus et à conduire à la catastrophe.
À noter : le journal très intéressant en fin de livre qui relate les combats et sacrifices qu'a dû mener l'auteur.

L A T R A V E R S É E D E S T E M P S | PARADIS PERDUS (tome 1)
Éric-Emmanuel Schmitt - 2021
Albin Michel - 564 pages
18/20
Roman initiatique au Néolithique
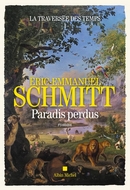 Il y a huit mille ans, à la suite d'un phénomène extraordinaire qui sera détaillé au cours du récit, Noam a gagné l'immortalité à l'âge de vingt-cinq ans.
Il y a huit mille ans, à la suite d'un phénomène extraordinaire qui sera détaillé au cours du récit, Noam a gagné l'immortalité à l'âge de vingt-cinq ans.
Ayant traversé les temps jusqu'à aujourd'hui, ce témoin de l'histoire de l'humanité est inquiet face aux nombreux défis qui se dressent et aux risques encourus par l'homme. Il décide alors de coucher par écrit sa longue existence qui a débuté au début du Néolithique près d'un lac...
À cette époque, Noam vivait dans un village lacustre dirigé par son père Panoam qu'il admirait. Lorsqu'arrivèrent le guérisseur Tibor et sa fille Noura, venus chercher refuge dans leur communauté, la vie de Noam fût bouleversée : totalement sous le charme de Noura, il découvrit la véritable identité de pervers narcissique de son père qui décida arbitrairement de prendre Noura pour seconde épouse en plus de sa femme Helena. C'est auprès de son oncle, vivant caché dans les bois depuis une altercation avec son frère Panoam, que le jeune homme trouva alors refuge et affection.
Barak, devenu son père par procuration, lui enseigna ainsi la vie dans la nature sauvage et lui fit faire la connaissance des chasseresses, des femmes indépendantes et nomades vivant à l'abri de grottes.
En plus d'être confronté à de très nombreuses péripéties familiales au sein de son clan ainsi que de devenir père, Noam découvrit la montée constante et régulière du niveau du lac nourricier autour duquel de nombreux villages avaient organisé leurs activités. Devenu chef de son clan, il prit alors la décision de bâtir des embarcations pour se préparer à la transformation de son environnement et protéger sa famille ainsi que sa communauté du déluge annoncé...
Quelle épopée ! J'avoue avoir été perplexe au début sur le ton pris qui me paraissait léger, voire frivole au regard de ce que promettait la quatrième de couverture : « Faire défiler les siècles [...] comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. » Cela me semblait trop romancé, trop manichéen. J'ai également ressenti quelques appréhensions sur la fréquence des rebondissements semblant un peu trop servir le récit et le risque d'utilisation déraisonnable de ficelles scénaristiques.
Mais finalement ces craintes se sont progressivement envolées... Car les pages s'enchaînent, l'architecture générale d'un récit qui se déroulera sur huit tomes commence à se distinguer dans toute sa richesse, les connaissances sur le Néolithique se mettent à affluer, les personnages deviennent véritablement attachants et la fin se montre passionnante en parvenant à mettre en relief les dernières découvertes archéologiques qui expliquent l'épisode du Déluge si bien conté et démythifié par Noam lui-même.
Bref, le lecteur se trouve petit à petit embarqué par Éric-Emmanuel Schmitt qui se révèle être un conteur passionnant. Jamais pédant, son parti pris d'utiliser une trame romanesque préserve le lecteur de sombrer dans un livre à dimension universitaire tout en lui faisant acquérir de nombreuses connaissances. Même ceux qui ne sont pas férus de la période Néolithique découvriront un pan passionnant de notre histoire commune durant lequel ont eu lieu des transitions capitales concernant l'organisation de la société qui expliquent toujours aujourd'hui le monde contemporain.
Concernant les nombreux rebondissements, ils sont utilisés avec intelligence pour servir l'histoire et lui apporter le rythme et la fluidité indispensables dans un projet littéraire d'une telle envergure. Il faut aussi y voir cette filiation à Alexandre Dumas dont l'auteur se réclame et sa passion pour le théâtre qui éclaircit justement sur ces « coups de théâtre » qui surgissent régulièrement ! J'ai même ressenti, malgré l'absence d'image, un style bande dessinée... Cela est certainement lié à la dimension manichéenne appuyée, à la candeur de plusieurs personnages et à la profusion d'images que l'auteur sait faire naître avec tant de talent.
Schmitt dit s'être lancé dans le projet de sa vie, celui auquel il réfléchissait déjà il y a presque quatre décennies ! Ayant amassé tout ce temps durant des connaissances dans de nombreux domaines, il nous plonge aujourd'hui dans l'histoire vertigineuse de l'humanité.
En revisitant les grands mythes fondateurs de l'Ancien Testament, il raconte notre passé en décryptant les nombreuses interprétations qui ont fini par noyer totalement la réalité au profit des grands textes religieux. Ainsi Paradis perdus revisite l'épisode de l'arche de Noé sauvant tous les animaux de la création à travers le périple de Noam qui, suite en réalité à la fin de la période glaciaire faisant déborder la Méditerranée dans la Mer Noire, embarque à bord de radeaux pour ne pas être englouti.
Ce premier volume de La traversée des temps aborde dans un style littéraire soigné énormément de sujets dont la transformation de la réalité en mythe ou le rapport de l'homme à la nature qui d'un animisme respectueux est parvenu à une domination destructrice.
Hymne à la nature et à l'amour à travers Noam et Noura, faisant la part belle à la grande aventure, celle qui offre une vraie évasion, il y a un sentiment de fraîcheur et de renouveau à la lecture de ce livre qui s'écarte avec brio d'une production littéraire française parfois un peu trop sclérosée.
[Critique publiée le 10/03/23]

L A T R A V E R S É E D E S T E M P S | LA PORTE DU CIEL (tome 2)
Éric-Emmanuel Schmitt - 2021
Albin Michel - 581 pages
19/20
La naissance du monde urbain en Mésopotamie
 Après une fin tragique et violente dans le premier tome, l'immortel Noam est de retour grâce aux soins et à la patience de sa tendre Noura. Au cœur d'une nature exubérante, le jeune homme né au Néolithique partage des moments de félicité absolue avec son amante : « L'odeur de Noura m'enivrait, et toutes ses variations, le fruité de sa langue, le boisé de ses cheveux, le salé de ses épaules, l'épicé de ses aisselles, l'ambre musqué de son vagin... »
Après une fin tragique et violente dans le premier tome, l'immortel Noam est de retour grâce aux soins et à la patience de sa tendre Noura. Au cœur d'une nature exubérante, le jeune homme né au Néolithique partage des moments de félicité absolue avec son amante : « L'odeur de Noura m'enivrait, et toutes ses variations, le fruité de sa langue, le boisé de ses cheveux, le salé de ses épaules, l'épicé de ses aisselles, l'ambre musqué de son vagin... »
Il apprend que sa renaissance a duré plusieurs générations et, lorsqu'il quitte son lieu de convalescence, découvre un monde nouveau dans lequel le commerce est devenu l'activité principale de ses congénères.
Le malheur le rattrape néanmoins rapidement lorsqu'il découvre la disparition de Noura du relais de voyageurs où elle officiait. Une nouvelle quête reprend alors : trouver sa bien-aimée même s'il faut parcourir le monde entier.
Avec le seul souvenir que lui a laissé Noura, un fidèle chien qu'il nomme Roko, Noam écoute le sage Tibor lui aussi devenu immortel à l'âge canonique de quatre-vingt-quinze ans lui intimant de descendre vers le pays des Eaux Douces également nommé Mésopotamie...
Au cœur de ce territoire du Moyen-Orient irrigué par le Tigre et l'Euphrate, Noam rencontre de nouveaux amis dont le magicien Gawan et le jeune Maël qu'il sauve d'une mort certaine. Sa découverte la plus stupéfiante et déstabilisante demeure cependant ces cités qui fleurissent partout dont la plus audacieuse, Babel, qu'il décrit avec tant de poésie lorsque la nuit tombe : « Les pavillons royaux se soustrayaient à la pénombre : leurs murs tremblotaient sous l'effet des torches tandis que les eaux des fontaines et des bassins frémissaient de ces lueurs lointaines. En deçà, les ruelles sinueuses, réchauffées par la lumière des flambeaux, dotaient la cité d'une parure d'or, ici collier, ici pendentif, ici broche, ici bracelet, ici diadème. Ornée, somptueuse, entre putain et princesse, Babel m'envoûtait. ».
Le développement des villes sous-entend celui de la propriété, des enceintes, des murailles et, in fine, l'apparition de guerres liées aux diverses jalousies. Ainsi, Nemrod, le roi de Babel, défie sa voisine qui n'est autre que la reine Kubaba à la tête de la cité de Kish.
Noam, rebaptisé Naram-Sin afin de conserver sa discrétion vis-à-vis de son demi-frère Derek, pénètre au cœur de ces rivalités. Fasciné par la truculence et l'assurance de la reine Kubaba, il s'horripile face à l'orgueil du roi Nemrod qui, avec Gungunum son architecte et Messilim son astronome, se vante de construire une tour de dix-huit étages !
« Nous sommes nés pour vivre au milieu de la nature, pas dans un monde artificiel construit de briques et de pierres scellées par le bitume. Ah, ces remparts ! De quoi protègent-ils les gens ? De la terre, de l'eau, du vent, du soleil, des bêtes sauvages ? Non, ils les protègent des autres, lesquels se réfugient aussi derrière leurs remparts. Les forteresses ont créé les invasions ! Elles n'ont pas été conçues pour s'en défendre, plutôt pour les provoquer. Plus il y aura de cités, plus il y aura de combats ; la guerre ne cessera jamais. Ce que les hommes font à l'intérieur des murailles - s'envier -, les cités le font entre elles. Elles développent les pires de nos sentiments : la jalousie, la vanité, l'avidité, la crainte. Les gens cherchent le succès matériel qui les hissera au-dessus de leur voisin, ils paniquent à l'idée de rater. Rater quoi ? Réussir ne consiste pas à acquérir quatre maisons, car tu n'en habites jamais qu'une et à l'intérieur, tu n'es que toi-même. Il ne faut pas posséder plus, mais exister mieux. »
Dans la lignée du premier tome, cette suite est extrêmement riche en rebondissements et en dialogues, ce qui rend l'ensemble très vivant.
À côté de cette dimension théâtrale, Éric-Emmanuel Schmitt sait également équilibrer son texte avec des descriptions précises, des réflexions approfondies, des envolées lyriques rendant hommage à notre belle langue et toujours des informations historiques. Par exemple, à travers les connaissances de Gawan, l'auteur nous parle de l'invention de l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Puis il met en parallèle la construction de la tour de Babel et celle des gratte-ciels de Dubaï qui témoigne encore, malgré les millénaires d'écart, de la folie humaine.
Au sein de sa nouvelle grande œuvre se dessine aussi un plaidoyer engagé pour la protection du vivant à travers le héros Noam qui, né dans un monde où la nature était au centre de toutes les attentions, voit au fil des générations se déliter le respect que l'homme porte à la terre qui l'accueille. Il y a les arbres qui sont un leitmotiv apparaissant dans chaque volume et dorénavant Britta Thoresen, double littéraire de la célèbre Greta Thunberg. Schmitt loue sa force morale d'adolescente ainsi que son combat devenu un symbole pour toute une génération malgré ce qu'en disent certains détracteurs s'arrogeant le droit de juger par le simple fait qu'une « enfant » aurait moins de légitimité sur le sujet.
Et enfin, l'auteur renoue avec les récits bibliques à travers la figure d'Abraham, ce nomade à l'origine des peuples hébreu et arabe et père du monothéisme qui se développera plus tard à travers les religions juive, chrétienne et musulmane. Noura et Noam sont placés au cœur de la fable racontant la naissance des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, chacun à l'origine d'un peuple sémite. Ces considérations théologiques permettent de démythifier les grandes légendes qui façonnent nos cultures toujours aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout en reconnaissant leur riche inventivité narrative mise ici au service du récit avec une grande justesse.
Bref, dans La porte du ciel l'épopée se poursuit de manière éclatante sans jamais laisser de répit au lecteur !
[Critique publiée le 01/01/24]

1 4 9 2 , L A C O N Q U Ê T E D U P A R A D I S
Robert Thurston - 1992
France loisirs - 273 pages
16/20
Rendez-vous avec l'Histoire
 Ce livre, écrit d'après le scénario du film de Ridley Scott, retrace l'épopée fantastique du génois Christophe Colomb.
Ce livre, écrit d'après le scénario du film de Ridley Scott, retrace l'épopée fantastique du génois Christophe Colomb.
Convaincu de la rotondité de la Terre et qu'il existe par conséquent une route vers l'ouest menant vers les Indes, Colomb réussit à convaincre le royaume d'Espagne de lui faire confiance. À l'époque où l'Espagne montre sa puissance et reprend Grenade aux maures (1492), Isabelle de Castille se laisse séduire par ce marin et rêve déjà de nouvelles richesses pour son pays.
Le 3 août 1492, trois caravelles (la Santa Maria, la Niña et la Pinta) quittent l'Europe. Le 12 octobre, elles atteignent San Salvador (île des Bahamas). Colomb décrit ce Nouveau Monde avec beaucoup d'émotions. Les indigènes, surnommés malencontreusement « indiens », vivent dans une nature digne du paradis. Tout y est douceur, innocence, volupté. Colomb va construire des cités et tenter de christianiser les indiens, il cherchera également de l'or en grande quantité pour séduire les rois d'Espagne à son retour. Il ramènera quelques indiens en Espagne et refera trois autres voyages vers les Amériques, repoussant à chaque fois un peu plus loin sa découverte de nouveaux territoires. Les colons exacerberont vite les passions, apporteront des maladies de l'Ancien Monde, répandant la mort sur leur passage.
C'est le choc de deux civilisations, deux continents qui ont évolué séparément.
C'est l'histoire d'un homme, convaincu d'apporter le bien mais qui sera vite dépassé par les événements et finira dans l'oubli et le déshonneur, persuadé d'avoir atteint les Indes jusqu'à sa mort en 1506.
Un livre concis, rapide à lire et qui retrace de façon claire les grandes étapes de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

Dernière mise à jour :
[ - Site internet personnel de chroniques littéraires. Mise à jour régulière au gré des nouvelles lectures ]

Copyright MAKIBOOK - Toute reproduction interdite
contact [at] makibook.fr


