 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire
 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire

Romans > Aventure
L ' Î L E D E S P E R R O Q U E T S
Robert Margerit - 1942
Phébus - 350 pages
20/20
Une promesse d'évasion littéraire !
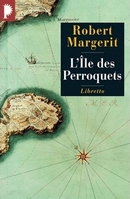 Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Antoine est un jeune homme travaillant à la ferme dans la campagne toulousaine. Sa vie simple est égayée par les sorties hebdomadaires dans la vieille grange de la mère Cathy afin de danser avec les autres valets et servantes et surtout d'y retrouver sa douce moitié Marion. Les deux amoureux s'enfuient alors discrètement dans le bois alentour afin de consommer leur bonheur...
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Antoine est un jeune homme travaillant à la ferme dans la campagne toulousaine. Sa vie simple est égayée par les sorties hebdomadaires dans la vieille grange de la mère Cathy afin de danser avec les autres valets et servantes et surtout d'y retrouver sa douce moitié Marion. Les deux amoureux s'enfuient alors discrètement dans le bois alentour afin de consommer leur bonheur...
Une nuit, malheureusement, Marion demeurée seule se noie dans l'étang du bois. Antoine est accusé à tort de son meurtre, jugé sommairement et emprisonné. Parvenu à s'enfuir, il prend la direction de l'Espagne en longeant la mer.
Découvrant deux embarcations trafiquant de nuit sur la côte et n'ayant plus grand chose à perdre, le jeune homme de vingt-deux ans hèle l'équipage et demande à embarquer. Le capitaine Flint, entre deux rasades de rhum, le nomme écrivain de bord pour commencer et lui apprend qu'il devra combattre le pouvoir royal dès que l'occasion se présentera. Antoine débute désormais une nouvelle vie, celle de pirate !
Deux ans plus tard, il navigue à bord d'un beau brick-franc de construction bretonne dénommé le Walrus. Le second capitaine Brice, avec qui il s'est lié d'amitié, lui a appris à se repérer grâce au ciel étoilé. Pour le reste, Antoine a beaucoup observé et imité ses compagnons pour agripper les haubans, manier des haches d'abordage ou partager équitablement un butin.
La vie des gentilshommes de fortune est faite de longues navigations dans la mer des Antilles afin d'y détrousser des navires pour s'enrichir. Mais au bout de plusieurs mois ainsi, « à quoi nous servait d'avoir nos poches pleines d'un argent durement gagné, si nous ne trouvions point l'occasion d'en faire usage ! »
Sous les couleurs espagnoles, le navire entre dans la baie de Galapas où Flint connaît un bon cabaret tenu par la señora Encarnacion. Cette dernière est dévastée depuis que sa fille Mañuela a été enlevée le matin même par un moine franciscain. À cette époque, couvents et autres monastères abritent toutes sortes de bandits cachés sous les apparences de la foi. Devant un petit tableau représentant la jeune femme, les hommes du Walrus ont les yeux qui brillent et la respiration coupée face à tant de beauté : « C'est la plus belle fille de l'île : des yeux de diamant noir, une bouche comme une grenade, et quelle taille ! et son corsage ! et des jambes ! Madre de Dios ! il faut la voir quand elle danse ; elle ferait brûler un mort. »
L'équipage, en quête d'aventures, prend la décision d'attaquer le couvent pour y délivrer Mañuela dont Brice est sous le charme absolu. Et comme toujours, ce sont les femmes qui tiennent les rênes, qui mettent les hommes à genoux y compris les plus téméraires et brutaux car cette décision va entraîner Antoine et ses amis dans une grande aventure faite de fortunes et d'infortunes...
Course-poursuite avec des frégates royales de guerre, mutinerie à bord opposant flibustiers anglais et français, sentence de la Marque noire ou encore abandon sur une île déserte sont quelques-uns des riches et éprouvants épisodes que va vivre Antoine et ses amis.
Les personnages sont attachants, les paysages sont magiques, les rebondissements portent le lecteur jusqu'à la dernière page. On pense évidemment à L'île au trésor de Stevenson mais aussi au célèbre roman Le Comte de Monte-Cristo qui débutait également par une fausse accusation et se poursuivait avec la découverte d'un immense trésor...
Le ton employé est juste en équilibrant les scènes d'action et celles de flânerie. Le style littéraire de Robert Margerit est extrêmement agréable et soigné. C'est par exemple le cas lorsque le héros et ses amis naviguent sur une rivière de l'île des perroquets où la nature est luxuriante : « Peu à peu, la rivière ralentissait son cours. Ses eaux apaisées, où traînaient des chevelures pourpres, doublaient cette magnificence en la reflétant, de sorte que nos embarcations paraissaient voguer dans le vide entre deux immenses nefs inverses fleuries de guirlandes, de cippes et de couronnes. Puis, des branches retombantes enracinées à leur tour dans les ondes, s'élancèrent de nouveaux arcs. Leur écorce jaune brillait comme des ors patinés. À leur pied le courant amoncelait des grappes d'un bleu azur que nous prîmes tout d'abord pour des fleurs et qui étaient en réalité des coquillages d'eau douce. Des vols de papillons diaprés s'abattaient sur ces bancs ; c'étaient des oiseaux. Des fleurs tombaient sur nous, ouvraient soudain des ailes ; c'étaient des papagayos, roses comme le premier rayon du matin. »
La sensualité de Soledad dont tombe amoureux Antoine est aussi l'occasion d'utiliser une écriture fine et ciselée : « Le cabinet de marbre était le lieu favori de Soledad. La douceur du jardin, sur lequel il ouvrait ses vastes baies, s'y mêlait à la fraîcheur de la pierre polie, à la profondeur glauque et liquide des miroirs encastrés dans les murs. Au centre, un bassin recevait les eaux murmurantes de la fontaine. Souvent des vols de ramiers ou de perroquets roses traversaient la pièce, ou bien un paon des îles, familiarisé avec les lévriers endormis sur les dalles, venait promener au milieu d'eux son aigrette et ses ocelles vertes, bleues, mordorées. Soledad m'attendait près du bassin empourpré par le couchant, assise sur des coussins, dans les plis d'une robe d'apparat que je lui avais donnée le jour même. Le décolleté horizontal dégageait ses épaules caressées par une dentelle. Un fil de perles à son cou, de petites fleurs de nacre dans ses cheveux, paraient sa grâce indéfiniment reflétée de miroir en miroir. Elle m'accueillit d'un sourire, toute menue dans sa grande robe blonde et rose. »
Tous les ingrédients de l'aventure sont présents, tous les poncifs des romans de piraterie aussi mais utilisés avec tant de charme et de dextérité que l'auteur parvient à tisser un récit captivant et palpitant.
Lire L'île des perroquets, c'est partir en voyage dans les Caraïbes durant une longue nuit tropicale mêlant effluves maritimes et parfums de femmes fatales, accroché aux haubans d'un brick en quête d'aventures et d'imprévus, l'œil à l'affût d'une baie abritée à l'ombre de laquelle les plaisirs de la terre seront de retour après d'interminables journées sur l'océan.
Lire L'île des perroquets, c'est partir, s'enfuir, rêver comme un enfant, découvrir si ce n'était le cas le pouvoir incontestable de la littérature !
À classer dans les romans cultes.
[Critique publiée le 04/10/24]

N U I T S T R A N Q U I L L E S À B E L É M
Gilles Lapouge - 2015
Arthaud - 163 pages
14/20
Questions existentielles sous les tropiques
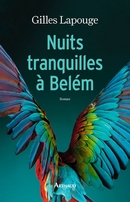 Le narrateur, Gilles Lapouge, se rend au Brésil afin de rencontrer un certain Olacyr de Freitas. Ce dernier posséderait des documents intéressants sur un personnage historique, Blaise de Pagan, que Gilles étudie. Blaise de Pagan fut le meilleur géographe du roi Louis XIV et un mystère demeure quant à la cécité qui l'a atteint durant son exploration de l'Amazonie.
Le narrateur, Gilles Lapouge, se rend au Brésil afin de rencontrer un certain Olacyr de Freitas. Ce dernier posséderait des documents intéressants sur un personnage historique, Blaise de Pagan, que Gilles étudie. Blaise de Pagan fut le meilleur géographe du roi Louis XIV et un mystère demeure quant à la cécité qui l'a atteint durant son exploration de l'Amazonie.
Le destin prend cependant un tout autre virage lorsque, en montant dans l'ascenseur pour visiter Olacyr, un enfant d'une dizaine d'années saute dans les bras de Gilles en lui criant : « Papa, tu es revenu ! Tu es revenu ! »
Réticent au début, l'homme se laisse prendre au jeu et suit le gamin dans les favelas de Belém. Il apprend que l'enfant se prénomme Ricardo tandis que celui auquel tout le monde l'identifie est un certain Luis Carlos parti depuis quelques années chercher de l'or en Guyane.
Reconnu par tout son entourage, il fait la connaissance de sa femme Maria de Lurdes. Voluptueuse, mais au visage parfois triste et sévère, Maria n'a pas oublié leur passé peu glorieux. Le narrateur, lui, doit découvrir qui il est et renaître dans la peau d'un inconnu. Petit à petit, les anciennes connaissances se manifestent à lui pour le pire et le meilleur : à l'image de Ricardo, certains sont heureux de le retrouver tandis que d'autres le mettent en garde contre les risques qu'il prend en revenant sur ses terres. Le "vrai" Luis Carlos était en effet un fieffé coquin, un coureur de jupons invétéré ayant commis ses frasques sexuelles avec de nombreuses femmes du village et cela au grand dam de la malheureuse Maria de Lurdes.
Renaître dans la peau d'un autre, changer de vie, effacer le passé et recommencer... Ce thème maintes fois abordé en littérature est ici abordé sous l'angle du jeu de hasard car notre narrateur, au lieu de décider consciemment de la nature de sa nouvelle vie, confie au destin le choix de celui dont il prendra la place. En se substituant à un autre, il y a aussi ce danger permanent d'être réellement reconnu et que l'imposture soit révélée au grand jour mais il n'en demeure pas moins qu'il existe une excitation, une sorte de jeu à se faire passer pour un autre qui est un total inconnu. Cette ambivalence est le fil rouge du récit et lui donne sa dimension narrative.
À côté de cela, comme son joli titre l'indique, le roman est l'occasion de passer un peu de temps dans la torpeur des nuits brésiliennes entre les maisons faites de bric et de broc des favelas et l'immense fleuve Amazone. L'auteur brosse, dans ce cadre exotique, le portrait de quelques personnages savoureux comme le prêtre ou les vendeurs de poissons.
Finalement, il aborde des questions existentielles sur notre identité, notre construction, la place des souvenirs en chacun de nous. Gilles Lapouge insiste sur le fait qu'il n'a choisi ni sa famille, ni son époque, ni l'endroit où il est né et cela m'a fait penser à la très juste chanson de Maxime Le Forestier qui dit :
« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher
être né quelque part
être né quelque part, pour celui qui est né
C'est toujours un hasard »
[Critique publiée le 29/06/24]

L ' H O M M E Q U I S ' E N V O L A
Antoine Bello - 2017
Gallimard - 318 pages
12/20
Un livre convenu
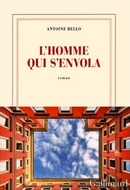 Walker est à la tête d'une entreprise de livraison de colis florissante dans le Nouveau-Mexique. Passionné d'aviation, il est marié à Sarah, une femme ravissante et intelligente, père de trois magnifiques enfants et extrêmement riche.
Walker est à la tête d'une entreprise de livraison de colis florissante dans le Nouveau-Mexique. Passionné d'aviation, il est marié à Sarah, une femme ravissante et intelligente, père de trois magnifiques enfants et extrêmement riche.
Seulement, malgré le succès et l'argent qui met à l'abri ses enfants et futurs petits-enfants, Walker est frustré ; l'essentiel lui manque : le temps. Ses responsabilités professionnelles, sa famille et ses multiples autres obligations dévorent ses journées. Pour lui, le temps est synonyme de liberté. Et il ne s'achète pas !
Ce qui au début n'est qu'une lubie devient un plan précis et sérieux : il va mettre en scène sa disparition pour quitter définitivement son quotidien pesant et recouvrir la vraie liberté essentielle à son épanouissement.
Aux commandes de son avion Turboprop, il met le cap sur une chaîne de montagnes voisine et saute de l'appareil en parachute quelques instants avant la terrible collision.
Les dés sont jetés, il ne peut plus reculer. Alors que sa famille doit faire face au terrible chagrin et à l'organisation des funérailles, Walker fuit dans la nature en ayant pris soin au préalable, par un habile montage financier, de se constituer une rondelette somme d'argent sur un compte bancaire étranger.
Évidemment, l'assurance ne classe pas l'affaire sans preuve de sa mort et, afin d'éviter de payer un dédommagement considérable, engage un détective pour enquêter sur la disparition du riche entrepreneur. Nick Shepherd est mandaté pour mener à bien cette mission. Particulièrement expérimenté, il découvre rapidement que Walker est vivant grâce aux colossaux moyens de recherche qu'il engage.
La traque commence alors à travers les États-Unis...
Ce roman commence honnêtement : un héros digne de Largo Winch nous est présenté. Cela n'a rien d'étonnant dans une Amérique où il est de coutume que certains réussissent bien plus que d'autres. Pour ce Walker, tout semble ainsi parfait : l'argent, l'amour, la famille. Bref, même les personnages de Santa Barbara ou Amour, gloire et beauté semblent galérer à côté. Seulement, Antoine Bello brosse des portraits assez superficiels et convenus. Les acteurs de son histoire manquent de profondeur et de densité.
Rapidement, la disparition est amenée et la traque est lancée. Soyons honnête, certaines pages de la course-poursuite sont prenantes et bien rythmées. Le lecteur est avide de poursuivre l'aventure pour en connaître le dénouement.
Mais la fin m'a déçu. Je m'attendais à une réelle confrontation entre les protagonistes principaux que sont Walker, Sarah et Nick dans la seconde partie du récit. J'aurais voulu une conclusion plus pimentée, plus surprenante.
Bref, le thème initial de la disparition volontaire est passionnant, troublant, excitant ; mais cette idée si riche et prometteuse n'est pas suffisamment exploitée. L'auteur manque cruellement d'imagination.
Quant au style littéraire, il est inexistant. L'écriture est plate, informe. Seul le rythme des chapitres a été soigné. J'ai connu bien mieux chez Gallimard !
Antoine Bello a aussi quelques manies qui transparaissent dans son texte : l'informatique le passionne et lorsque Walker doit accéder à Internet en toute discrétion, le lecteur apprend quel modèle précis d'ordinateur il achète (taille de la mémoire, marque du processeur, ...) ainsi que le nom du navigateur qu'il utilise pour ne pas se faire repérer. Ces détails sont assez dispensables et semblent rajoutés principalement pour montrer les connaissances de l'auteur en la matière.
Enfin, la chute est un peu légère. Cette conclusion à l'eau de rose ne m'a pas emballé et m'a rappelé les romans surfaits de Marc Levi ou Harlan Coben...
[Critique publiée le 10/05/20]

L À O Ù L E S T I G R E S S O N T C H E Z E U X
Jean-Marie Blas de Roblès - 2008
Zulma - 768 pages
20/20
“ Songe, penniforme Isthar, à veiller ! ”
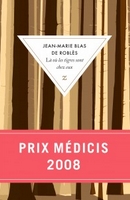 Ce roman s'articule autour d'un pivot central : la vie du jésuite Athanase Kircher dans le XVIIe siècle baroque.
Ce roman s'articule autour d'un pivot central : la vie du jésuite Athanase Kircher dans le XVIIe siècle baroque.
Né en 1602 et mort en 1680, ce personnage, qui a réellement existé, a traversé son siècle avec la volonté insatiable de comprendre la globalité du monde qui l'entourait. Dès les premières pages, nous faisons connaissance avec son disciple Caspar Schott qui, en 1690, décide de retranscrire par écrit ses années d'apprentissage avec le célèbre jésuite. Il se remémore ainsi leurs aventures extraordinaires et incroyables comme l'ascension du volcan Etna pour mieux étudier la lave, la rencontre avec les pêcheurs de Messine qui chantent pour apprivoiser les espadons ou la démystification du miracle de l'apparition de la fée Morgane sur l'île de Malte. Établi à Rome suite à la guerre de Trente Ans, Kircher qui explique l'origine de chaque phénomène en se référant à Dieu, décide de monter un cabinet de curiosités en rassemblant les souvenirs exotiques rapportés par les hommes de sa confrérie en mission d'évangélisation aux quatre coins du monde.
Plus que jamais, il étudie tout : l'alchimie, l'astronomie, la médecine, la volcanologie, la musique, l'égyptologie, l'ethnologie, la théologie, la géographie, ... Expériences et travaux intellectuels occupent toutes ses journées avec une grande intensité. Fidèle à sa devise, « Omnia in Omnibus » (« Tout est dans Tout »), son objectif est de reconstituer l'encyclopédie initiale expliquant tout l'univers. Sur un ton constamment admiratif pour l'œuvre de son maître, Caspar décrit les péripéties qu'il vit en sa compagnie et les riches enseignements qu'il acquiert sur les plans théologiques et scientifiques entre autres.
Cette hagiographie est en réalité une histoire dans l'histoire puisqu'elle constitue le sujet d'étude sur lequel se penche Eleazard Von Wogau. Ce dernier, correspondant de presse pour l'agence Reuters au Brésil, a été chargé de constituer l'appareil critique de ce texte présenté comme inédit. L'homme est passionné par Kircher depuis ses études à l'Université de Heidelberg en Allemagne et recense depuis de nombreuses années tous les éléments se rapportant au saint homme. Eleazard vit dans la petite ville coloniale d'Alcantara, tout près de Sao Luis, dans l'état du Maranhão. En instance de divorce avec sa femme Elaine et n'entretenant plus qu'une relation épistolaire avec sa fille Mœma, il se réfugie dans le récit épique de Kircher et Schott ; il y voit là une véritable thérapie face aux vicissitudes de la vie familiale.
Entouré d'un perroquet bavard nommé Heiddeger et d'une « cabocla » en guise de servante, Eleazard s'enfonce dans le texte baroque en compagnie du lecteur...
Parallèlement, ce roman choral nous présente les parcours de Mœma et Elaine.
Cette dernière, jolie brésilienne, recherche elle aussi son graal. Spécialisée en archéologie, elle monte une expédition scientifique afin de trouver des fossiles primitifs datant du Précambrien. Accompagnée de Dietlev, ami géologue de longue date, de l'étudiant Mauro et d'un ponte universitaire plus intéressé par la gloire que la science, elle désire pénétrer en profondeur dans le Pantanal au Mato Grosso en empruntant le fleuve Paraguay.
Guidée par Herman Petersen, trafiquant de drogue au sombre passé nazi, la bande s'aventure dans la jungle brésilienne dans une ambiance moite qui n'est pas sans rappeler celle brossée par Conrad dans Au cœur des ténèbres. Leur périple ne va pas du tout se passer comme prévu : des trafiquants sans scrupules vont intercepter leur embarcation et gravement blesser Dietlev. Pour survivre, la petite troupe devra s'enfoncer à pied dans la jungle et affronter mille dangers...
Mœma, quant à elle, étudie l'ethnologie à l'université de Fortaleza. Superbe fille au corps bronzé et musclé, elle est en quête d'elle-même à travers une vie sexuelle déjantée et une dépendance aux vertiges de la drogue.
En compagnie de son amie Thaïs, elle embarque leur jeune professeur, Rœtgen, pour une folle virée initiatique dans le Nordeste brésilien. À la recherche des origines indiennes de son pays, la fille d'Eleazard tombe en chemin sous le charme d'un beau gosse connaissant la mythologie des peuples primitifs. Elle fait aussi découvrir à Rœtgen la dure vie des pauvres pêcheurs qui bravent le danger à bord des jangadas.
Ces épisodes donnent lieu à quelques savoureuses digressions sur l'absurdité du monde ou le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres. L'amour et la vérité sont aussi les thèmes abordés au sein de la relation triangulaire qui unit Rœtgen, Mœma et le brésilien dont elle est éprise.
Bref, tandis que son père s'enfonce dans un manuscrit et que sa mère se noie dans la jungle impénétrable de l'Amazonie, Mœma expose son corps à tous les vices dans les bas-fonds sordides de la nuit brésilienne...
Enfin, de nombreux autres personnages viennent graviter autour de ce noyau central.
C'est le cas de Loredana, la mystérieuse et ravissante italienne venue se perdre à Alcantara. Cachant un terrible secret, elle est en quête d'une issue à l'impasse dans laquelle elle est inexorablement plongée.
Il y a aussi Nelson, cul-de-jatte, vivant dans les favelas de Pirambu sous la bienveillance de l'oncle Zé. Orphelin, Nelson ne vit plus que pour venger son père mort dans un tragique accident dans l'usine métallurgique appartenant au colonel José Moreira da Rocha. Ce dernier est l'un des protagonistes importants du récit. Gouverneur de l'Etat du Maranhão et riche propriétaire terrien, il ne pense qu'à s'enrichir quitte à outrepasser les lois en commettant quelques accidents irréparables...
Il serait long et laborieux de présenter ici l'ensemble des personnages qui habitent ce roman foisonnant ainsi que les liens qui les unissent.
Le lecteur navigue dans une succession d'épisodes possédant un rythme narratif à la Dumas et alternant, à travers un découpage très régulier et pointilleux, les allers-retours entre XIXe et XXe siècles. Ainsi, le lecteur se fraie un chemin dans la jungle brésilienne puis déniche une chapelle cachée en plein cœur du Rome baroque ; plus loin, il découvre la vie du plus célèbre des cangaceiros ou tient de passionnantes discussions sur l'art avec le pétillant professeur Euclides da Cunha...
Je n'oublie pas non plus cette plongée avec Loredana dans les ruines antiques cyrénaïques en Libye, clin d'œil glissé par l'auteur à ses propres expéditions archéologiques, ou bien cette folle Macumba que la même jeune femme va vivre dans son chemin initiatique.
Des images fortes restent une fois le livre refermé !
Je pense à Moéma assise sur son trône lors de la fête de la Yemanja, je revois les anges qui s'envolent au-dessus de la jungle pour rejoindre la « Terre sans mal », je sens encore la chaleur moite de la végétation luxuriante qui entoure la demeure où Eleazard plonge corps et âme dans l'hagiographie de Kircher, je vois toujours ce dernier courir sur les pentes en lave du volcan en éruption ou élucider la raison de sa présence dans la villa baroque Palagonia où la luxure semble régner en tout lieu.
La richesse des expériences, les mille histoires racontées, la nature rocambolesque des aventures, le foisonnement de données historiques, le portrait du Brésil contemporain, la beauté du style employé et la magie de l'ensemble font de ce roman un livre hors-norme, inclassable et extrêmement original. Il s'agit là d'un travail pharaonique qu'a mené Jean-Marie Blas de Roblès. Le résultat : un chef-d'œuvre.
Pour la petite histoire, l'auteur a passé dix années à construire ce récit. Apeurés, tous les éditeurs consultés ont refusé sa publication. Ce n'est que sur l'insistance de ses amis que le passionné de Kircher a mené de nouveaux efforts pour se faire publier. Ce sont finalement les éditions Zulma, maison ô combien exigeante sur le fond et sur la forme de ses publications, qui ont pris le risque de faire paraître Là où les tigres sont chez eux. Le titre a dès lors remporté en 2008 le prix Médicis, le prix Jean Giono et le prix des lecteurs FNAC !
Et pour couronner le tout, Jean-Marie Blas de Roblès clôt ce roman par une énorme pirouette à travers l'anagramme Malbois... L'extravagance est totale et la littérature au paroxysme de sa puissance !
[Critique publiée le 10/05/20]

L ' Î L E D U P O I N T N E M O
Jean-Marie Blas de Roblès - 2016
Zulma - 458 pages
19/20
Fiction ou réalité ?
 Martial Canterel est tranquillement chez lui à Biarritz, plongé dans une partie de stratégie militaire, lorsque son ami John Shylock Holmes accompagné du majordome Grimod de La Reynière viennent lui rendre visite. Ils tiennent à informer Martial du vol commis chez son ancienne compagne Lady MacRae : le plus gros diamant du monde, appelé Anankè, a en effet été dérobé dans son domicile écossais sis au Eilean Donan Castle.
Martial Canterel est tranquillement chez lui à Biarritz, plongé dans une partie de stratégie militaire, lorsque son ami John Shylock Holmes accompagné du majordome Grimod de La Reynière viennent lui rendre visite. Ils tiennent à informer Martial du vol commis chez son ancienne compagne Lady MacRae : le plus gros diamant du monde, appelé Anankè, a en effet été dérobé dans son domicile écossais sis au Eilean Donan Castle.
Le groupe quitte alors la France, à bord d'un autocar aménagé en appartement et roulant au méthane, pour l'Écosse. Là, Lady MacRae les renseigne précisément sur l'autre mystère accompagnant la disparition de son bijou : trois pieds humains amputés au niveau de la cheville ont été retrouvés dans trois lieux écossais différents quelques jours plus tôt. En outre, ces trois membres étaient tous encore équipés du même modèle de chaussure de l'étrange marque inconnue Anankè.
Grâce à son intuition en observant les trois semelles, Canterel découvre un indice de taille : le mot « Martyrio » qui est le nom d'un cirque dont l'un des magiciens est actuellement en tournée à Londres.
Nos protagonistes filent assister au numéro du magicien qui se termine de façon tragique et soudaine. Ils y retrouvent d'ailleurs une ancienne connaissance en la personne de Litterbag, inspecteur de Scotland Yard aussi en filature. Là, grâce à une jambe de bois faisant office de scytale, la petite bande découvre que le diamant sera à bord du Moscou-Pékin dans quelques jours...
Et les voilà sur le point de partir pour Moscou afin d'embarquer à bord du mythique Transsibérien dans lequel ils vont à nouveau faire de nombreuses connaissances. Citons seulement le docteur Mardrus, une somptueuse créature Ukrainienne dont Canterel aura la chance d'admirer les tatouages secrets, le prince Sergueï Svetchine ou encore le baron Ulrich. La troupe sera attaquée par une horde de cosaques et confrontée à de nombreuses aventures et surprises qui mèneront le lecteur bien au-delà des prémices racontées jusqu'ici...
Un autre récit vient s'entremêler de façon intermittente à cette aventure classique digne des grands romans du XIXe siècle. Il s'agit du quotidien de quelques personnages contemporains gravitant autour d'une usine fabriquant des liseuses électroniques au cœur de la Dordogne.
Il y a Arnaud Méneste qui, à l'origine, avait choisi de s'installer dans ce lieu aux multiples grottes et recoins naturels pour y établir une manufacture de cigares en compagnie de sa muse Dulcie Présage. C'est elle, lors de leur rencontre à Haïti, qui lui avait fait découvrir cet univers où des lecteurs officient depuis le XIXe siècle pour aider les ouvriers enroulant le tabac dans des feuilles à se concentrer. Suite à la faillite de ce beau projet dordognais, Dulcie a fait une attaque cérébrale et demeure depuis dans le coma. Quant à la fabrique de cigares, elle a été rachetée par le chinois Wang-li Wong qui l'a transformée en usine assemblant des liseuses électroniques sous le nom B@bil Books ! Arnaud y est devenu lecteur et raconte les aventures fictives de... Martial Canterel à la recherche du diamant de Lady MacRae !
Dieumercie Bonacieux, autre protagoniste, est lui un employé de l'usine dont le souci d'impuissance sexuelle est devenu la marotte de sa femme Carmen qui teste tous les miracles, aussi incongrus soient-ils, pour y remédier.
Jean-Marie Blas de Roblès a consacré quatre années à cette œuvre littéraire dont une pour la préparation et trois pour l'écriture. Comme dans son magistral roman Là où les tigres sont chez eux, au sujet duquel sont ici glissés quelques clins d'œil, l'auteur tisse une histoire dont l'architecture est vertigineuse en posant dès l'incipit la question de savoir où se situe la frontière entre réalité et fiction.
Un enfant n'aura sans doute pas la même façon de traiter cette problématique qu'un adulte. Toujours est-il que l'adulte qui ouvre ici l'ouvrage sera facilement manipulé par un Blas de Roblès astucieux et d'autant plus surpris à la fin de l'histoire ! Car deux univers se télescopent qui sont mis en scène avec malice par notre écrivain.
Le premier est un hommage grandiose aux feuilletons du XIXe siècle et fait évidemment tout de suite penser à Jules Verne et ses Voyages extraordinaires. Sans compter aussi de multiples références à Arthur Conan Doyle, Alexandre Dumas, Thomas Mann, ...
L'histoire de Martial et ses amis est tonitruante, rocambolesque, farfelue et parfois improbable. Mais ce sont tous ces aspects qui créent un charme fou et prennent le lecteur par la main pour le plonger, tel un enfant, dans l'Aventure au sens premier du terme.
À l'opposé, le second univers est à l'image du quotidien que nous connaissons dans nos sociétés modernes où règne la futilité. L'argent et le sexe occupent les esprits, les loisirs culturels sont devenus superficiels.
Et Jean-Marie Blas de Roblès de placer au cœur de cette dualité le livre : dans le monde vernien, c'est un objet de luxe, manufacturé avec amour et réceptacle de la beauté du monde alors qu'au sein de notre environnement ce n'est qu'un simple produit de consommation destiné à être numérisé et recevoir n'importe quel contenu. Hetzel contre l'e-book, voilà un noble combat !
Quant à l'écriture, le talent de l'auteur s'exprime évidemment dans la partie racontant l'histoire du diamant. Il avait déjà prouvé dans Là où les tigres sont chez eux qu'il était capable de se fondre dans un autre style littéraire. Ici, il prend la peau de Jules Verne et Conan Doyle avec jubilation et brio. Quel plus bel hommage à la grande littérature d'aventure et à ses maîtres ?
[Critique publiée le 10/03/23]

L ' É P R E U V E D E S H O M M E S B L A N C S
Pierre Boulle - 1955
Omnibus - 102 pages
15/20
Roméo et Juliette entre Malaisie et Occident
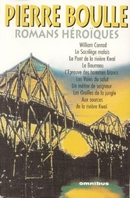 Durant la seconde guerre mondiale, les japonais contrôlent le sud-est asiatique. Au début du roman, ils envahissent le site d'une plantation occidentale d'hévéas située sur la côte malaisienne. Les colons blancs sont tous massacrés à l'exception d'une petite fille qui parvient à fuir et rejoindre le kampong voisin. Ce pacifique village traditionnel de pêcheurs accueille l'enfant avec quelques réticences au tout début par peur des éventuelles représailles japonaises. La famille du chef du village décide finalement de cacher l'enfant puis de l'élever selon ses traditions ancestrales.
Durant la seconde guerre mondiale, les japonais contrôlent le sud-est asiatique. Au début du roman, ils envahissent le site d'une plantation occidentale d'hévéas située sur la côte malaisienne. Les colons blancs sont tous massacrés à l'exception d'une petite fille qui parvient à fuir et rejoindre le kampong voisin. Ce pacifique village traditionnel de pêcheurs accueille l'enfant avec quelques réticences au tout début par peur des éventuelles représailles japonaises. La famille du chef du village décide finalement de cacher l'enfant puis de l'élever selon ses traditions ancestrales.
Marie-Helen grandit ainsi dans sa nouvelle famille en s'initiant à la culture de la Malaisie, ses légendes, ses coutumes et en participant aux travaux quotidiens centrés sur la pêche.
Les années passent et Moktuy, le fils du chef, tombe amoureux de la jeune fille qui s'épanouit à l'aube de ses quinze ans...
En 1945, les bombes nucléaires s'abattent sur Hiroshima et Nagasaki ; les japonais ont perdu. L'homme blanc, muni de ses certitudes, revient alors dans cette zone tropicale.
Dans ce contexte, deux missionnaires, le père Durelle et le docteur Moivre, se rendent en Malaisie et fouillent l'ancienne plantation occidentale à la recherche d'une trace des disparus. La mère de Marie-Helen était en France lors du massacre et a exprimé le désir d'en savoir plus sur le destin tragique de son mari et de sa fille.
Rapidement, grâce aux révélations de l'ancien boy de la plantation, les deux hommes localisent Marie-Helen et la ramènent en France. Elle doit alors se réadapter à la culture occidentale et plus que tout au système scolaire. Loin de la tradition orale et du mode de vie dépourvu de tout superflu qu'elle a connus en Malaisie, la jeune femme trouve difficilement sa place dans une société stricte et compétitive.
Moktuy, quant à lui, souffre également de la perte de son amour. Jusqu'où sa folie va-t-elle le mener ?
Pierre Boulle traite des affres de la guerre dans une Asie du sud-est qu'il a bien connue dans les années 50 pour y avoir vécu.
Les thèmes abordés dans ce roman d'aventure sont la fuite, l'amour, la jalousie, la trahison, l'injustice et les différences culturelles entre Orient et Occident.
L'écriture de l'auteur, mondialement célèbre pour avoir publié Le pont de la rivière Kwaï et La planète des singes est typique de cette époque : soignée, classique et élégante. La littérature a bien évolué depuis en s'appauvrissant malheureusement. L'utilisation du passé simple ne séduit plus et le vocabulaire est de plus en plus commun. L'usage démesuré des écrans, la culture du zapping, de l'immédiateté font que beaucoup de lecteurs veulent des livres consommables rapidement et facilement. L'offre suit et trop de titres sont aujourd'hui publiés dans ce sens, perdant ainsi en nuance et richesse que seule une langue recherchée, précise et soignée peut apporter.
Évidemment, il ne faut point généraliser car les grands écrivains, les artisans de la langue, les amoureux du style, existent encore. De plus, la lecture doit être accessible à tous et les histoires « faciles » à lire ont totalement leur place. Néanmoins, et les prescripteurs littéraires sont utiles en ce sens, il est bon parfois de se plonger dans un roman qui paraît de prime abord aride et exigeant car l'effort intellectuel que cela requiert apportera au lecteur une saveur nouvelle, un enchantement neuf et le développement de son sens critique.
Lire Pierre Boulle aujourd'hui répond entre autres à ce besoin !
[Critique publiée le 10/05/20]

N O R D - N O R D - O U E S T
Sylvain Coher - 2015
Actes Sud - 272 pages
15/20
Cavale maritime de deux petits délinquants
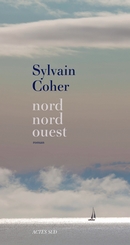 Lucky et Le Petit, deux jeunes encore entre adolescence et âge adulte, ont fui L'Italie. Partis de Ligurie, ils ont traversé la France pour atterrir après mille deux cents kilomètres de cavale à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Leur objectif est de rejoindre l'Angleterre.
Lucky et Le Petit, deux jeunes encore entre adolescence et âge adulte, ont fui L'Italie. Partis de Ligurie, ils ont traversé la France pour atterrir après mille deux cents kilomètres de cavale à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Leur objectif est de rejoindre l'Angleterre.
Dans la cité corsaire bretonne, Lucky s'amourache d'une jeune fille de dix-sept ans. Elle est prête à les accompagner dans leur périple maritime, forte de ses « compétences » de voile acquises plus jeune lors de cours d'Optimist...
Les trois jeunes gens volent un bateau, le Slangevar, à Saint-Servan et embarquent discrètement au pied de la tour Solidor avant le lever du jour.
Armés de L'Almanach du marin breton pour seul support de navigation, les marins de fortune dressent les voiles du navire de sept mètres de long et se lancent à l'assaut de la Manche. Lucky est convaincu qu'une nuit de navigation leur suffira pour rallier l'île britannique. Mais rapidement, le temps commence à s'étirer et aucune terre ne pointe son nez à l'horizon : « Les peaux jointes de l'eau et du ciel formaient un pli lointain d'une évidente sensualité. Le soleil pénétrait l'épaisseur des voiles et ravivait l'écran rougissant. »
Leur escapade incroyable sur Bishop Rock, île minuscule dotée d'un phare et faisant office de barrière entre la Grande-Bretagne et l'océan Atlantique, fait basculer le récit dans l'inconnu. Les nuits se succèdent, la furie de l'océan s'invite à la fête : « Dans cette bousculade permanente, le voilier blanc n'était qu'un jouet malmené. »
Sylvain Coher a écrit un beau roman. Petit à petit, au fil de l'histoire, il distille avec justesse des éléments de compréhension sur l'origine tragique de la fuite des deux garçons. Cela crée ainsi une tension continue renforcée à son tour par le quotidien de la navigation qui prend une tournure angoissante dès le second jour.
Le talent de l'auteur réside aussi dans le fait de réussir à maintenir un rythme prenant sur de longues pages en mer où il ne se passe quasiment rien. L'essentiel de la narration repose sur cet huis clos à bord d'une coquille de noix, occupée par trois individus aux psychologies tourmentées, et ballottée dans les vagues tantôt rugissantes, tantôt apaisées de l'océan Atlantique.
Roman d'apprentissage, récit d'une cavalcade tragique, thriller ou livre de bord d'une navigation aux confins du rail d'Ouessant, Nord-Nord-Ouest rassemble tout cela dans un style d'écriture sobre et précis pour le plus grand plaisir du lecteur.
[Critique publiée le 27/10/15]

L E S R O I S D ' A I L L E U R S
Nicolas Deleau - 2012
Payot & Rivages - 363 pages
13/20
Poésie maritime
 Depuis Dunkerque et son Bart t'abat, taverne des marins de passage, Robert récolte les histoires du monde entier.
Depuis Dunkerque et son Bart t'abat, taverne des marins de passage, Robert récolte les histoires du monde entier.
Sous forme écrite ou orale, il reçoit des lettres et colis des autres bouts du monde et tisse un maillage des expériences et vies maritimes de ses amis voyageurs.
Le lecteur est ainsi embarqué à Manille pour découvrir le quotidien de Thomas, cherchant l'inspiration pour écrire, et généreusement hébergé chez un vieux prêtre missionnaire. Dans une atmosphère moite où la chaleur étouffante rend exubérante la moindre végétation, Thomas scrute à l'ombre des persiennes de la demeure de son hôte les mouvements sur le port de commerce tout proche. Nuit et jour, durant des semaines, il observe le flux incessant des immenses bateaux et les armées de mystérieux manutentionnaires qui s'affairent autour des cargaisons.
Dans un univers radicalement opposé, le récit se poursuit sur les terres glauques de Mourmansk où l'aridité des décors rime avec la misère des habitants mais aussi l'accueil chaleureux que ceux-ci réservent sans modération aux étrangers. Bout du monde russe, « Mourmansk, plus qu'une destination, était une destinée ».
La vie à Luanda, capitale de l'Angola, est également longuement décrite. Cette ancienne colonie portugaise a connu une longue guerre civile suite à son indépendance en 1975 et on pense bien évidement à la magnifique chanson de Lavilliers à ce sujet.
La plage de Santiago est un curieux endroit où les carcasses de vieux navires se désagrègent lentement dans un paysage de rouille et de sable.
Paulo, pauvre pêcheur, s'endort au retour de sa sortie en mer et imagine dans l'océan bleu et infini les longues toiles du marché où les étals de poissons sont tenus par les femmes : « Champ de femmes, champ de matrones sèches ou épaisses, champ de ventres fertiles, de désirs flous, de fleurs de chair et de rires obscènes. Seule à l'écart, certaine, plus belle que les autres, l'appelle d'un œil brûlant. Elle est jeune, fine, mêle la candeur et les lueurs du vice. Ses cuisses tremblent à peine, son ventre ondule, mais si faiblement qu'on croit se tromper. Le coin d'ombre où elle se tient, magnétique, d'un bleu de nuit, prend la densité des lieux de culte. Étal sacrificiel. »
Enfin, bien sûr, comment parler de ces escales maritimes sans évoquer la mythique cité de Valparaíso ? La « perle du Pacifique » à laquelle Alain Jaubert a consacré un bijou de la littérature, Val Paradis, Goncourt du Premier Roman en 2005. Chez Nicolas Deleau aussi la dimension sacrée de ce port de rêve transpire dans la phrase suivante : « À Valparaíso nom de Dieu, Val Paradis, le port du bout du monde, l'escale de l'autre côté, la récompense du cap. »
Nicolas Deleau enseigne aujourd'hui le français en Inde après avoir déjà été professeur dans de nombreux pays dont l'Angola et l'Éthiopie. L'homme connaît donc bien les lieux qu'il décrit et a longuement bourlingué aux quatre coins du monde.
Les Rois d'ailleurs a été primé au Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo en 2013 en recevant le prix de la Compagnie des Pêches.
Pour ma part, j'ai parfois eu du mal à suivre le lien entre les différents récits qui s'enchevêtrent de façon complexe et qui font partie d'une trame générale à la ligne directrice floue.
En revanche, j'ai été littéralement scotché par la qualité littéraire de ce roman. Les images, les descriptions, les ambiances de port sont superbement restituées. Ayant vécu à Brest et longuement arpenté le port de commerce de cette cité, j'ai retrouvé cette émotion qui saisit le marcheur lorsqu'il longe les quais et lit sur les coques des navires en escale autant de noms qui font rêver. L'auteur magnifie les paysages de grues déchargeant les lourdes coques au bout des sombres jetées portuaires et en fait de la dentelle écrite.
Un dernier extrait pour conclure : « À Mourmansk, on cogne sans distinction et sans haine. Les hommes du port sur les putes, les mafias sur les deux, l'alcool et le froid sur tous. »
[Critique publiée le 18/07/13]

L E S F A B U L E U S E S A V E N T U R E S D ' U N I N D I E N M A L C H A N C E U X Q U I D E V I N T M I L L I A R D A I R E
Vikas Swarup - 2005
France Loisirs - 444 pages
17/20
Leçons de vie indiennes
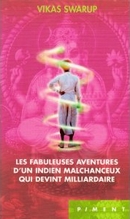 Ram Mohammad Thomas, jeune homme de dix-huit ans issu des bidonvilles de Dharavi et orphelin, a remporté le gain ultime dans la version indienne du jeu télévisé bien connu Qui veut gagner des millions ?, soit un milliard de roupies.
Ram Mohammad Thomas, jeune homme de dix-huit ans issu des bidonvilles de Dharavi et orphelin, a remporté le gain ultime dans la version indienne du jeu télévisé bien connu Qui veut gagner des millions ?, soit un milliard de roupies.
Accusé d'une tricherie qu'il n'a pourtant pas commise, Ram est interrogé au début du roman par des policiers aux manières peu cavalières. Comment un pauvre gamin des rues, à priori ignorant et inculte, a-t-il pu répondre sans erreur à douze questions de culture générale ?
Une avocate, Smita, prend alors sa défense et décide de visionner avec lui l'enregistrement du jeu. C'est l'occasion pour Ram de peindre le récit de sa jeunesse et de démontrer point par point sa connaissance des réponses justes aux douze questions...
L'auteur a ainsi construit son histoire en autant de chapitres que le jeu comporte d'épreuves. Cette série d'épisodes de la vie de Ram ne sont pas présentés dans un ordre chronologique mais des recoupements permettent au lecteur de relier les personnages et les situations évoqués dans l'ensemble du roman.
Ram nous présente ainsi tout d'abord son meilleur ami, Salim, un « fou de cinéma hindi » grâce à qui il acquerra quelques connaissances cinématographiques.
Remis au père Timothy à sa naissance, il explique également que son nom complet est autant hindou que musulman ou chrétien montrant ainsi la pluralité des religions en Inde. L'assassinat du père Timothy témoigne de la dure réalité de la vie dans cet immense pays, à la fois lumineuse par ses couleurs, bruits, senteurs et mouvements et dramatique par sa pègre, ses maladies, son extrême pauvreté et ses drames quotidiens.
Ram vivra ensuite pendant un certain temps dans un « chawl » : « Clapiers composés de logements d'une seule pièce, occupés par les classes moyennes aux revenus modestes, les chawls sont le dépotoir de Mumbai. »
Séparé par une cloison à peine plus épaisse que celle du carton du logement contigu, l'orphelin partagera indirectement la vie terrible que mène Gudiya, sa jeune voisine, dont le père Mr Shantaram a sombré dans l'alcool et ses vices après avoir raté sa carrière d'astronome. À nouveau, le lecteur pourra faire le lien entre les quelques notions d'astronomie de Ram et la bonne réponse à la question portant sur le nom de la plus petite planète de notre système solaire.
Chaque chapitre est ainsi un nouvel épisode, une histoire dans l'histoire ; et celle de l'orphelinat tenu par un homme nommé Maman est particulièrement sordide... Avec la promesse d'une vie meilleure et profitant de leur crédulité, Maman et ses hommes récupèrent les enfants des rues pour leur enseigner quelques notions de musique et leur apprendre à chanter. Ils les mutilent ensuite physiquement et les obligent à aller mendier en échange d'un toit et d'un peu de nourriture.
Échappé de cet enfer, Ram connaît heureusement des moments plus paisibles en devenant le domestique de la ravissante Neelima Kumari, une célèbre actrice tombée dans l'oubli.
Mais à nouveau, des rebondissements tragiques viendront l'endurcir toujours plus... Il sera ainsi attaqué dans le Paschim-Express, train à destination de Mumbai, après avoir caché cinquante mille roupies honnêtement gagnés dans son slip.
Enfin, ce roman initiatique se termine sur un site grandiose : celui du splendide Taj Mahal ou « Mumtaz Mahal » en persan pour « la lumière du palais ». Là, Ram gagnera sa vie en devenant guide.
L'écart entre l'histoire véridique racontée par les guides officiels et l'interprétation du jeune homme déversée à des touristes naïfs est source de quiproquos amusants. Mais, même déformées, ses connaissances s'avéreront finalement utiles dans le jeu télévisé.
Ram va également rencontrer le grand amour dans les bras d'une prostituée prénommée Nita. Malheureusement, à côté de cette passion naissante, il fera une fois de plus la douloureuse expérience de l'injustice à laquelle doivent se plier les pauvres de son pays. Son grand ami Shankar, jeune autiste auquel il s'est lié d'amitié, devient la victime d'une terrible maladie par simple manque d'argent.
La fin du récit permet de relier plusieurs épisodes de sa vie et explique les raisons qui ont poussé Ram à participer au jeu télévisé. Prem Kumar, son présentateur vedette et ancien acteur de série B, est en effet intimement lié aux souffrances imposées aux amies de Ram...
Vikas Swarup, l'auteur, est un diplomate indien. Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire est son premier roman. Il a été traduit dans plus de quarante langues et a connu un immense succès dans le monde entier en remportant de nombreux prix littéraires.
L'originalité de cette aventure est évidemment une part de la clé du succès. Il faut aussi y rajouter une fresque vivante de l'Inde, beaucoup d'émotion et des pointes d'humour pour combattre le malheur qui semble poursuivre sans cesse les communautés démunies des bidonvilles.
Enfin, notons que cette histoire aux thèmes universels se termine par une belle morale sur le bonheur et le pouvoir de l'argent.
En 2008, le livre a été adapté au cinéma par Danny Boyle sous le titre Slumdog Millionaire. Le film ne suit pas de manière fidèle le roman et le réalisateur a pris de nombreuses libertés. Néanmoins, c'est un magnifique spectacle tant sur le plan visuel que musical avec une bande originale vibrante et très colorée. Un film parfaitement maîtrisé, au rythme nerveux, et qui vient compléter de façon tout à fait idéale le livre.
[Critique publiée le 18/07/13]

L E N I D D U S E R P E N T
Pedro Juan Gutiérrez - 2006
10/18 - 287 pages
16/20
“On s'habitue à tout. Ou tu t'adaptes, ou tu crèves”
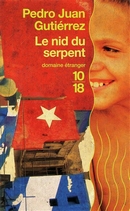 Le titre de la chronique, fruit d'une réflexion émise par le narrateur lors d'un service militaire particulièrement difficile, répond plutôt bien aux vicissitudes de la vie. Et la vie pour lui n'a pas été un long fleuve tranquille...
Le titre de la chronique, fruit d'une réflexion émise par le narrateur lors d'un service militaire particulièrement difficile, répond plutôt bien aux vicissitudes de la vie. Et la vie pour lui n'a pas été un long fleuve tranquille...
Sa jeunesse, racontée ici, se déroule dans le Cuba des années 60. Pedro galère dans les quartiers pauvres de Matanzas et rêve de trouver la clé qui le mènera à la richesse.
En cette période, ainsi que le laisse transparaître le récit, Cuba est en pleine débandade économique et sociale. Fidel Castro a renversé le dictateur Manuel Urrutia en 1959 et pris le pouvoir. Son gouvernement socialiste est en désaccord avec l'impérialisme américain et c'est vers l'Union Soviétique qu'il se tourne. Les États-Unis recueillent les exilés cubains et certains compatriotes de l'auteur quittent ainsi leur pays d'origine.
Pour beaucoup de cubains, la vie s'improvise au jour le jour. L'auteur, lui, se réfugie dans le sexe et la violence : « A ce stade, j'avais définitivement le vice dans la peau. J'étais un séducteur accompli et maladif. Je consacrais l'entièreté de mon temps et de mon énergie à séduire et à baiser. Tout ce qui bougeait. Depuis la charogne la plus pourrie jusqu'à la poulette la plus exquise. Je ne faisais pas de distinction. Toutes les femmes m'attiraient, laides et jolies, plates ou avec des seins énormes, fessues ou non, blanches et noires avec toute la gamme intermédiaire, grandes ou basses du cul, romantiques et caressantes ou vulgaires et toxiques. Épouses fidèles et nymphos dépravées. C'était une obsession incontrôlable, mais je crois que je n'étais pas le seul : à mon avis, c'était ça, le vrai sport national. »
Il confie également son attrait pour la littérature et donne une vision intéressante du processus de création chez l'écrivain.
Ce roman autobiographique est au final une succession d'aventures, souvent glauques et décadentes, où le sexe et la perversion donnent finalement son seul sens à cette vie qui paraît foutue d'avance.
L'écriture de Pedro Juan Gutiérrez est incisive, provocatrice, efficace, moderne et parfois très crue. Il livre une tranche de vie qui vient nous percuter avec violence et étale sans tabou ses états d'âme tourmentés.
Un dernier extrait qui témoigne de ce désir de s'instruire malgré une vision fataliste de la vie : « Parfois, j'enviais les autres, ceux qui ne lisaient pas. Ma vie devenait trop compliquée à force d'essayer de comprendre tous ces bouquins. Je nageais dans l'angoisse alors que les autres dérivaient tranquillement le long des jours. Moins on réfléchit, mieux on se porte. Sauf que chacun reçoit sa part de merde, de toute façon. Qu'on lise ou pas, qu'on pense ou non, qu'on soit un génie ou un analphabète. Ce qui te revient t'attend au tournant. »
[Critique publiée le 26/10/11]

V A L P A R A D I S
Alain Jaubert - 2004
Gallimard - 436 pages
20/20
Lisez ce qui suit, oubliez tout le reste... Et embarquez ! Attention, chef-d'œuvre
 Val Paradis... Le parfum de la nostalgie... L'aventure maritime... Le port du bout du monde... L'ivresse des sens...
Val Paradis... Le parfum de la nostalgie... L'aventure maritime... Le port du bout du monde... L'ivresse des sens...
Un chef-d'œuvre absolu, un joyau, un roman qui peut se lire et se relire sans cesse tant il est évocateur de merveilles, tant il remplit avec perfection et simplicité son rôle premier de livre : faire rêver.
Le pari est réussi. Complètement. Totalement.
Après ma première lecture, je n'ai pu migrer vers d'autres nourritures : je m'y suis replongé de la première à la dernière page.
Jamais auparavant je n'avais été aimanté à ce point par une œuvre littéraire. Jamais je n'avais autant dégusté chaque chapitre, chaque page, chaque ligne et chaque mot.
Par quoi sont justifiés tant de superlatifs, tant d'emphase me demanderez-vous...
Tout simplement par le fait que Val Paradis est splendide dans le fond et dans la forme. Une dualité rare ; alors autant la signaler haut et fort.
Antoine est un jeune pilotin (apprenti officier) de dix-huit ans. Neuf mois auparavant, il a embarqué à bord du LEOPARD, un navire de commerce basé à Marseille qui fait du tramping (navigation de port en port au gré du fret à transporter).
Roger, son compagnon de chambre, vingt ans, va rapidement devenir son complice et ensemble ils vont se fixer le même objectif à chaque escale : « Tout parcourir. Tout voir. Tout dévorer. »
Et en cette fin d'année 1958, leur bateau accoste le port mythique de Valparaíso pour une durée de vingt-quatre heures. Surnommé le « port du vent », le « port souvenir », « le port des brouillards », la « perle du Pacifique » ou encore le « port nostalgie » dans l'imagerie populaire, Valparaíso est incontestablement le personnage principal du roman tant la ville y est disséquée, analysée, décrite, visitée.
Paradoxalement, cette impression de la parcourir entièrement en donne une image des plus mystérieuses. Valparaíso, la mythique, demeure-t-elle un rêve inaccessible...?
« L'escale, aujourd'hui, Valparaíso ! Port de légende. La chasse à la baleine, les peaux de phoques, la course du thé, la route d'Australie, le chemin de Polynésie, la ruée vers l'or californien, les tremblements de terre, les mines de cuivre, le salpêtre, Robinson Crusoé. Et, 1500 milles plus au sud, les archipels, les glaciers, les canaux de Patagonie, le détroit de Magellan, le Horn, ses tempêtes furieuses. »
Voilà comment Jaubert plante le décor.
Un décor évocateur qui, en quelques lignes, nous fait déjà parcourir des milliers de kilomètres et miroiter des aventures fabuleuses. Des promesses qui seront justement tenues au cours des différents chapitres.
Antoine, en ce début d'été austral, est impatient de poser le pied dans la ville qui, selon les légendes, comporte un seul quai et cent bordels. Car, comme on l'oublie peut-être : « Les terriens ont du mal à imaginer que l'essentiel de la navigation, c'est du sommeil. [...] On s'ennuie. On lit. On rêve. » Et la perspective de l'escale est l'occasion de « laisser surgir les gens et les événements au hasard, et, là aussi, aller jusqu'au bout de toutes les aventures même si elles sont vulgaires, même si elles sont dangereuses ».
Jaubert parle de « L'art de l'escale », un processus méthodique pour parcourir la ville et ses différents lieux de perdition selon un cycle précis. Il ne faut surtout pas se perdre dès le début car les quelques heures à terre ne doivent pas être consommées dans le premier troquet crasseux. Les longues semaines en mer qui précèdent et succèdent à l'escale sont là pour rappeler au marin l'importance d'être alerte le jour J pour jouir pleinement de toutes ces formes, couleurs, odeurs et bruits qui l'assaillent soudain.
Par ailleurs, dans notre monde de fous où la vitesse est toujours recherchée, la philosophie d'Antoine pour visiter un nouveau lieu est un rappel au bon sens. Seule la marche permet de « lire » une cité dans ses moindres détails. Et le narrateur de rappeler son objectif : « Se greffer la forme d'une ville dans la mémoire des jambes et des pieds » ; ou plus loin : « J'aime les villes, j'aime marcher dans les villes connues ou inconnues, sans savoir ce que je cherche, sans savoir où je vais, poussé par une sorte de désespoir heureux. »
Une grande partie du roman relate ainsi la découverte de Valparaíso par Antoine, conseillé par son ami Roger qui y est déjà venu à deux reprises.
C'est la cité des « cerros », ces quarante collines sur lesquelles est bâtie la ville.
C'est le mouvement perpétuel des funiculaires.
C'est les maisons multicolores « construites avec les restes d'anciens naufrages » (plus de trois cents dans la baie paraît-il).
C'est des escaliers à n'en plus finir.
C'est des milliers de chiens errants.
C'est l'âne utilisé pour gravir les durs dénivelés.
Et puis, Valpo, c'est une esplanade sur l'océan Pacifique : « Cinq mille kilomètres de vide en face de moi... » dixit le narrateur.
« Et je regarde la belle et extravagante cité, courbe parfaite sur la mer bleue, le moutonnement de ses collines échevelées ceinturant la baie comme un écho, un reflet dans le miroir de la terre des lames du Pacifique les jours de tempête. Valparaíso, la "vallée du paradis". »
Que rajouter à cette écriture, aussi somptueuse à chaque page ?
Les deux compères recherchent l'immersion la plus totale et leur amour des sonorités étrangères est ici comblé par la visite d'un marché où les almejas, ostras, langostinos, calamares, trucha, salmón, corvina ou albacoras seront autant de nouveaux mots espagnols rapidement intégrés à leur vocabulaire.
Mais comment résister à citer la description d'une dégustation d'oursin par l'auteur, tant celle-ci titille les papilles à la simple lecture : « Je prends un oursin, je plonge ma petite cuiller dans un corail exubérant. Je soulève, je détache la chose délicate. Ça sent l'iode et l'algue et l'eau de mer, comme les flaques à marée basse, et aussi la peau humaine et la sueur amoureuse et le gâteau fin. La cuillérée fond dans la bouche, c'est à la fois sucré et un peu salé, les petits grains s'écrasent sous les dents, sur la langue, se liquéfient en une molle et savoureuse pâtisserie, et on a aussitôt envie d'y revenir. On y revient. »
L'aventure d'Antoine, c'est aussi le fantasme de Paola. Paola, cette jeune fille de rêve, « fine fleur de la grande bourgeoisie chilienne », cousine de son ami Roger et à l'initiative de délicieuses aventures lubriques avec celui-ci lors d'une précédente visite au pays.
Paola sera un fil directeur durant cette trop courte escale, un rêve qui reviendra sans cesse à l'esprit d'Antoine. Son absence, sa suggestion à travers les descriptions osées de Roger ne feront qu'alimenter les espoirs les plus fous du jeune pilotin : « Paola m'intrigue. Paola m'attire. Paola m'appartient désormais autant qu'à lui. »
Ce livre est une histoire de rencontres.
Flâner au hasard des rues pittoresques de la cité chilienne et se laisser entraîner par les histoires des habitants. Un architecte, un étudiant, un ancien cap-hornier nourriront l'esprit curieux d'Antoine. Cet habile procédé littéraire permet ainsi à Jaubert de nous conter des histoires dans l'histoire, sorte de palimpseste propice à un foisonnement de situations tout aussi rocambolesques et épiques les unes que les autres.
La dure navigation des bateaux à voile qui devaient impérativement franchir le cap Horn bien avant la construction du canal de Panamá, la riche description de la pointe de l'Amérique et sa géographie « la plus compliquée de toute la planète », les catastrophes naturelles qui ont façonné les collines de Valparaíso, la folie du périgourdin Antoine Tounens qui s'était autoproclamé Orélie-Antoine Ier, roi d'Araucanie, ou le parcours du français Emile Dubois, un meurtrier multirécidiviste devenu un saint à sa mort. Voilà des thèmes riches, passionnants et historiques, contés toujours avec maestria, qui nous font mieux entrevoir les essences mythiques du port chilien...
L'aventure maritime passe aussi par les livres et leurs légendes distillées au cours des longues traversées où le marin se retrouve souvent seul et bien embarrassé devant tant de temps à tuer avant la prochaine escale. Alain Jaubert nourrit son texte de références : à travers Paola qui était passionnée par la poésie espagnole et clamait des vers de Jean de la Croix, Góngora ou Quevedo. Dans la bibliothèque du LEOPARD où les ouvrages relatant les découvertes de Colomb, Vasco de Gama, Cortès, Cook, Bougainville, La Pérouse ou Dumont d'Urville foisonnaient. Dans l'imagination d'Antoine où les écritures de Rimbaud et Baudelaire refont surface pour décrire la beauté d'une femme.
Jules Verne, Daniel Defœ, Melville, Whitman ou Céline seront aussi cités. Jaubert ne cache d'ailleurs pas ses influences dans son travail d'écriture et cite volontiers Melville, Conrad comme des maîtres.
Mais la nourriture de l'esprit doit trouver écho dans celle du corps. Et Antoine résume parfaitement cet antagonisme en se posant la question existentielle : « La bibliothèque ou le bordel ? »
Le port des cents bordels regorge de lieux de débauche et les deux marins en visiteront plusieurs pour garder le meilleur pour la fin : le Kentucky. Antoine y rencontre Macha : « C'est comme si tout s'était illuminé d'un coup. » Après quelques pas de danse au son de Chet Baker, c'est la montée vers une « ivresse marine ». Mais chut, nous n'en dirons pas davantage...
Et le délice continue encore pendant un long moment puisque la seconde moitié du livre reste à découvrir ! La nuit est intensément longue en cette avant-veille de Noël 1958.
Comme précisé au tout début, n'oublions pas de louer la forme de ce roman.
L'écriture est érudite, dense et pourtant si simple à lire. Les phrases sont joliment chaloupées, parfaitement équilibrées. De la plus courte qui mesure un seul mot à la plus longue qui s'étale sur plusieurs pages lors du délire d'Antoine, Val Paradis est un laboratoire littéraire où l'auteur casse les codes classiques pour aboutir à un style totalement libre, en harmonie avec les luxures ou les débauches de cette aventure.
Là où de nombreux auteurs contemporains pêchent par la platitude et la médiocrité de leur artisanat, Alain Jaubert excelle dans son exercice tant chaque page fourmille de détails, de profondeur et de profusion des sens.
Tel un orfèvre, il manipule la langue française avec autant de minutie et de dextérité qu'un horloger le ferait avec les rouages d'une antique montre gousset.
La particularité de l'œuvre réside également dans le découpage des chapitres. L'histoire principale, cette parenthèse de quelques heures au Chili, est entrecoupée de cinq aventures qui nous transportent vers d'autres contrées lointaines parcourues lors d'escales précédentes sur le trajet du LEOPARD.
C'est l'occasion rêvée pour affronter les tempêtes de l'Atlantique ou revivre l'éruption meurtrière de la montagne Pelée en Martinique le 8 mai 1902.
La découverte de la baie de New York et la participation impromptue à une virée en concert avec des musiciens de jazz, dont John Coltrane - excusez du peu - à bord d'une vieille Buick décapotable est un riche moment d'émotion. La palette d'Alain Jaubert pour décrire les notes de jazz est aussi riche que celle mise en exergue pour affoler notre sens gustatif lors de la mise en bouche d'un oursin...
Et n'oublions pas enfin le mythe de Robinson revisité à travers cette histoire d'amour sur une île déserte du Brésil où les « plages de sable d'un blanc éclatant bordées par des eaux très bleues » ne laisseront aucun lecteur indifférent.
Jaubert, véritable poète, y décrit la femme posée en ce lieu paradisiaque avec les termes : « Elle avait hérité de l'Europe des lèvres fines et un nez long et droit, de l'Afrique, les cheveux crépus, qu'elle portait longs et nattés, de l'Amérique les nuances cuivrées de sa peau noire. »
Si après cette humble présentation vous n'êtes toujours pas tenté par une excursion dans la « vallée du paradis », lisez au moins le chapitre d'introduction qui, dès la première phrase, plante de façon extraordinaire l'atmosphère du voyage... Telle une ouverture d'opéra, le lecteur est happé, enchanté par les promesses que l'auteur lui susurre au creux de l'oreille : « une nuit de marins et de mirages, une nuit de filles, de came, d'aventures, d'escaliers, de saouleries à n'en plus finir. »
Val Paradis a raté de justesse le Goncourt 2004, en arrivant second, mais a remporté tout de même les beaux prix suivants :
Prix du Premier Roman du Touquet Paris Plage (2004)
Goncourt du Premier Roman (2005)
Prix Livre & Mer Henri-Queffélec (2005)
Prix Maison des écrivains de Touraine « Esprit Grandgousier » (2005)
Prix Gironde Nouvelles Ecritures (2005)
Il est incontestable que si le prix Makibook existait, le Maki d'Or serait à rajouter au palmarès précédent. Mais le plus important ne réside certainement pas dans ces distinctions littéraires parfois trop teintées de snobisme intellectuel ; non, le fait majeur à mes yeux est d'avoir enfin, à ce jour, trouvé ma réponse à la sempiternelle question de Proust : « votre livre préféré ? »
Qui est donc Alain Jaubert ?
Né en 1940, l'homme a de multiples casquettes et une vie bien remplie.
Son œuvre la plus célèbre reste à ce jour une série de cinquante films sur l'art intitulée Palettes et réalisés entre 1989 et 2003. À travers ces émissions, le réalisateur a décrypté de nombreuses œuvres picturales et vulgarisé ainsi l'accès à la peinture.
Avant d'écrire Val Paradis, Alain Jaubert a été marin, journaliste scientifique à La Recherche, chroniqueur de musique classique à Libération ou encore enseignant à l'Ensad (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs).
Il a également réalisé de nombreuses autres émissions sur les thèmes de la peinture, de la littérature, de la philosophie et publié plusieurs essais et traductions.
En 2004, avec Val Paradis, il écrit son premier roman. En réalité, ce travail d'écriture s'est étalé sur plusieurs décennies et certaines escales du LEOPARD avaient déjà été rédigées il y a de nombreuses années sans être publiées.
Le roman est ainsi une forme d'aboutissement littéraire d'une vie intellectuellement riche et d'une sensibilité artistique exceptionnelle.
[Critique publiée le 16/12/10]

T A B L E A U X N O I R S
Alain Jaubert - 2011
Gallimard - 467 pages
19/20
Madeleines de Proust chez Alain Jaubert
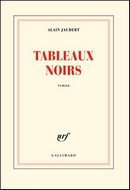 À l'âge de soixante-quatre ans, en 2004, Alain Jaubert a réalisé un vrai tour de force littéraire avec son premier roman intitulé Val Paradis dont je suis un inconditionnel.
À l'âge de soixante-quatre ans, en 2004, Alain Jaubert a réalisé un vrai tour de force littéraire avec son premier roman intitulé Val Paradis dont je suis un inconditionnel.
Depuis, chacune de ses créations est attendue avec gourmandise, ferveur et un peu de crainte aussi. En effet, cette perfection, cet équilibre, cette osmose atteints dans ce roman ayant pour cadre Valparaíso peuvent difficilement être à nouveau réalisables ! Cet écrivain n'a déjà plus rien à prouver quant à sa maîtrise de la narration, son savoir-faire pour emporter le lecteur à l'autre bout du monde et le faire s'évader dans un imaginaire digne de Melville.
Mais le spécialiste de peinture classique a encore pléthore d'histoires à raconter, de souvenirs à évoquer (il possède plus de trois mille pages de carnets manuscrits qu'il a consciencieusement remplis depuis sa jeunesse). Et Tableaux noirs fait partie de ces très belles images qu'il a souhaité nous faire partager.
Ici, pas de voyage à l'autre bout du monde, sauf si l'on considère Trégastel comme un lieu exotique, chose parfaitement acceptable tant la description du lieu où le narrateur est allé en vacances est féérique (et véridique aussi selon moi).
En réalité, ce pavé nous fait essentiellement voyager dans le Paris des années 40 et 50, à travers les yeux d'un petit bonhomme. Antoine Chabert, au nom presque paronyme de celui de l'auteur, est né lui aussi en 1940. Dans Val Paradis, le lecteur suit d'ailleurs les péripéties d'un Antoine, sans doute le même des années plus tard...
Tableaux noirs navigue entre autobiographie et fiction pour le plus grand plaisir du lecteur qui entre donc quelque peu dans l'intimité de l'auteur et se voit à nouveau confirmer la grande sensibilité dont ce dernier avait fait preuve dans son premier récit.
J'avoue avoir eu quelques réticences en lisant les premiers chapitres qui exposent de manière disparate, mais néanmoins chronologique, les premiers épisodes de vie d'un nourrisson puis d'un enfant en bas-âge. Mais au bout d'un moment, la magie opère parfaitement : le lecteur s'attache au fil des pages à ce petit Antoine et grandit tout doucement avec lui.
Je me suis même reconnu à plusieurs reprises dans le comportement et les attitudes de cet enfant ; cela explique peut-être en partie mon attachement à l'œuvre de cet écrivain, à sa façon de voir, d'aborder et de sentir le monde... L'adulte Alain Jaubert n'est-il pas construit sur les bases de l'enfant qu'il a été ?
L'auteur nous raconte ainsi ses premiers pas dans le quartier des Champs-Élysées où il a grandi, chose difficilement imaginable de nos jours tant le marché de l'immobilier a évolué - dans le mauvais sens - depuis soixante-dix ans !
Et à travers les yeux d'un enfant, le monde entier devient source d'émerveillement. Un événement anodin peut être empreint de poésie ou carrément vécu de manière totalement disproportionnée. Alain Jaubert réussit ce tour de force et nous fait vivre une succession d'épisodes joyeux, nostalgiques, émouvants, tristes, drôles ou dramatiques.
Un passage qui m'a marqué se déroule lorsque Antoine entend la chute d'une bombe allemande de type V1 dans la campagne parisienne. Le pauvre découvrira peu après des dizaines de vaches mortes et un trou immense, symbole de la bêtise humaine.
J'ai aussi tremblé devant le loup, cet animal emblématique des peurs enfantines. En vacances dans la Forêt-Noire chez son oncle militaire et parachutiste, le garçonnet est persuadé de voir des loups à la tombée de la nuit. Et en effet, l'oncle, malgré ses doutes quant à la présence de tels carnassiers, descendra avec son fusil pour réapparaître avec la dépouille d'un « énorme loup gris ». Un peu plus tard, ce même oncle essaie le revolver italien du père d'Antoine. Le croyant grippé ou déchargé, il vise l'enfant en rigolant dans l'appartement parisien mais le coup partira vraiment : « La balle passe en sifflant à ses oreilles. » Grosse frayeur !
J'ai frémi quand, à dix ans, avec des copains sur les plages du côté d'Ostende, il joue avec des explosifs après avoir découvert une caisse de grenades allemandes. Les canailles finiront par un grand feu d'artifice en les faisant toutes exploser ensemble !
Côté fraternel, j'ai particulièrement aimé les rapports entre Antoine et sa sœur de deux ans sa cadette.
Coïncidence ou pas, Alain Jaubert a passé des vacances sur la Côte de Granit Rose où je suis né et ai vécu de très nombreuses années. Les mots, les phrases décrivant ce coin de paradis ont donc particulièrement résonné en moi...
Les quelques images, posées ci-après avec délicatesse, décrivent parfaitement l'ambiance de ce splendide lieu de la Bretagne costarmoricaine ; elles résonnent de la même façon que les notes de piano de Didier Squiban lorsqu'il évoque son pays : « Ils font le tour de la maison. De l'autre côté, pas de route, juste un étroit chemin et, au-delà du chemin, rien, le vide du ciel et des nuages, une immense baie, sables, vase, rochers lointains, des barques de pêche échouées penchées sur le côté, pas d'eau, c'est marée basse, seulement la gifle du vent qui apporte l'odeur de la mer. »
Et bien sûr, je ne peux pas ne pas citer la description du Château de Costaérès : « Un chaos de rochers couverts d'algues vertes et brunes à perte de vue, quelques pêcheurs à pied dans les flaques, la côte de l'autre côté et, au milieu de la baie, à sec sur son île, un château de granite rouge lui aussi, un vrai castel de conte de fées avec ses tours élevées, ses toits d'ardoise, ses étroites fenêtres en ogive. Tout ça, c'est aussi beau que la baie de Rio, dit son père. Et avec ce château gothique en plus ! »
Avec la référence à Rio, dont les guides touristiques devraient s'inspirer, la boucle est bouclée : l'exotisme est de chaque côté de l'Atlantique...
Plus loin, le roman m'a particulièrement touché dans ce passage racontant la présence des « gueules cassées » dans le Paris d'après-guerre et ce jusqu'aux années 60. Ces héros qui ont survécu à la première guerre mondiale et qui sont peu à peu tombés dans l'indifférence générale apparaissent alors pour Antoine sous la forme de « monstres de légende », d'« écorchés de danse macabre », « d'affreuses momies de cinéma » qui « peuvent surgir à tout moment ».
Ou encore, voici un exemple des questions presque métaphysiques que ces rescapés suscitaient chez le commun des mortels : « On essaie de deviner où est la frontière entre la vraie et la fausse chair, entre l'os et la dent, entre le poil et le moulage, entre l'œil vivant et l'œil de verre, on se demande comment ça s'ajuste, s'ils dorment avec, si ça fait mal, comment ils se voient dans leur miroir, comment leur famille s'y est habituée. »
A ce sujet, Marc Dugain a d'ailleurs écrit un livre très émouvant intitulé La chambre des officiers.
Enfin, comme il le prouvera plus tard dans ses écrits, l'homme de lettres est enfant déjà fasciné par la musicalité des mots. C'est le cas par exemple lorsqu'il entend sa mère et sa grand-mère évoquer ensemble leurs prochaines collections de mode à travers un champ lexical éloquent : « guipure », « satin », « jupon », « taffetas », « organdi », « fourreau », « liseré », « corolle », « tulle », « plastron », « paillettes », « cachemire », ...
Et Jaubert de rajouter : « Tous ces mots sont comme des bijoux délicats, des joyaux de conte de fées, ils brillent devant ses yeux, trésors éblouissants, petits mystères égrenés au fil de phrases qui le bercent. »
Tout cela va évidemment conduire, après l'apprentissage de la lecture, à la rencontre avec un objet qui bouleversera à tout jamais la vie d'Alain Jaubert : le livre.
Pendant que les autres enfants collectionnent des billes, écussons, boîtes d'allumettes, capsules de bouteilles, petites voitures, timbres, cartes postales ou minéraux, Antoine se tourne vers celui qui deviendra vite le meilleur ami de son esprit : « En fait, après des années d'expérimentation au cours desquelles il a essayé quelques pistes et s'est lassé de tout, il s'aperçoit qu'il n'aime amasser qu'un seul objet. Un objet dont la collection est, elle aussi, infinie, au point que personne ne pourra jamais en venir à bout. Un objet qui ne se dévalue pas, dont on ne se fatigue jamais et qui vous surprend toujours. Le livre. Lire et accumuler les livres ? Oui, seuls amis dociles, fidèles, silencieux, toujours disponibles, merveilleux... »
Rapidement, le garçon s'évade dans la littérature et avale tout ce qu'il peut : « Tout un monde magique s'ouvre. [...] Le début d'une folie qui durera toute sa vie. »
Ses amis, durant de nombreuses années, s'appelleront Jules Verne (dans l'édition Hetzel !), Miguel de Cervantès, Carlo Collodi, Charles Dickens, Daniel Defœ, Alexandre Dumas, Victor Hugo, François Rabelais, Pierre de Ronsard ou Joachim du Bellay.
« Les auteurs sont ses seuls amis » écrit le romancier en parlant du petit garçon qu'il fût jadis.
Là encore, toutes ces réflexions sur la puissance de la littérature ont totalement résonné en moi. À nouveau, je ne peux que citer l'extrait suivant qui se passe de tout commentaire : « Il est acharné de lecture, curieux de tout. Chaque minute qu'il peut grappiller, il en profite. N'importe où, n'importe comment. Au lit, aux toilettes, en train, en métro, dans un grenier, sur l'herbe l'été, contre un tronc d'arbre, en marchant même, dans les chemins forestiers, dans la rue. Le mieux, c'est assis au fond d'un canapé au milieu des coussins, ou par terre, bien coincé entre deux meubles. Dans un lieu discret où personne ne viendra le déranger. Recroquevillé, les autres sens en veilleuse, les yeux seuls en action. Il s'enfonce dans la lecture, un paradis qu'on ne partage pas. Nonchalance, alternances d'éveil et de somnolence, temps sans limites. Cette vie-là est plus intense que la vraie vie... Et l'été, au bord de la mer, au fond d'une villa, bercé par le bruit lointain et hypnotique des vagues. Il lit toute la nuit, termine un livre, en commence un autre, même aux approches de l'aube, finit par s'endormir avec les premiers rayons du soleil. Quitter un livre pour un autre n'est pas une trahison, c'est une façon de prolonger, de renouveler l'excitation de sa pensée. »
« On dit dévorer un livre. C'est lui qui vous dévore ! C'est comme si le livre le lisait lui, l'avalait, l'absorbait... »
Et cet amour infini pour la littérature va très loin puisqu'il constitue sa bouée de sauvetage lorsque, préadolescent et renvoyé pour d'obscures raisons de son collège, il devient pensionnaire dans un redoutable établissement religieux où la discipline rigoureuse se décline en brimades quotidiennes. Alain Jaubert a certainement été vacciné contre l'abus de religion tant il a souffert sous le règne des prêtres professeurs qui prônaient pourtant l'amour du prochain...
Le petit Antoine s'enferme ainsi dans son imaginaire qui est le seul endroit où s'exprime sans aucune limite la liberté : « La messe ou les autres manifestations religieuses, vêpres, actions de grâces, sont pour Antoine d'un ennui écrasant, il est devenu expert en hypocrisie, il fait tous les gestes nécessaires mais il se barricade en lui-même, il se récite du Ronsard ou du Baudelaire. »
Ce pavé est rempli d'une multitude de détails, de pensées, de situations anodines ou d'événements majeurs dans la construction d'un jeune garçon. Il est impossible d'évoquer tous les sentiments que cela peut éveiller chez le lecteur ; d'autant que de nombreuses grilles de lecture sont possibles selon chacun : traité de psychologie de la petite enfance, plaidoyer pour la lecture, parcours bucolique de la France en pleine reconstruction, remontée du temps introspective dans les souvenirs d'un écrivain, ...
Concluons sur ces mots qui en disent long et qui, à nouveau, se passent de commentaire : « La lecture, l'écriture, la littérature, c'est ça l'or, le trésor, tous les trésors du monde... »
[Critique publiée le 11/06/14]

L ' A M A N T
Marguerite Duras - 1984
Les Editions de Minuit - 142 pages
9/20
Snobisme littéraire ?
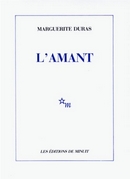 C'est l'histoire d'une jeune fille de quinze ans, française, installée en Indochine avec sa famille composée de sa mère et de ses frères.
C'est l'histoire d'une jeune fille de quinze ans, française, installée en Indochine avec sa famille composée de sa mère et de ses frères.
L'adolescente, scolarisée au pensionnat de Saigon, noue une relation tumultueuse avec un riche chinois bien plus âgé qu'elle. Cette passion dévorante se vivra en cachette pour les amants, à l'ombre des persiennes d'une garçonnière.
Dans la chaleur moite de la colonie française, pendant les années 20, la narratrice traverse ainsi la difficile période de l'adolescence entre la découverte de l'amour et la lutte au sein du clan familial contre son frère, véritable tyran envers ses proches.
Ce livre autobiographique de Marguerite Duras a obtenu le prix Goncourt et est devenu un succès mondial. Jean-Jacques Annaud en a d'ailleurs réalisé une magnifique adaptation cinématographique en 1992 avec Jane March dans le rôle principal. Cependant, le livre m'a déçu. J'ai été totalement dérouté par le style littéraire de Marguerite Duras. Je n'ai trouvé aucune unité de temps dans des paragraphes oscillant entre les quinze ans et les dix-huit ans de l'héroïne. Cela donne l'impression d'un mélange, d'un brouillon de roman.
Quelques phrases sont certes belles mais le thème de l'amour fou dans cet univers tropical pourrait être traité avec davantage d'audace et de concision. Les dialogues sont inexistants et sont uniquement descriptifs, occasionnant de nombreuses répétitions du genre « il dit » ou « elle dit ». Tout cela mène à un alourdissement des tournures.
Duras, c'est sans doute comme Proust : on adore ou alors on s'ennuie. Pour ma part, c'est plutôt l'ennui qui a dominé au cours de la lecture. La prochaine fois, je me contenterai de revoir le film...
[Critique publiée le 07/07/09]

L E C H A N C E L L O R
Jules Verne - 1874
Le Livre de Poche - 288 pages
17/20
Un huis clos maritime éprouvant
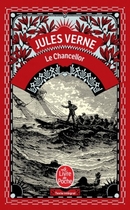 Au XIXe siècle, un trois-mâts portant le nom de Chancellor quitte le port de Charleston situé en Caroline du Sud. Il doit traverser l'océan Atlantique afin de rejoindre la ville de Liverpool en Angleterre et transporte à son bord une cargaison de coton ainsi qu'un équipage de quatorze marins et huit passagers.
Au XIXe siècle, un trois-mâts portant le nom de Chancellor quitte le port de Charleston situé en Caroline du Sud. Il doit traverser l'océan Atlantique afin de rejoindre la ville de Liverpool en Angleterre et transporte à son bord une cargaison de coton ainsi qu'un équipage de quatorze marins et huit passagers.
Parmi ces derniers, J.-R. Kazallon tient un journal de la traversée et devient ainsi le narrateur de cette histoire qui s'avère terrifiante. Dès le début, il remarque en effet que le cap du navire vers le sud, décidé par le capitaine, ne semble pas cohérent avec la direction attendue vers l'orient. Ce capitaine paraît d'ailleurs ne pas avoir toute sa tête et est totalement perdu lorsqu'il doit faire face à un incendie dans la cargaison de coton.
Le Chancellor s'échoue finalement sur un mystérieux îlot basaltique qui n'est mentionné sur aucune carte. Dès lors, devant le courage fuyant du capitaine, c'est le solide Robert Kurtis, second du navire, qui prend le commandement.
Les semaines passent, les vivres s'épuisent, les tensions montent et le bateau bloqué sur son île doit faire face à une tempête...
Un radeau construit dans des conditions périlleuses devient alors le seul et unique espoir de survie dans une mer où les températures caniculaires et les requins sont légion.
Ce récit a été publié initialement dans le quotidien français Le Temps avant d'être diffusé sous forme de volume relié. Cette publication dans la presse justifie ce découpage en courts chapitres comme le faisait à la même époque Alexandre Dumas. Le succès actuel des séries à la télévision n'est pas nouveau : au XIXe siècle déjà, de grands écrivains populaires tenaient en haleine des milliers de lecteurs. Et c'est le cas dans Le Chancellor où le suspense monte crescendo jusqu'à la dernière page.
Jules Verne construit ici une histoire à part dans sa bibliographie. La France a vécu deux crises majeures à travers la défaite lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et le bain de sang résultant de la Commune de Paris juste après.
L'auteur, marqué comme beaucoup par ces épisodes, reprend dans cet huis clos une galerie de personnages dirigés par un capitaine fuyant et incompétent entouré de marins proches de la folie. Ce cheminement vers le désastre assuré se veut une métaphore de la tragique situation de la France en cette période charnière entre Second Empire et Troisième République.
L'auteur nantais s'est également inspiré du naufrage de la frégate Méduse et de son célèbre radeau immortalisé dans le tableau de Théodore Géricault en 1819. La faim, la soif, la folie et même l'anthropophagie y sont représentées tout comme dans l'œuvre de Jules Verne.
Enfin, j'ai particulièrement aimé l'exploration du récif basaltique, empreint de mystère, qui offre aux passagers du navire échoué un peu de sérénité au cœur de l'enfer. Le célèbre écrivain s'est inspiré de l'île de Staffa en Écosse où il avait d'ailleurs fait le déplacement...
[Critique publiée le 04/10/24]

L E S I N D E S N O I R E S
Jules Verne - 1877
Le Livre de Poche - 236 pages
17/20
Péripéties souterraines
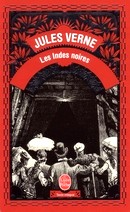 Jules Verne explore ici le monde des miniers en Ecosse.
Jules Verne explore ici le monde des miniers en Ecosse.
Dans une vieille houillère désaffectée vit une famille dont le père Simon, ancien contremaître, reste viscéralement attaché au passé et à l'époque glorieuse de l'extraction du précieux charbon. Après une découverte étonnante, il invite son ancien directeur à venir sur place par une lettre qui laisse planer le mystère.
Ainsi, l'ingénieur James Starr décide aussitôt de rendre visite aux vieilles mines d'Aberfoyle où réside Simon. Cependant, une autre lettre, anonyme cette fois-ci, arrive aussitôt pour lui indiquer qu'il est finalement inutile de se déplacer. Starr rejoint donc la fosse Dochart, plus intrigué que jamais. Après une exploration commune, les deux hommes vont découvrir de nouvelles réserves gigantesques de houille et un monde souterrain inconnu jusque-là.
Malheureusement, d'étranges phénomènes se produisent et nos héros se retrouvent bloqués dans une impasse souterraine, sans lumière. Une âme charitable, sortie semble-t-il du néant, leur portera secours. Mais que cache donc cette ancienne mine ?
L'écrivain nantais livre ici une œuvre lorgnant du côté du fantastique.
À la rationalité de l'ingénieur s'oppose la crédulité d'une population ouvrière qui voit dans les manifestations de la nature écossaise les signes des elfes, esprits et autres fantômes de châteaux hantés. Cette dualité peut se lire également à travers l'opposition entre les lieux d'habitat que sont Coal-City, sous la terre, et Stirling à la surface. Sous le sol, la vie devient plus mystique et les événements qui surviennent dans ce roman ne feront qu'alimenter cette impression.
Des personnages à la psychologie tourmentée feront leur apparition au cours de l'histoire et une romance verra même le jour...
Jules Verne réinvestit un lieu qu'il avait déjà longuement décrit dans son Voyage au centre de la Terre en 1864. Ici, cependant, des familles entières ne jurent que par les lumières artificielles et les roches désertiques dénuées de végétation qui forment le décor de Coal-City. Ces miniers sont restés profondément attachés à leurs conditions de vie qui aujourd'hui nous paraissent pourtant difficilement supportables.
Il y a certainement un peu de naïveté dans les caractères bien tranchés décrits par Verne et aussi par cette mise en scène très théâtralisée digne d'une pièce de Shakespeare ; on pensera notamment aux apparitions de Silfax. Mais l'agilité avec laquelle il parvient à nous transmettre de façon pédagogique une quantité phénoménale de connaissances sur la géologie écossaise, sujet de prime abord un peu rude, ne peut que nous laisser pantois devant ce grand talent de conteur...
[Critique publiée le 06/02/09]

P A S S E P O R T À L ' I R A N I E N N E
Nahal Tajadod - 2007
JC Lattès - 303 pages
15/20
Découverte d'un État mal-aimé
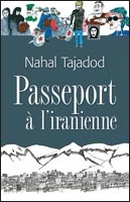 C'est tout l'intérêt de la littérature : voyager sans prendre de risques.
C'est tout l'intérêt de la littérature : voyager sans prendre de risques.
Après la Birmanie, rendez-vous en Iran, ce pays constitutif de l'axe du mal tout comme la Corée du Nord du point de vue américain. Nahal Tajadod est née en Iran et s'est installée à Paris en 1977 pour étudier les relations entre l'Iran et la Chine. Dans ce livre, elle prend presque le prétexte d'un fait divers pour décrire l'amour qu'elle porte à son pays d'origine et à ses habitants. En effet, Nahal se met elle-même en scène lors de l'aventure qu'elle a vécue pour renouveler son passeport. Cette demande administrative est un travail de longue haleine tant le pouvoir en place est méfiant.
Rappelons pour mémoire que l'Iran correspond à l'ancienne Perse et fait la jonction entre les mondes turcs, arabes et indiens. C'est un pays multi-ethnique avec une population en quasi-totalité musulmane chiite (50% des chiites dans le monde) contrairement aux autres pays musulmans qui sont à 90% sunnites. L'Iran dispose de 9% des réserves mondiales de pétrole et de 14% des réserves en gaz.
Jusqu'en 1979, l'Iran était une monarchie pro-occidentale sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi (le dernier shah d'Iran). En 1979 a eu lieu la révolution chiite conduite par l'imam Khomeini, un dignitaire religieux (encore appelé Ayatollah), qui prend la direction du pays. Et c'est la guerre Iran/Irak en 1980 qui fera de nombreuses victimes. L'Irak, soutenue financièrement et militairement par les autres pays arabes, les États-Unis, les pays occidentaux et l'URSS, envahit l'Iran dans le but de détruire la révolution naissante. Mais l'Iran a bel et bien basculé dans l'islamisme radical et est devenue une théocratie qui mène une politique étrangère fondée sur l'intimidation (terrorisme, prise d'otage, fatwa, ...).
C'est donc dans ce cadre de vie assez oppressant que la narratrice nous raconte ses péripéties pour satisfaire son besoin urgent de passeport avant un retour en France. Des petites anecdotes qui s'enchaînent et qui brise la glace d'une ambiance qui à première vue fait peur.
Pourtant, la solidarité chez les iraniens existe et leur politesse est sans limite : il faut ainsi toujours négocier pour que la personne qui vous a rendu un service accepte son dû. Ce théâtre de la politesse s'appelle le « Târof ». Où l'on apprend également que la Suède est la terre d'élection des iraniens immigrants. En effet, avec un visa périmé on peut s'installer confortablement dans le pays scandinave : le gouvernement met à disposition une maison préfabriquée avec vue sur la mer ou, au moins, un lac et offre même une carte téléphonique pour appeler le pays d'origine à volonté ! Et ce n'est là que le début d'une longue liste de privilèges...
On ne lira pas dans ce roman des aventures palpitantes mais on découvrira un autre visage de l'Iran que celui souvent évoqué dans les médias. Et l'on se surprendra même à sourire la plupart du temps !
Extrait : « Quelquefois une simple photo en bikini prise au bord d'une piscine, l'étreinte d'un ami dans le quartier des antiquaires, un fou rire à la Maison des artistes, un chewing-gum trop gonflé dans un bus, un parapluie rouge ouvert par un jour de pluie, un bonbon avalé pendant le mois du ramadan, la visite de deux nâ mahrams (des hommes ne faisant pas partie de la famille) à l'heure du thé, peuvent être interprétés comme des actes subversifs, mettant en danger la stabilité du régime et l'assise même de l'islam. »
[Critique publiée le 09/10/08]

B I R M A N E
Christophe Ono-Dit-Biot - 2007
Plon - 442 pages
17/20
Voyage au cœur de la dictature birmane
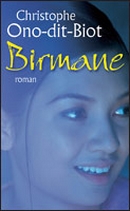 César est en vacances en Thaïlande avec sa copine Hélène.
César est en vacances en Thaïlande avec sa copine Hélène.
Lui recherche l'authenticité, l'exotisme vrai du pays étranger ; elle semble plutôt attirée par le confort de vacances bien sages où l'on voit ce que les touristes voient et où l'on retrouve chaque soir l'apéro devant la piscine.
Et c'est le clash. Hélène traite César de raté, de petit joueur face à Blanchart. Blanchart, c'est la star du magazine féminin pour lequel César travaille. Blanchart est l'aventurier type qui parcourt le monde et ramène des reportages fascinants. César est « rewriter », il corrige les articles des autres uniquement, il vit dans l'ombre. Il décide alors, lui aussi, d'écrire un reportage sur un sujet que Blanchart n'arrive pas à traiter : le roi de l'opium en Birmanie.
Direction le pays voisin de la Thaïlande, coincé entre le Laos, la Chine et l'Inde : la Birmanie ou Myanmar (terme reconnu et utilisé par l'ONU).
Khun Sa est une figure emblématique birmane, il a fondé sa fortune sur la production d'héroïne. Il a créé un royaume au cœur de la jungle sur lequel il veille en véritable dictateur. Il a échappé à dix-sept tentatives d'assassinat, est devenu la bête noire de l'armée birmane, a proposé un marché directement à la Maison Blanche pour que soit reconnu comme État indépendant son royaume. Mais qu'est-il devenu aujourd'hui ? César a bien l'intention de répondre à cette question et ramener un scoop à son magazine.
À peine arrivé dans le pays tropical, il échappe à un attentat dans un lieu commercial névralgique de la capitale Rangoon. C'est à ce moment qu'il fait la connaissance d'une femme médecin humanitaire : Julie. Julie introduira César auprès de Éric, un antiquaire qui connaît bien le pays et pourra le renseigner. Selon ce dernier, l'attentat aurait été commis par la junte birmane elle-même afin de discréditer aux yeux de la population la notoriété montante d'un mouvement de rébellion mené par une certaine « Wei-wei ».
César va vite tomber fou amoureux de Julie qui lui fera découvrir les charmes du célèbre temple bouddhiste de la Schwedagon ou ceux du lac Inle à l'intérieur du pays.
La Birmanie, c'est aussi le pays de Aung San Suu Kyi, la Dame de Rangoon. Celle qui prêche la non-violence, telle une Gandhi, contrairement aux rebelles ethniques. Encore aujourd'hui, elle est enfermée dans sa résidence au cœur de la capitale. Une femme trop dangereuse pour les militaires au pouvoir malgré sa victoire aux dernières élections libres dans le pays...
César va vivre une aventure folle qui le changera définitivement. Son regard d'occidental sur les pays pauvres sera à jamais marqué et bouleversé. Il va rencontrer Khun Sa mais ira beaucoup plus loin dans l'intensité des rencontres avec le peuple birman... Et avec Julie et ses secrets.
Christophe Ono-dit-Biot a le talent pour nous faire voyager dans un pays méconnu, fermé et dirigé d'une main de fer par quelques militaires férus d'astrologie. Le contraste est saisissant entre la fermeté de la junte et le pacifisme des bouddhistes. Grand reporter et passionné par ce pays asiatique, il nous donne une image précise d'un pays peu médiatisé. Mais comment vérifier la véracité de ses propos sinon en lui faisant confiance les yeux fermés ? Les informations sur Khun Sa sont très détaillées et pourtant internet en parle à peine ! Les recherches afin d'écrire ce roman-documentaire ont certainement été approfondies avant de nous parler avec précision des tribus Karens ou Akhas.
O-d-B retranscrit à merveille la moiteur tropicale de ce pays considéré comme le plus beau du monde. Voyager en restant immobile prend ici toute sa dimension et j'ai personnellement l'impression d'avoir fait un petit séjour en jungle birmane. J'ai également eu envie d'en savoir plus sur ce pays à mettre au même rang que la Corée du Nord, le Turkménistan ou encore l'Erythrée qui sont considérés comme les trois pays les plus fermés du monde.
La traversée à pied des villages birmans m'a tout à fait rappelé mon périple à Madagascar où là aussi les enfants courraient le long des rizières pour venir nous saluer et nous prendre la main...
Enfin, le style littéraire est alerte, efficace, facile à lire et de bonne facture. Les références à Wong Kar Waï pour décrire la beauté des femmes illustrent à merveille les propos de l'auteur.
Extrait : « Trois secondes plus tard, une forme en longyi noir rayé de bleu sombre faisait son apparition derrière lui. Ses cheveux tombaient jusqu'à ses reins, encadrant un visage d'une finesse extrême hésitant entre la Chine et l'Inde. [...] Elle a trempé ses lèvres dans le thé brûlant. Je la trouvais plus belle que jamais dans cette lumière dorée, dans les effluves de l'eau parfumée, fumée, mêlée à ces arômes de noix de coco. Ses cheveux casqués, son nez droit, ses lèvres pulpeuses et son menton volontaire me donnaient envie de l'aimer. »
Ce livre qui aborde de nombreux sujets d'actualité, se veut un véritable plaidoyer pour la défense de toutes ces minorités birmanes (mais on peut extrapoler à d'autres pays) qui sont bafouées dans leur identité culturelle par un pouvoir qui n'hésite pas à violer, battre, assassiner, ridiculiser en public ses paysans.
[Critique publiée le 09/10/08]

L ' Î L E
Robert Merle - 1962
Gallimard - 696 pages
18/20
La naissance d'une société
 Ce roman s'inspire de l'histoire des révoltés du Bounty : à la fin du XVIIIe siècle, un navire de l'amirauté britannique cède à la mutinerie d'une partie de son équipage.
Ce roman s'inspire de l'histoire des révoltés du Bounty : à la fin du XVIIIe siècle, un navire de l'amirauté britannique cède à la mutinerie d'une partie de son équipage.
Le capitaine du vaisseau, appelé ici Blossom, est assassiné et le nouvel équipage fait escale à Tahiti. Là, les hommes ont le choix : rester sur cette terre paradisiaque mais avec un risque très élevé d'être retrouvés par des marins anglais puis ramenés au pays pour y être jugés ou alors partir sur l'océan en quête d'une île éloignée de toutes routes maritimes et fonder une nouvelle communauté, avec la certitude de ne plus jamais revoir l'Angleterre.
Neuf britanniques décident de tenter l'aventure. Ils seront accompagnés par des autochtones de Tahiti pour aider à manœuvrer le navire : douze femmes et six hommes. À bord du Blossom, ils continuent donc leur route dans l'océan Pacifique pour atteindre l'île de Pitcairn, petit massif rocheux cerclé de falaises difficilement accessibles pour d'éventuels envahisseurs.
Le héros, Purcell, est accompagné de sa femme tahitienne, Ivoa. Ainsi, tout semble présent pour vivre dans un monde enchanteur, loin de toutes les vicissitudes humaines.
Malheureusement, cette microsociété va reproduire à son échelle ce qui se produit inéluctablement, semble-t-il, à l'échelle d'un pays. L'infériorité des tahitiens sera une vérité absolue pour certains britanniques qui n'auront de cesse d'exacerber le racisme entre les habitants de l'île. Cela créera des tensions guerrières lors du partage des terres ou des femmes. Purcell, figure romantique et idéaliste, tentera en permanence de désamorcer les tensions et de rendre équitable pour tous la vie sur cette île généreuse.
Cette épopée, gros pavé de cinq cents pages, renoue avec des thèmes chers à Robert Merle.
La construction d'une société nouvelle et juste, déjà longuement évoquée dans son œuvre Malevil, est-elle une utopie ? La vie dans un monde clos, qui peut devenir une véritable prison, est aussi un sujet abordé, tout comme dans son reportage sur la vie à bord d'un SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur d'Engins) dans Le jour ne se lève pas pour nous en 1986.
Les personnages de L'île forment un panel de toutes les passions humaines.
Purcell, le personnage principal, qui se veut bon avec chacun de ses compatriotes, anglais ou tahitiens, et qui finalement se pose de nombreuses questions sur l'inéluctabilité d'une telle dérive. Il luttera cependant jusqu'au bout et refusera toujours d'employer la force.
Mac Leod, écossais au caractère bien trempé, qui voudra toujours manipuler les plus faibles pour les dresser contre ceux qu'il veut affaiblir.
Mason, le capitaine de vaisseau, qui restera toujours fermé et observera sur l'île les mêmes règles hiérarchiques qu'à bord de son navire.
Puis viennent toutes ces femmes, très belles et innocentes, qui seront pour la plupart soumises à leur « tané » (mot tahitien désignant compagnon).
Robert Merle nous démontre avec une grande logique pourquoi nos sociétés ont tant de mal à vivre paisiblement. Est-il pessimiste ? Sans doute que sa vision du monde moderne le faisait douter. Mais la lumière de la vie s'accroche toujours et se faufile partout, même là où la déchéance règne. Le petit Ropati en sera la preuve...
L'écriture, quant à elle, est remarquable. Beaucoup de style et d'élégance viennent émailler les propos de l'auteur. La narration de Robert Merle est exemplaire, respectueuse du beau et bon français. Le lecteur sentira le côté très « british » (pour mémoire, Robert Merle était agrégé d'anglais) de son art de raconter : de nombreux détails, des descriptions approfondies, des explications abondantes, un langage soutenu.
Un roman qui fait presque figure d'essai sur la constitution d'une société mais qui sait garder sa propension à nous faire rêver et voyager très loin vers les merveilles de la Polynésie.
[Critique publiée le 26/02/08]

L A V O I L E B L A N C H E
Sergio Bambaren - 2000
Presses du Châtelet - 205 pages
11/20
Roman ésotérique
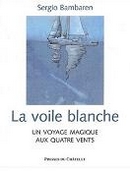 Michael et Gail forment un jeune couple installé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est l'anniversaire de leur cinquième année de mariage mais Michael, trop absorbé par son travail de conseiller financier, l'oublie.
Michael et Gail forment un jeune couple installé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est l'anniversaire de leur cinquième année de mariage mais Michael, trop absorbé par son travail de conseiller financier, l'oublie.
Près de l'immeuble abritant son bureau se trouve une petite librairie, tenue par le vieux monsieur Thomas Blake. Michael s'y rend régulièrement et, un jour, il tombe sur un livre de poèmes écrits par des auteurs ayant décidé de donner un sens vrai à leur vie. Le couple se rend alors compte qu'il passe sans doute à côté de quelque chose, que le bonheur ne se résume pas à une carrière assurée, un salaire mensuel, une retraite bien préparée, bref, une routine assez conformiste. Il décide donc de suivre les conseils de ce livre magique et de se lancer dans un grand voyage initiatique sur les mers du Pacifique sud.
L'essentiel du livre nous conte donc cette croisière vers les îles Fidji, l'archipel de Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Aventures, découvertes et rencontres avec l'autre seront les éléments clés qui les aideront à retrouver l'essentiel, leur amour. Le livre, embarqué à bord, leur délivrera de nouveaux messages sur le sens qu'il faut donner à la vie...
Ce roman est très particulier. Il décrit un parcours initiatique sur le chemin de la reconquête de soi et de l'amour avec l'autre. On touche à un style appelé « ésotérisme ».
L'auteur, né au Pérou, a lui-même décidé de tout quitter un jour pour faire le tour du monde et pratiquer ses deux passions : le surf et l'écriture. À travers ce livre, il nous invite à nous poser quelques questions sur la définition du bonheur au présent.
[Critique publiée le 30/12/07]

L E L I È V R E D E V A T A N E N
Arto Paasilinna - 1975
Gallimard - 236 pages
16/20
Histoire légère en Finlande
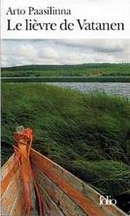 Ce roman écrit par Arto Paasilinna, auteur finlandais traduit et apprécié en France, raconte le parcours épique d'un journaliste à travers son pays.
Ce roman écrit par Arto Paasilinna, auteur finlandais traduit et apprécié en France, raconte le parcours épique d'un journaliste à travers son pays.
Vatanen, désabusé par sa femme, son boulot et la vie en général heurte par accident un lièvre sur le bord d'une route. Il va alors le recueillir puis le soigner. Commencera alors la plus folle des aventures pour les deux compagnons.
Ensemble, ils parcourront toute la Finlande, découvriront des paysages divers, feront la connaissance d'une galerie de personnages déjantés, chasseront l'ours, passeront par la case prison, découvriront l'amour d'une femme...
Voyage initiatique ou farce de cirque, cette épopée fait penser avec sourire aux déambulations d'un Mr Hulot dans le cinéma français des années 50. Tout n'est que dérision et légèreté pour le personnage principal qui ne se fâche jamais et accepte toujours avec philosophie les vicissitudes de son aventure.
Mais derrière cette fable se cache un message destiné à prôner les bienfaits du contact avec la nature et à démontrer que l'humilité face aux événements rend stériles tous les tracas causés par nos modes de vie souvent bercés par la futilité.

L A D O U C E E M P O I S O N N E U S E
Arto Paasilinna - 1988
France Loisirs - 217 pages
16/20
Humour noir au pays des rennes
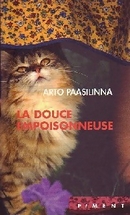 Une vieille femme nommée Linnea Ravaska, veuve d'un colonel, vit paisiblement dans une petite maison de campagne à cinquante kilomètres d'Helsinki. Pas si paisiblement que cela en réalité car chaque mois, au moment où sa pension est versée, son neveu Kauko Nyyssönen accompagné de deux acolytes Jari Fagerström et Pertti Lahtela s'invitent sous son toit pour profiter du lieu et lui soustraire une partie de sa retraite. Les trois compères, vivant à Helsinki, sont des malfrats et n'ont peur de rien. Ils profitent de la vie en volant, magouillant, molestant les gens si besoin.
Une vieille femme nommée Linnea Ravaska, veuve d'un colonel, vit paisiblement dans une petite maison de campagne à cinquante kilomètres d'Helsinki. Pas si paisiblement que cela en réalité car chaque mois, au moment où sa pension est versée, son neveu Kauko Nyyssönen accompagné de deux acolytes Jari Fagerström et Pertti Lahtela s'invitent sous son toit pour profiter du lieu et lui soustraire une partie de sa retraite. Les trois compères, vivant à Helsinki, sont des malfrats et n'ont peur de rien. Ils profitent de la vie en volant, magouillant, molestant les gens si besoin.
Apeurée, Linnea se concocte un poison mortel afin de pouvoir s'échapper rapidement de cette vie devenue déprimante à cause de son neveu. Par un concours de circonstances imprévu, ce poison ne lui sera pas injecté à elle mais à l'un des protagonistes du dangereux trio. Et Linnea, sans le savoir, va attirer sur elle les foudres de ses ennemis qui ne penseront plus qu'à l'éliminer...
Malheureusement pour eux, une personne âgée peut être bien plus vigoureuse et maligne que prévu.
De nombreuses situations rocambolesques et plusieurs quiproquos viendront ponctuer leur petite guerre mettant Kauko et ses compères dans une situation de plus en plus difficile.
Comme à son habitude, Arto Paasilinna est resté fidèle à son style : un décor planté en Finlande (d'Helsinki jusqu'à Rovaniemi en Laponie), de l'humour noir à chaque page, une écriture aérée et efficace, des personnages attachants, des situations cocasses.
C'est un auteur qui sait se démarquer des autres et cultiver l'amour de son pays. Il a également un talent incroyable pour mettre en scène des scénarios d'une originalité décoiffante et tout cela avec ce petit zeste de poésie et de légèreté qui lui est propre.
[Critique publiée le 09/10/07]

J É R É M I E ! J É R É M I E !
Dominique Fernandez - 2006
Grasset - 292 pages
17/20
Voyage à Haïti pour le prix d'un livre !
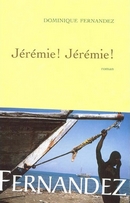 Fabrice, jeune étudiant installé à Paris, découvre un terrible secret de famille qui va le bouleverser.
Fabrice, jeune étudiant installé à Paris, découvre un terrible secret de famille qui va le bouleverser.
Fasciné par son père, mort en véritable héros alors qu'il était tout jeune, Fabrice apprend la vérité à son propos. Cette remise en cause totale le conduit à vouloir partir loin pour exorciser ses démons.
Passionné de littérature et particulièrement intéressé par l'œuvre d'Alexandre Dumas, il s'engage pour un périple humanitaire vers l'île d'Haïti. Son but à travers ce voyage est d'aider un pays pauvre mais aussi d'enquêter sur la grand-mère du célèbre auteur, négresse mariée à un colon blanc à l'époque de l'esclavagisme. Quittant son amie Karine et sa mère, Fabrice prend le risque de suivre une petite communauté de jeunes venus des quatre coins de la planète et placée sous l'égide d'un étrange mécène suisse.
La majeure partie du livre est une invitation à la découverte d'Haïti et de ses habitants. Dominique Fernandez aborde ainsi différents thèmes qui sont toujours d'actualité : la traite des noirs, la France et ses colonies, le tourisme de masse, la cohabitation pays pauvres et pays riches, la puissance et la décadence du communisme. À travers le parcours de Fabrice, le lecteur apprend également l'histoire de la famille Dumas, depuis le grand-père venu sur l'île pour installer une plantation avec son frère jusqu'au père, général ayant connu gloire et déboire sous le commandement de Napoléon.
En plus de traiter de façon approfondie des sujets délicats, l'auteur le fait avec une verve littéraire remarquable. On est là dans la grande littérature française de tradition. Une écriture posée, réfléchie, parfaitement aboutie sur le plan artistique. Pas étonnant d'apprendre que Fernandez a déjà eu le prix Goncourt (1982) !
La fin du roman est quant à elle surprenante. Fabrice va réaliser une véritable introspection de ses états d'âme et découvrir un pan méconnu de sa personnalité. Un autre personnage clé jouera un rôle primordial dans cette découverte. L'ultime page coupe le souffle au lecteur et en révèle beaucoup sur les passions humaines.
Bref, un livre vraiment intéressant qui aborde une grande quantité de thèmes, tout cela dans l'ambiance moite et suave d'une île des Caraïbes, et qui est empreint d'un nombre important d'éléments biographiques issus du parcours de l'auteur...

L A P L A G E
Alex Garland - 1995
Le Livre de Poche - 474 pages
14/20
Le mythe de Robinson revisité
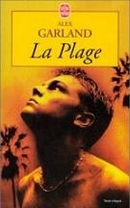 Un paradis perdu en Indonésie. Une île où l'on cultive clandestinement des plantations de drogue. Une plage dans un décor incroyable. Des touristes de tous les pays qui ont fondé une communauté hors du temps dans ce lieu. Un secret difficile à garder. Un plan d'accès qui circule et de nouveaux routards qui arrivent.
Un paradis perdu en Indonésie. Une île où l'on cultive clandestinement des plantations de drogue. Une plage dans un décor incroyable. Des touristes de tous les pays qui ont fondé une communauté hors du temps dans ce lieu. Un secret difficile à garder. Un plan d'accès qui circule et de nouveaux routards qui arrivent.
L'idée est originale. Ce microcosme en apparence paisible trahira vite les vices humains.
L'auteur pose une fois de plus la question du modèle de société parfaite.
Le livre est un peu long et ne possède pas de vrai fil directeur. Il réside davantage dans une succession d'épisodes autour des différents personnages.
Le film qui en a été adapté, avec dans le rôle principal Leonardo Di Caprio, prend beaucoup de liberté par rapport au texte. Curieusement, ce film, bien que moyen, possède davantage de rythme que le livre.
Bref, une énième variation sur le thème de Robinson Crusoé...

Dernière mise à jour :
[ - Site internet personnel de chroniques littéraires. Mise à jour régulière au gré des nouvelles lectures ]

Copyright MAKIBOOK - Toute reproduction interdite
contact [at] makibook.fr


