 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire
 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire

Romans > Drame
S I D É R A T I O N S
Richard Powers - 2021
Actes Sud - 398 pages
19/20
Notre monde présent à fleur de peau
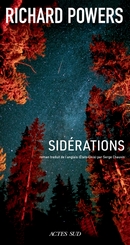 Theo Byrne est astrobiologiste dans une université de Wisconsin. Il vit seul avec son fils de neuf ans, Robin, depuis que sa femme Alyssa a été tuée dans un accident de la route deux ans auparavant.
Theo Byrne est astrobiologiste dans une université de Wisconsin. Il vit seul avec son fils de neuf ans, Robin, depuis que sa femme Alyssa a été tuée dans un accident de la route deux ans auparavant.
Robin est un enfant à part, sujet à des problèmes de sommeil, à des crises violentes pour un oui ou un non et supportant difficilement le bruit et les objets mal rangés ; à côté de cela, il dessine avec un talent rare pour son âge, possède une mémoire exceptionnelle et peut rester des heures durant concentré sur un sujet qui lui plaît. Son père n'est jamais parvenu à identifier avec précision la pathologie dont il souffre car les médecins eux-mêmes ont posé différents diagnostics sans jamais donner d'avis définitif : TOC, troubles de l'attention, Asperger, ...
Pour aider son enfant extrêmement sensible et réceptif à la nature, Theo l'emmène en vacances dans les Smoky Mountains. Là, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, les deux hommes se passionnent autant pour notre vaste univers et la découverte des exoplanètes que pour la magie de la photosynthèse chez un végétal : « Les lois qui régissent la lumière d'une luciole dans mon jardin où j'écris ces mots ce soir sont les mêmes qui régissent la lumière émise par l'explosion d'une étoile à un milliard d'années-lumière. Le lieu ne change rien. Ni le temps. »
Le soir, ils s'évadent en imaginant d'autres planètes où la vie s'exprimerait de façon radicalement différente de celle que l'on connaît sur Terre. Leurs rêveries sans limite se terminent toujours par une petite prière avant d'éteindre la lumière : « Puissent tous les êtres sensibles être exempts de souffrances inutiles. »
Tentant le tout pour le tout face aux difficultés de son fils qui l'éloignent régulièrement du système scolaire et le rendent de plus en plus dépendant aux psychotropes, le scientifique contacte Martin Currier. Ce dernier dirige un laboratoire de neurosciences sur le même campus : il y développe une technique permettant, grâce à l'imagerie cérébrale couplée à l'Intelligence Artificielle, de reprogrammer des sujets selon des modèles émotionnels cibles. Robin apprend ainsi à reproduire ceux de sa défunte mère qui avait elle-même participé à une expérience chez son ami Currier avant sa disparition.
Les progrès sont fulgurants, le petit garçon connaît de moins en moins de crises ou de difficultés ; il s'apaise de façon impressionnante.
Cependant, le monde est tel que la bêtise de certains, agissant en révisionnistes de la science, va conduire l'expérience ailleurs que sur sa lancée initiale pourtant si prometteuse...
Sidérations est un livre d'une très grande sensibilité et acuité sur le monde qui nous entoure. Il rend compte de façon étonnamment prégnante du basculement d'époque qui s'opère actuellement. Les années 2020 sont en effet la preuve qu'il fallait semble-t-il à certains pour comprendre que les alertes émises dès les années 70 étaient sérieuses tant les changements sont maintenant visibles au quotidien. Virus, réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, guerres et dictateurs en tout genre avec leur vision ringarde et idiote du sens de la vie, tout cela est abordé dans ce roman majestueux.
Richard Powers a réussi avec brio et profondeur à mettre en place une relation père-fils émouvante au sein d'un monde en totale décomposition voué à disparaître. Même notre société marchandisée et numérisée à outrance participe de cette décrépitude : « Les amitiés se mesuraient en partages, en likes, en liens. Poètes et prêtres, philosophes et pères de jeunes enfants : nous étions tous engagés dans un business total et sans fin. »
Bref, dans ce récit on croise Inga Alder, double fictionnel de Greta Thunberg, on relit Des fleurs pour Algernon, on se promène dans la Voie Lactée et bien plus loin, on apprend à identifier les oiseaux qui nous entourent et à prendre de la hauteur sur des questions existentielles dont sans doute la plus importante depuis la nuit des temps : sommes-nous seuls dans l'univers ? Et Powers de faire rêver son fils et par la même son lecteur : « Je lui expliquai ce que pensaient désormais certains astronomes : un milliard au moins de planètes avaient eu autant de chance que la nôtre, rien que dans la Voie Lactée. Dans un univers qui s'étendait sur quatre-vingt-treize milliards d'années-lumière, les Terres Rares poussaient comme du chiendent. »
L'auteur américain, sans apporter de réponse, parvient ainsi à donner des pistes stimulantes et à apporter une vision rafraîchissante du fameux paradoxe de Fermi !
Et du côté des phrases vertigineuses, il excelle et se plaît à remettre ses personnages à leur place lorsque, ceux-ci étant à bord d'un taxi, il décrit : « Je nous sentais voyager sur un petit engin se frayant un chemin dans la capitale de la superpuissance planétaire dominante sur la côte du troisième continent en taille d'un modeste monde rocheux sur la bordure interne de la zone habitable d'une étoile naine de type G située à un quart de chemin de l'extrémité d'une vaste et dense galaxie spirale barrée qui dérivait à travers un groupe local clairsemé en plein centre de tout l'univers. »
À l'époque où certains scientifiques sortent de leur objectivité, à l'image du climatologue de la NASA Peter Kalmus, le narrateur Theo Byrne incarne parfaitement le nouvel héros moderne tout à la fois plein d'humilité, de contemplation et de détermination pour sauver ce qui peut encore l'être.
Un livre flippant et fascinant à la fois.
[Critique publiée le 10/03/23]

A M O U R N O I R
Dominique Noguez - 1997
Gallimard - 183 pages
17/20
Quand l'Amour rend esclave
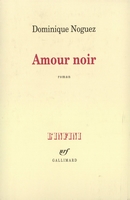 Tout commence un soir de juin de l'année 1984, à Biarritz, près du casino où il est bon de flâner en écoutant le ressac de la mer. Éric, en quête d'une aventure, se laisse distraire par une simple silhouette blanche et décide de la suivre à travers les petits tunnels creusés dans la roche et jusque sur la plage. Sans doute aidée par les quelques verres d'alcool qu'il a consommés, notre homme ose aborder la magnifique femme aux « lèvres de métisse », aux « dents impeccables » et aux seins exquis.
Tout commence un soir de juin de l'année 1984, à Biarritz, près du casino où il est bon de flâner en écoutant le ressac de la mer. Éric, en quête d'une aventure, se laisse distraire par une simple silhouette blanche et décide de la suivre à travers les petits tunnels creusés dans la roche et jusque sur la plage. Sans doute aidée par les quelques verres d'alcool qu'il a consommés, notre homme ose aborder la magnifique femme aux « lèvres de métisse », aux « dents impeccables » et aux seins exquis.
Cela signe le début d'une histoire d'amour tumultueuse faite de départs, de retours, de passions et de souffrances. Car Laetitia, c'est le prénom de cette divine créature, est changeante comme le dit si joliment la chanson La donna è mobile dans l'opéra de Verdi.
Totalement fasciné, le narrateur ferme les yeux sur les signes qui annoncent dès le début les angoisses à venir. Laetitia peut ainsi disparaître du jour au lendemain après une nuit d'amour inoubliable, se trouver soudain au bras d'un autre homme dans la rue ou échanger ouvertement au téléphone des mots laissant entendre d'autres relations amoureuses.
Son caractère inconstant la rend tantôt silencieuse ou méprisante, tantôt pleine de projets enchanteurs, riante et aimante. C'est ainsi que, lors d'une escapade à Cambo-les-Bains où se situe la magnifique demeure d'Edmond Rostand, peu de temps après leur rencontre le narrateur rapporte ses inquiétudes : « Il faudrait toujours compter avec cette effarante dureté qui la mettait soudain, pour des journées et même, hélas ! des semaines, hors de prise - même pas ricaneuse (car le ricanement marque encore une espèce d'intérêt négatif), mais muette, glacée, hyperboréenne, inaccessiblement ailleurs, dans une autonomie absolue qui est l'empêchement absolu de l'amour. Bref, j'avais déjà, en cet après-midi à Cambo, la preuve qu'elle m'en ferait beaucoup endurer. »
Éric, subjugué, s'enfonce pourtant à corps perdu dans cette relation mortifère faite de hauts et de bas. Malgré des instants fusionnels qu'il décrit avec nostalgie, il ressasse davantage les pénibles moments qu'il a traversés car « la mémoire est oublieuse du bonheur ».
Leur voyage au Japon est par exemple un véritable cauchemar lorsque la belle disparaît durant plusieurs jours et revient juste avant leur retour sans donner de véritable explication. Pareil à Barcelone avec un nouveau jeu du chat et de la souris. Éric est tellement accroc qu'il ira jusqu'à la chercher au Québec après une longue et nouvelle disparition.
Une nuit, dans un état second, il imagine même tuer la femme qu'il aime pour mieux la posséder : « Et j'en vins à songer que l'assassinat est le plus bel acte d'amour, celui où l'amant sacrifie sa vie à l'aimée en même temps qu'il la lui ôte. Enfin la volage est calme, immobile, sereine, à sa merci, aimante même, comme jamais. » Cela m'a fait penser à la première trilogie de Yann Moix sur l'amour fou et en particulier au titre Anissa Corto qui pousse cette affreuse idée jusqu'au bout.
Le roman présente l'ensemble des épisodes de cet amour noir qui ont conduit le narrateur aux limites de la folie sous la forme d'une longue rétrospective aux allures psychanalytiques.
Dominique Noguez a tissé cette histoire dramatique en prélevant son substrat dans Les derniers jours du monde publié en 1991 aux éditions Robert Laffont. Ce roman total entremêlait les souvenirs de l'amour perdu avec Laetitia et la menace d'événements chaotiques et tragiques qui frappaient soudainement la planète. Amour noir reprend ainsi littéralement des passages de son livre géniteur et devient une entité propre totalement décorrélée de la partie « fin du monde ». Il peut ainsi se lire de façon complètement indépendante.
Le grand écrivain nous livre les états d'âmes torturés de son personnage à travers une analyse cérébrale remarquablement écrite. Le style est précis, rigoureux et fait honneur à la langue française. Noguez était un intellectuel curieux et exigent. De nombreuses références parsèment les pages et leur offrent ainsi une dimension culturelle qui ravira les lecteurs à l'affût de grands textes contemporains.
Ce titre a obtenu le prix Femina en 1997.
[Critique publiée le 10/03/23]

L E M A G E
John Fowles - 1966
Albin Michel - 648 pages
16/20
Désillusions grecques
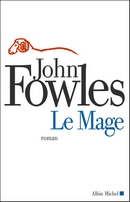 Nicholas Urfe est recruté comme professeur d'anglais dans le collège de la petite île grecque de Phraxos. Plutôt indépendant et quelque peu égoïste, il quitte sa terre natale d'Angleterre par amour pour la Grèce et aussi dans le but de fuir une relation compliquée avec son amie australienne Alison.
Nicholas Urfe est recruté comme professeur d'anglais dans le collège de la petite île grecque de Phraxos. Plutôt indépendant et quelque peu égoïste, il quitte sa terre natale d'Angleterre par amour pour la Grèce et aussi dans le but de fuir une relation compliquée avec son amie australienne Alison.
Dans les somptueux décors de pinède et d'eau cristalline, le jeune homme, en explorant l'île, découvre une magnifique demeure dont le propriétaire l'invite. Maurice Conchis, un homme très riche qui se dit médecin, va alors insidieusement établir son emprise sur Nicholas. Celui-ci est ainsi convié tout d'abord à déjeuner puis, plus tard, à séjourner des week-ends durant dans la propriété surplombant la plage. Petit à petit, il découvre que le propriétaire de la villa n'est pas seul et fait la connaissance de deux très belles sœurs jumelles : Julie et June.
Sous le charme total de Julie, le jeune anglais se laisse entraîner dans des expériences psychologiques orchestrées par Conchis. Des phénomènes étranges apparaissent tels que des mises en scène très réalistes de situations passées ou improbables. Tentant de démêler le vrai du faux, Nicholas se heurte aux réponses toujours fuyantes et mystérieuses de ses hôtes, Julie et Conchis, maîtres dans l'art de brouiller les pistes. L'île paradisiaque devient alors une sorte de prison psychique où le réel est difficile à cerner, où l'attrait irrésistible pour la magnifique Julie est un piège auquel il devient impossible de se soustraire...
Ce roman qui se déroule dans les années 50, peu après la guerre que l'auteur met d'ailleurs en scène, demeure très moderne dans son propos et sa construction.
L'écriture est élégante, précise et réfléchie. L'ambiance générale du récit est pleine d'un charme qui invite le lecteur à rêver dans un monde distant géographiquement et temporellement. Je pense en particulier aux magnifiques pages décrivant l'escapade amoureuse sur le continent grecque de Nicholas et Alison. Ce passage touche à la perfection car tout y est : les décors de carte postale, le romantisme et l'insouciance des personnages, le raffinement des rencontres et des descriptions.
Dans ce cadre idyllique règne cependant une ambiance magnétique, légèrement angoissante et surtout totalement mystérieuse.
Le thème dominant de la manipulation psychologique est très plaisant. Quelques scènes très suggestives viennent renforcer ce sentiment d'ensorcellement qui touche le narrateur. Cependant, la compréhension générale est rendue assez difficile par une fin laissant grandes ouvertes des portes. Certes, j'aime quand l'auteur ne mâche pas tout le travail et laisse au lecteur le soin de terminer le puzzle à partir des pièces présentes dans le livre. J'apprécie aussi dans certains cas une fin ouverte propice à différentes interprétations et rêvasseries. Ici, cependant, la solidité de la majeure partie de l'histoire m'avait laissé entrevoir un dénouement plus construit, plus argumenté, plus clair. Je n'ai malheureusement pas réussi à saisir les véritables objectifs du mage Conchis.
Peut-être faudrait-il relire ce roman dont l'ambiance n'est pas sans rappeler celle des films Le prisonnier, Eyes wide shut ou encore Under the silver lake ?
[Critique publiée le 10/03/23]

L E C O M P L E X E D ' E D E N B E L L W E T H E R
Benjamin Wood - 2012
Zulma - 496 pages
14/20
Une logique finale peu évidente à cerner totalement
 Au début des années 2000, Oscar mène une vie calme dans la prestigieuse ville universitaire de Cambridge. Il n'est pas étudiant comme une grande partie des jeunes gens de son âge mais aide-soignant à la maison de retraite de Cedarbrook où les soins apportés aux patients remplissent son quotidien et où il s'est lié d'amitié avec l'un des résidents, le Dr Paulsen qui était professeur de lettres à Cambridge. Oscar est curieux intellectuellement mais a dû trouver son emploi rapidement pour quitter des parents peu encourageants et se contentant d'une existence assez médiocre. Son ami possède une bibliothèque dans sa chambre et le jeune homme y emprunte régulièrement des livres.
Au début des années 2000, Oscar mène une vie calme dans la prestigieuse ville universitaire de Cambridge. Il n'est pas étudiant comme une grande partie des jeunes gens de son âge mais aide-soignant à la maison de retraite de Cedarbrook où les soins apportés aux patients remplissent son quotidien et où il s'est lié d'amitié avec l'un des résidents, le Dr Paulsen qui était professeur de lettres à Cambridge. Oscar est curieux intellectuellement mais a dû trouver son emploi rapidement pour quitter des parents peu encourageants et se contentant d'une existence assez médiocre. Son ami possède une bibliothèque dans sa chambre et le jeune homme y emprunte régulièrement des livres.
En rentrant chez lui, un soir d'octobre, il décide de couper par le parc de King's College. Là, attiré par une musique majestueuse mêlant orgue et chœur, il pénètre dans l'édifice pour profiter pleinement du moment.
En sortant, il fait la connaissance d'une jeune fille blonde prénommée Iris. Une cigarette à la main et un livre de Descartes à l'autre, elle aborde Oscar de façon naturelle en lui confessant que l'organiste qui vient de jouer le cantique n'est autre que son frère Eden Bellwether.
La jeune femme est elle-même violoncelliste en dehors de ses études de médecine ; elle invite Oscar à venir l'écouter jouer lors d'un récital avec son orchestre de chambre.
Doucement, une relation amoureuse se tisse entre les deux jeunes personnes. Oscar est alors introduit dans le milieu étudiant de Cambridge et plus particulièrement dans le cercle d'amis d'Iris. Il découvre que la petite bande, incluant Marcus, Yin et Jane, gravite autour du frère d'Iris. Ce dernier, Eden Bellwether, possède un caractère suffisant et arrogant et prétend disposer d'un pouvoir sur les autres grâce à ses talents d'organiste. Il est fasciné et totalement obsédé par le compositeur et théoricien allemand Johann Mattheson.
Malgré un caractère assez indépendant et une légère méfiance, Oscar, déjà sous le charme d'Iris, se laisse séduire par son nouveau groupe d'amis jusqu'à être hypnotisé par Eden qui parvient à lui planter un clou dans la main lors d'une soirée privée. L'opération est indolore et la guérison très rapide.
Suite à cette mauvaise expérience, Iris confie à Oscar son inquiétude au sujet du comportement psychologique de son frère et affirme qu'elle souhaiterait obtenir l'avis d'un spécialiste car elle est convaincue qu'il est malade.
Le Dr Paulsen possède justement un grand ami psychologue en la personne du renommé Herbert Crest qui a notamment écrit de nombreux ouvrages sur les personnalités narcissiques. Oscar voit là une occasion parfaite pour faire se rencontrer le spécialiste et le patient virtuose de l'orgue.
Ainsi, Crest, atteint lui-même d'une tumeur au cerveau, accepte de remettre sa guérison tant espérée entre les mains d'Eden et sa musique hypnotique au sein des murs de la chapelle privée du domaine familial de Grantchester.
Fou ou génie ? Les dés sont lancés de façon irréversible pour répondre à cette question.
Premier roman de Benjamin Wood, Le complexe d'Eden Bellwether est un livre écrit avec beaucoup d'application.
L'ambiance est posée dès le début avec cet univers studieux et élitiste de la ville universitaire de Cambridge. Les personnages apparaissent les uns après les autres jetant le trouble dans l'esprit du lecteur sur leur sincérité, leur possible pouvoir manipulateur.
Le lecteur s'identifie facilement à Oscar, le personnage principal à l'esprit cartésien, qui semble avoir mis les pieds dans un engrenage dont l'issue fatale est évoquée dès les premières pages sans précision sur l'identité des victimes. Plus le texte avance, plus le doute s'immisce avec son lot de questions : Iris est-elle réellement amoureuse ? Eden a-t-il vraiment un pouvoir de guérison ? Leurs parents sont-ils sincères ? Quelle est la vraie nature de la relation entre les docteurs Crest et Paulsen ?
Les derniers chapitres m'ont cependant laissé perplexe. Certes, le drame se noue mais je m'attendais à une manipulation bien plus astucieuse d'Oscar et du lecteur par les différents protagonistes. Je pensais avoir affaire à un plan vraiment diabolique qui aurait pris forme dans la dernière partie et aurait remis en cause toutes les relations tissées au cours de l'histoire.
En plus d'une trame assez classique, qui était pourtant prometteuse lors de cette scène intrigante et perturbante au cours de laquelle Oscar est atteint physiquement à son insu par Eden, certains éléments de la fin, dont le chapitre 18, m'ont échappé. N'aurais-je pas saisi une logique évidente ?
Après cette lecture, j'ai donc ressenti une frustration d'autant plus grande que la qualité de l'écriture est là et que le thème du roman est passionnant. Dans la même veine, Le maître des illusions est bien plus puissant et jouissif.
[Critique publiée le 20/06/21]

G A R D E N O F L O V E
Marcus Malte - 2007
Zulma - 301 pages
18/20
Plongée en schizophrénie
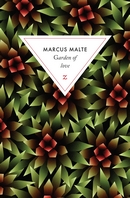 Cette troublante affaire se situe dans le sud de la France entre les années 80 et 2004. Alexandre Astrid, un flic à la dérive depuis la disparition tragique de sa famille, reçoit un manuscrit de cent cinquante-trois pages au format A4. À l'intérieur, il découvre un récit mêlant fiction, réalité, mensonges et révélations. De plus, de nombreux éléments font référence à sa propre vie.
Cette troublante affaire se situe dans le sud de la France entre les années 80 et 2004. Alexandre Astrid, un flic à la dérive depuis la disparition tragique de sa famille, reçoit un manuscrit de cent cinquante-trois pages au format A4. À l'intérieur, il découvre un récit mêlant fiction, réalité, mensonges et révélations. De plus, de nombreux éléments font référence à sa propre vie.
Il connaît très bien l'auteur de ce courrier machiavélique qui, dès les premières lignes, fait resurgir d'horribles souvenirs et beaucoup de souffrance. Alexandre se rend aussitôt aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans la villa de bord de mer où habitait jadis son mystérieux correspondant.
Parallèlement, Matthieu raconte sa vie avec sa merveilleuse femme Florence et leurs enfants. La famille passe les derniers jours de l'année en profitant de la plage malgré un ciel chargé. Lors d'une balade, Matthieu tombe sur Ariel, un personnage qu'il ne souhaite plus revoir tant il semble lui faire peur. Il relate alors sa rencontre avec Ariel au lycée lorsqu'ils avaient seize ans tous les deux et la fascination qu'il avait à cette époque pour « le blondinet déguisé en corbeau ».
Alexandre plonge par la force des choses dans son passé et reprend contact avec Marie qu'il n'avait pas revue depuis de nombreuses années. Marie connaît bien les tourments qui ont fait sombrer le policier dans l'alcool et a de l'affection pour lui ; elle se propose naturellement de l'aider à comprendre le sens profond et la raison d'être du manuscrit.
Car Alexandre a aussi très bien connu Ariel. Et comme Matthieu, il est tombé au cours d'une enquête sous l'emprise de ce personnage fascinant et diabolique.
Il est difficile d'en dire davantage sans risquer de dévoiler les secrets de ce roman qui rendra également le lecteur obsédé par la quête de la vérité.
Disons qu'il s'agit bien d'un roman policier car il y a des meurtres sordides au fil des pages mais il faut avant tout voir dans Garden of love une histoire sur la psychologie humaine et même sur la maladie mentale.
Rapidement, le lecteur suffisamment attentif trouve ses marques entre les différents personnages et comprend le lien particulier qui unit Matthieu à Ariel. Il découvre également deux facettes d'un même passé à travers les visions des protagonistes, sains pour certains, malades pour d'autres. L'un d'eux affirme ainsi que « le diable, c'est moi qui l'ai mangé » ou aussi que « chacun d'entre nous est en réalité plusieurs à la fois. »
Mais chut ! Je ne peux en dire plus. Seulement qu'il faut un peu s'accrocher pour bien comprendre l'architecture du roman et les allers-retours entre les années 80-90 et 2000. Qu'on se rassure, l'écriture de Marcus Malte aide en cela le lecteur tant elle est efficace et fluide. Ses qualités de narrateur sont également indéniables.
Au-delà de la dimension psychologique, Garden of love interroge aussi sur la puissance du récit et d'un narratif capable de semer le doute même chez les plus cartésiens. On en vient parfois à se demander si ce n'est pas Alexandre qui est fou. Marcus Malte abordait donc déjà en 2007 le sujet du faux et de la manipulation qui ont aujourd'hui pris une dimension gigantesque dans notre société à travers l'omniprésence de l'IA et le retour des autocrates revisitant l'histoire à leur guise.
On peut aussi y voir, s'il en fallait encore une, une démonstration du pouvoir des livres. Comme Alexandre qui relit le manuscrit, j'ai aussi eu le besoin impérieux de reparcourir le livre en diagonale car de nombreuses phrases prennent un sens différent lorsque l'on a compris qui était qui !
Enfin, la chute finale est à mes yeux réussie : une dernière manipulation sadique à travers le regard d'un enfant innocent qui se poursuit par un petit pèlerinage très émouvant et ouvrant de belles perspectives pour l'avenir de notre héros blessé...
« J'ignore combien de temps nous sommes restés là, Marie et moi. Côte à côte. Immobiles et silencieux. Je ne connais pas les prières. J'ai simplement pensé très fort à eux. Aux shérifs. À Léna. »
J'ai découvert cet auteur il y a quelques années avec Le garçon. Depuis, je parcours avec un grand bonheur l'œuvre qu'il tisse avec talent et sans jamais se répéter. Et pour ceux qui ont aimé Garden of love, il faudra évidemment lire le fabuleux Qui se souviendra de Phily-Jo ? qui aborde le même genre de thématique et manipule encore mieux et avec plus de dextérité selon moi le lecteur.
[Critique publiée le 10/11/25]

L E G A R Ç O N
Marcus Malte - 2016
Zulma - 535 pages
18/20
Le meilleur et le pire de l'âme humaine
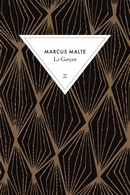 En 1908, deux silhouettes gravitent au loin sur la lande. Il s'agit d'un garçon portant sur son dos sa mère mourante afin de rejoindre la mer.
En 1908, deux silhouettes gravitent au loin sur la lande. Il s'agit d'un garçon portant sur son dos sa mère mourante afin de rejoindre la mer.
Le voyage s'arrête près de l'étang de Berre à quelques encablures de la Méditerranée. Devant la sépulture, désormais seul face au monde, l'adolescent de quatorze ans poursuit son chemin en remontant vers le nord.
De lui, nul ne connaît le nom. Il ne parle pas et n'a croisé que cinq humains seulement au cours de son existence vécue dans une cabane avec sa mère : « Il sait qu'il se trouve d'autres hommes sur terre mais il n'a pas idée de leur nombre. »
Le choc est donc violent lorsqu'il traverse le premier village et tombe nez à nez avec un cheval de Camargue !
Adopté par la communauté paysanne pour aider aux travaux de la ferme, il reste dix mois dans ce nouvel univers. Les superstitions étant omniprésentes à cette époque, le garçon est considéré comme maudit après la survenue d'un tremblement de terre et chassé. Le voilà qui erre à nouveau...
En longeant une rivière, la chance le met sur la route de Brabek « l'ogre des Carpates ». Ce saltimbanque, voyageant à bord d'une roulotte en compagnie d'un hongre, écume la campagne en présentant ses talents de lutteur. Il prend l'orphelin sous son aile.
Le meilleur reste encore à venir lorsqu'à nouveau le garçon se retrouve seul. Et c'est une femme qui va le lui offrir.
Le destin le fait entrer par accident dans la vie de Gustave Van Ecke et de sa fille Emma. Petit à petit, les deux êtres vont se découvrir au sens propre comme au sens figuré. Emma n'est pas décontenancée par le mutisme du jeune homme de dix-huit ans et fustige même le moule étouffant de l'éducation : « L'enseignement qu'ils avaient reçu, elle et ses semblables, l'éducation qu'on leur avait donnée étaient sans doute une fenêtre ouverte sur la liberté, mais n'était-ce pas également une cage ? N'était-ce pas un moule, rigide et fonctionnel, à partir duquel tous étaient créés, façonnés à l'identique ? Un modèle unique - dessiné par qui, destiné à quoi ? »
Avec Emma, pianiste et grande lectrice, le garçon découvre l'art à travers les figures de Chopin, Liszt, Verlaine, Stendhal et le grand Mendelssohn. Il est d'ailleurs affublé du prénom Félix en hommage à ce dernier. Surtout, il fait connaissance avec le plaisir charnel, la puissance de l'amour ; comme près de leur arbre fétiche au bord de l'eau où les deux amants enflamment leurs sens : « En ce lieu privilégié ils s'abandonnent. La douceur de l'air, le murmure de l'onde, le clair-obscur portent à la volupté. Et, n'en déplaise au poète, la langueur n'est pas monotone. »
Félix et Emma éveillent aussi leurs sens avec la littérature érotique et les textes licencieux du grand Victor, de Rimbaud ou d'Alfred de Musset. Et l'auteur, Marcus Malte, d'en reproduire quelques extraits.
Mais, et c'est un truisme, le bonheur ne dure pas éternellement ; il cède la place aux embêtements voire carrément au malheur : « L'un file, l'autre s'éternise. Une simple virgule et c'est quatre années d'existence. Est-ce possible ? » Et ici le mot « malheur » est un euphémisme car c'est de l'apocalypse qu'il s'agit avec l'envahissement de la Belgique par l'Allemagne en août 1914 signant ainsi le déclenchement de la première guerre mondiale.
Emma critique l'absurdité de la guerre qui risque d'être fortement impactante sur la vie des deux hommes qu'elle aime le plus au monde. Elle en veut aux généraux, aux gouvernants et à tous les donneurs d'ordre : « Vont-ils se battre, ceux-là ? Certainement pas. Le courage des autres, le sacrifice des autres : voilà qui leur suffit. Et je n'ai pas l'impression que leur conscience s'en porte plus mal. »
Le garçon quitte ainsi la sensualité, la douceur et le silence pour pénétrer dans l'horreur absolue de la Grande Guerre et sa boue, ses rats, ses cadavres, sa puanteur, ...
Emma continue de refuser cette fatalité dans les lettres qu'elle adresse à son protégé : « Si l'on mettait davantage de moyens dans l'instruction et l'éducation que dans l'armement. Plus de livres et moins de canons ! Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hugo cette fois. »
Marcus Malte signe ici un très beau roman sur la nature humaine. Pour cela, il place un adolescent vierge de tout contact à l'aube du XXe siècle, l'un des pires moments de l'histoire mondiale.
On retrouve ici les grands traits caractérisant le mythe de l'enfant sauvage : le garçon ne parle jamais car son enfance s'est construite en dehors des interactions sociales indispensables à l'apprentissage du langage ; il s'adapte facilement à différents types de communauté humaine et possède un instinct de survie bien au-dessus de la moyenne, ce qui lui permettra notamment d'affronter le cataclysme de la première guerre mondiale avec plus de ressources que ses camarades.
En suivant le parcours de ce personnage, le lecteur pourra se faire son opinion ou du moins réfléchir sur les liens unissant culture et nature : la nature humaine existe-t-elle en dehors de toute interaction sociale ? Quel est l'apport de la culture pour construire une personnalité ?
Félix, ainsi que le surnomme Emma, découvre la beauté absolue. Du corps de sa pianiste aimée il dira qu'il n'a jamais rien vu d'aussi beau ! Puis il côtoie aussi l'horreur absolue et la mort omniprésente sur les champs de bataille.
La confrontation d'une personnalité psychologiquement « vierge » à ces deux extrêmes peut-elle construire un individu raisonnable ? Conduit-elle vers la folie ? La résilience est-elle encore possible ? Visiblement, le garçon, plus que tout autre rescapé de la Grande Guerre, ne semble plus connaître la limite entre le bien et le mal et ne peut que sortir détruit de ses expériences diverses.
Le destin lui aura au moins prouvé que l'homme peut être un génie à travers la musique de Chopin ou la littérature de Hugo et que l'amour fortifie l'âme.
Bref, en plus de la question du destin, ce roman touche à la notion même d'humanité et peut donc poser d'infinies questions.
Le fond du propos, passionnant et érudit, est rehaussé par l'écriture superbe de l'auteur. Marcus Malte enfile ses mots comme de délicates perles. Le vocabulaire est précis et riche, les métaphores lors des chapitres érotiques sont délicates et très joliment orchestrées. Les échanges épistolaires entre Emma et Félix conduisent également à quelques jeux littéraires savoureux donnant davantage de poésie et de grâce au récit.
Enfin, le rythme employé colle à l'histoire : des phrases sèches pour les landes arides du début à celles longues et langoureuses lors des quatre années de bonheur en passant par celles courtes, hachées, suffocantes pour les tranchées.
[Critique publiée le 10/05/20]

Q U I S E S O U V I E N D R A D E P H I L Y - J O ?
Marcus Malte - 2022
(traduit de l'anglais US par Edouard Dayms)
Zulma - 576 pages
20/20
Ne vous rendez jamais à l'évidence
 Cette ténébreuse affaire débute le 17 décembre 1997 par la mort de Philip-Joseph Deloncle au cours d'un cocktail privé à Dallas. Le trentenaire a malencontreusement basculé par-dessus une balustrade de terrasse pour atterrir en contrebas sur le capot d'une Rolls-Royce et se faire perforer le crâne par la célèbre statuette ornant le bouchon du radiateur.
Cette ténébreuse affaire débute le 17 décembre 1997 par la mort de Philip-Joseph Deloncle au cours d'un cocktail privé à Dallas. Le trentenaire a malencontreusement basculé par-dessus une balustrade de terrasse pour atterrir en contrebas sur le capot d'une Rolls-Royce et se faire perforer le crâne par la célèbre statuette ornant le bouchon du radiateur.
Dix jours après ce drame, sa sœur Michelle et son beau-frère Gary reçoivent un appel du cabinet d'avocats Zimmer & Associates. Accueilli par un sosie de J.R. Ewing, le fameux PDG de la série Dallas, Gary et Michelle Sanz se voient remettre leur héritage : dix cahiers grand format ainsi qu'une lettre. Celle-ci leur affirme l'existence d'une mystérieuse invention totalement révolutionnaire permettant de générer de l'énergie à partir du vide : la FreePow. Détenant désormais tous les plans dans les fameux cahiers, la lettre stipule en outre à Gary et son épouse qu'ils devront se méfier de "qui vous savez" tant les enjeux de cette invention pourraient avoir des répercussions gigantesques sur l'ordre mondial établi.
C'est Gary Sanz qui raconte toute l'histoire qui va de la naissance de son beau-frère à l'hôpital Parkland Memorial de Dallas au moment même où JFK y perdait la vie à son premier baiser avec Michelle en 1975 en passant par les études avortées de Phily-Jo à l'université A&M du Texas ou encore son invention du Walk-Man avant l'heure.
Finalement, ne sachant que croire au sujet de cette invention qui ressemble fort à une supercherie et peu rassuré face aux possibles représailles d'une certaine guilde maléfique, le couple va plonger corps et âme dans un univers étrange et oppressant jusqu'au point de non-retour...
Dipak Singh va alors reprendre toute cette histoire depuis le début. Étudiant en sociologie en Virginie-Occidentale, le jeune homme de vingt-six ans s'intéresse de près aux condamnés à mort américains et s'interroge sur le sort des 4% d'innocents, selon une étude, lorsqu'il tombe sur le cas d'un proche de Phily-Jo...
Interpellé par son profil social qui ne rentre pas dans les cases habituelles des meurtriers, Dipak s'interroge alors sur le parcours de ce personnage avant d'être rapidement convaincu de son innocence. Sa quête l'emmène à son tour dans le monde merveilleux de Phily-Jo mêlant énergie libre et complots.
Demandant de l'aide auprès de l'association Innocence Project, spécialisée dans la lutte contre les erreurs judiciaires, il fait la rencontre de la merveilleuse Barbara Grove. Brillante, passionnée de littérature, la jeune femme devient une véritable muse dans la poursuite de l'enquête qui oscille entre jeux littéraires et paranoïa...
La sœur de Barbara vient aussi mettre son grain de sel dans l'affaire. Férue de jeux vidéo, en particulier League of Legends, et traitée pour des problèmes psychologiques, la jeune femme parle sans filtre et est une bonne cliente pour toutes les thèses complotistes. Plongée dans sa vie virtuelle de "gameuse", elle se lie d'amitié avec un certain Tender Wolf qu'elle érige en véritable confident.
Et le tourbillon ne cesse pas à travers l'intervention d'un ancien agent du FBI, Ross Pierce. Posé, méticuleux et intègre, l'homme d'expérience est embarqué dans ce vrai feuilleton et réussit à tout élucider malgré un ou deux points qui lui résistent.
Et nous, lecteurs ?
Qu'avons-nous compris ? Quelle est la réalité ? Qui était Philip-Joseph Deloncle ? Un clown ou un visionnaire ? Et Gary Sanz, un affabulateur ou une victime de complot ? Où est partie Barbara ? Et tous les autres ? Qui croire ? Que croire ?
Marcus Malte nous promène à sa guise dans ce somptueux roman, dans ce jeu littéraire qui nous fait autant rire que trembler. Propagande, manipulation, complot sont les mots-clés de ce pavé dans lequel les mises en abyme sont très nombreuses et donnent le vertige à l'image de la magnifique couverture des éditions Zulma.
L'écriture et le sens de la narration sont vraiment brillants. Le ton est toujours juste, percutant et oscille selon les narrateurs. Malte est vraiment très très doué.
On visite le couloir de la mort du Texas, dans l'unité Allan B. Polunsky, où les conditions carcérales sont impressionnantes : chaque détenu est enfermé vingt-trois heures sur vingt-quatre en semaine et vingt-quatre heures sur vingt-quatre le week-end dans une cellule de moins de cinq mètres carrés.
On découvre avec stupéfaction certains faits scientifiques entourant le célèbre Einstein, le trop peu cité Nikola Tesla ou encore le grand physicien John George Trump oncle d'un certain Donald...
On croise Vladimir Nabokov, Jules Verne, Charles Baudelaire et Shakespeare.
On vit des histoires d'amour très fortes et une scène particulièrement émouvante dans la lignée du Summer of Love de 1967.
Les scandales du tabac et du pétrole entre autres sont présentés et montrent, avec le recul que l'on a aujourd'hui, les gigantesques collusions qui ont eu lieu et qui ont forcément toujours lieu à notre insu et au détriment de notre santé entre de puissants groupes industriels et des hommes politiques avides de puissance. Cela est édifiant et parvient à faire douter le plus cartésien des lecteurs sur d'autres potentielles manipulations paraissant pourtant totalement improbables à première vue.
Jusqu'où vont notre manipulation, notre conditionnement ?
L'auteur du magnifique roman Le garçon sème le doute dans notre esprit dans chacune des parties de son intrigue pour terminer sur un final absolument grandiose, un pied de nez lancé à la face du lecteur. Rares sont les livres qui parviennent à rendre aussi floue la frontière entre réalité et fiction. D'ailleurs, Dipak l'affirme lui-même : « Je me suis dit que dans tout écrit, récit ou fiction, l'auteur manipule le lecteur, que ce soit intentionnel ou pas. » Puis, plus loin : « Jusqu'à douter de ma propre réalité. N'étais-je pas, au fond, qu'un nom de plume ? »
Qui se souviendra de Phily-Jo ? vous met une véritable claque qui vous laissera knock-out pendant plusieurs jours avant de pouvoir retourner vers un autre bouquin ! C'est le genre d'œuvre que l'on ne croise que très rarement dans une décennie à mon humble avis.
Ne vous rendez jamais à l'évidence.
[Critique publiée le 04/10/24]

J U B I L A T I O N S V E R S L E C I E L
Yann Moix - 1996
Grasset - 303 pages
17/20
Le cul(te) de Hélène
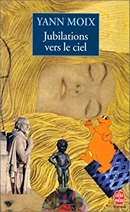 Nestor, le narrateur, relate la passion amoureuse à sens unique qu'il a vécue durant sa vie entière pour Hélène.
Nestor, le narrateur, relate la passion amoureuse à sens unique qu'il a vécue durant sa vie entière pour Hélène.
Dès la vision de cette fille, une alchimie s'est produite en lui ; celle-ci l'a conduit à tous les excès, toutes les tentatives, tous les coups tordus pour l'approcher, la séduire, devenir sa moitié.
Ainsi, Nestor découpe la tête du zouave positionné sur le pont de l'Alma pour la déposer dans le jardin de la bien-aimée, puis écrit le théorème de Pythagore à la peinture sur la route empruntée par le bus qui la mène à l'école afin qu'elle réussisse son interrogation de géométrie, fugue à pied ou en mobylette à travers les plaines de l'Orléanais pour humer la senteur de ses cheveux. Il se rend également dans toutes les librairies de Montargis pour écrire un mot d'amour dans chaque exemplaire en vente de la pièce de Racine, Le Cid, afin que la belle Hélène découvre la déclaration d'amour à l'achat du bouquin dont l'étude est programmée en cours de français.
Emaillé de passages surréalistes et oniriques, ce roman comporte de nombreuses digressions évoquant l'absurdité du monde, l'injustice des peines de cœur, la vacuité des occupations humaines ou encore le pathétisme de la société du spectacle. On y croise Casimir, Fernando Pessoa, Michel Polnareff, Toulouse-Lautrec et même Jacques-Yves Wayne (condensé de Jacques-Yves Cousteau et John Wayne).
Moix fait preuve d'un style original, abouti et exigeant (ne pas oublier de lire la savoureuse bibliographie imaginaire en fin d'ouvrage). En échange, le lecteur doit parfois s'accrocher pour saisir certaines subtilités et allusions glissées à travers de nombreux jeux de mots et effets de style. Ainsi donc, on peut rire, avoir la nausée, jouir intellectuellement puis transpirer sur certains passages complexes.
Une certitude cependant : Yann Moix est un auteur entier qui ne fait pas semblant d'écrire. Il crache, jette, crie, éructe, éjacule son art littéraire avec une force rarement vue. On aime ou l'on déteste, mais on ne peut rester indifférent !
Poussant jusqu'à l'extrême son art de l'écriture, Moix joue avec la logique de la pensée. Son texte recèle de nombreuses pépites ; en voici un exemple dans le délire d'une oraison funèbre imaginée en l'honneur de la muse Hélène : « N'être rien à côté d'Hélène, c'était déjà une forme de grandeur. »
Voici encore un extrait où l'écrivain décrit avec poésie le visage parfait de la jeune femme :
« Ondulés en volutes célestes, entre clair et obscur, les cheveux d'Hélène font sourire jusqu'à ses épaules, qu'elle porte fines et fragiles. Des mèches ricochent en écume sur les vagues à l'âme que dessine son grand front blanc. Ses sourcils sont d'une symétrie de miroir. Sous eux palpitent deux diamants d'un bleu menthe, à la moire mouchetée d'étincelles silencieuses. Chez les autres, on appelle ça des yeux.
La couleurs des lèvres, un rien boudeuse, hésite entre le pourpre de l'anémone et l'orangé du corail. Les joues sont lisses, aiguisées par une perfection de coutelas qui rend le visage menu, presque maigre. C'est quand même incroyable de voir ce que Dieu arrive à faire avec une équerre et un compas. Rien à gommer sur cette figure à la géométrie précise, mélange de chat et d'aigle. Ses dents transpercent le vert brillant des pommes. Oreilles minuscules. Et ce cou où les baisers, tels des ballons à jamais hors-jeu, aiment rouler leur cuir brûlant. Il faudrait des mains spéciales pour le toucher sans l'abîmer. »
Et, pour terminer, ce passage au caractère hautement licencieux qui se pare d'une grâce inattendue à travers une écriture fine, ciselée et métaphorique :
« Les premiers jours, Hélène me refusa son derrière, son popotin ventru moulé dans la braise. Par ignorance ou par superstition, ma belle Sainte canon avait cru devoir exclure Sodome de sa Bible intime. De façon arbitraire, l'inculte avait exclusivement opté pour le triangle d'or, effrayée par le cercle vicieux. Côté face le Paradis, côté pile l'Enfer.
Que d'arguments n'ai-je développés afin qu'elle laissât ma folie s'écouler par ma queue fourchue de diablotin lubrique dans son entonnoir dantesque ! Mais son abîme souterrain, hélas, ne réverbérait pas le moindre écho de mes inlassables requêtes. »
Yann Moix a écrit ce premier roman à vingt-huit ans. Lauréat du prix Goncourt du Premier Roman en 1996, il se positionne d'emblée parmi les plus grands écrivains contemporains par la puissance de son style et la maturité de son propos. Le journaliste littéraire François Busnel considère d'ailleurs Jubilations vers le ciel comme « un des plus grands premiers romans du vingtième siècle ».
[Critique publiée le 19/04/19]

L E S C I M E T I È R E S S O N T D E S C H A M P S D E F L E U R S
Yann Moix - 1997
Grasset - 327 pages
17/20
Je t'aime... moi non plus
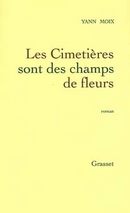 Voici la terrible histoire de Gilbert Dandieu.
Voici la terrible histoire de Gilbert Dandieu.
Installé à Roanne avec Élise et leurs deux enfants, Eléonore et Julien, la vie de cette homme bascule dans l'enfer brutalement. Lors d'un trajet sur l'A10, Élise est victime d'un accident ; les deux enfants sont tués sur le coup. Au moment du choc, « la radio diffusait un sketch. Je suis le seul homme sur la terre à avoir perdu ses enfants à cause de Fernand Raynaud ».
Fou de rage, en souffrance extrême - « je suis orphelin à l'envers » - Gilbert tient sa femme responsable de ce massacre. Il décide alors de faire mener une vie atroce à celle qu'il appelle désormais « assassine », « saloperie », « putain » ou « charogne ». L'observant dans les tâches quotidiennes, il pense : « Continue de t'enlaidir en préparant les nouilles. Mon Dieu que tu es laide entre ton évier et ton placard. »
Évidemment, cette histoire est l'occasion pour Yann Moix de livrer dans son second roman sa vision clinique de la vie. Ici, on n'enjolive pas les choses, on les dit crûment. Et le lecteur prend en pleine face le pathétisme de nos vies quotidiennes à travers de nombreuses digressions, dans le plus pur style moixien, qui montrent avec franchise le manque de sens auquel beaucoup, esclaves de la société prétendument moderne, sont confrontés. Le récit exige donc du lecteur par moments un minimum de force positive mentale pour surmonter le poids véritable de sa propre vie.
Pour tenter de survivre et « oublier » ses enfants, Gilbert Dandieu s'imagine concentrer son esprit ailleurs, sur des sujets totalement futiles que personne n'a encore vraiment étudiés. Développer une érudition extrême sur un thème particulier est la thérapie qu'il compte mettre en œuvre : « Ma vie est ruinée ? Qu'à cela ne tienne : je deviendrai le plus grand spécialiste au monde de la correspondance Dandieu-Collot d'Herbois. Je deviendrai un érudit maniaque en numismatique. Un as de la mécanique des fluides. J'écrirai une biographie de 10 000 pages sur l'acteur Jean Sarus, des Charlots. Nul ne connaîtra mieux que moi la production d'aluminium dans la France de 1929. La botanique me livrera ses secrets. Et plus particulièrement les tulipes. Mon avis sur la tulipe aura valeur internationale. Je mènerai des études sur les gravillons de mon jardin. »
On retrouve là bien sûr toute la folie obsessionnelle du détail qui sera par la suite largement exploitée dans un livre comme Podium, véritable exégèse sur la vie du chanteur Claude François.
Le thème de l'enfance est évidemment présent et cela est d'autant plus marquant quand on sait aujourd'hui à quel point celle de Yann Moix a été très difficile. Il en dresse néanmoins un portrait nostalgique et tellement vrai en l'opposant aux mensonges, calculs et aigreurs de l'âge adulte.
Ainsi, à travers son personnage principal, il énonce que « l'adulte est sérieux dans sa banque, il notifie, certifie, prévoit, il invente des placements, des taux, des maladies sexuellement transmissibles ». Au contraire de l'enfant qui lui « n'oublie rien. Ni la remarque susurrée dans le cou de maman par papa. Ni l'âge du chien. Ni le dernier Noël. Ni la couleur des bottes à pépé. Ni le goût des gommes. Ni les empreintes dans le sable. Ni la tête de cheval du dernier nuage. L'adulte est le brouillon de l'enfant. Je le sais. Le temps se déroule à l'envers. Les hommes meurent avant de naître ».
Mais, et cela ne surprendra personne, le narrateur n'arrive plus à dormir tant les éclats de rire de ses deux enfants lui manquent. Il végète des heures durant devant la télévision et découvre un univers nocturne d'émissions surréalistes, « un monde parallèle réservé aux insomniaques, aux téléphages, aux névropathes, aux suicidaires et aux fous ».
La folie est présente à chaque page et chaque jour de la vie de Dandieu. Éprouvant un chagrin totalement insurmontable aux limites de la démence, il va jusqu'à vouloir intégrer l'école primaire pour retrouver un peu de ses enfants. Son admission en Cm2 est refusée. Il s'astreint cependant à faire ses devoirs, à travailler ses dictées.
Dès lors, comme bien souvent chez Yann Moix, il y a ces dialogues totalement incroyables, farfelus et absurdes qui font tout le génie de cet écrivain et que l'on ne trouve pas ailleurs ! Ici, il s'agit d'un véritable interrogatoire musclé sur les personnages du dessin animé Barbapapa que fait subir Dandieu à l'ancienne maîtresse de ses enfants. Prise au piège, Melle Pier-Gelicka se retrouve face à un type complètement cinglé menaçant de la frapper si elle n'est pas capable de citer le nom de Barbouille à la question : « Qui c'est ? C'est pas difficile, bon Dieu, pour quelqu'un qu'est spécialiste de nos gosses, hein, qui c'est lui là, le noir, qui peint tout le temps ? »
Grandiose ! Toute l'absurdité de la situation réside dans ce décalage, cette disproportion entre le monde merveilleux des personnages de l'enfance et celui adulte de la violente réalité.
Ne trouvant plus aucune raison d'exister, Élise met fin à sa vie et à son cauchemar quotidien. Son mari découvre alors le journal qu'elle tenait et dans lequel elle décrivait l'amour jamais démenti qu'elle a continuellement éprouvé pour l'homme de sa vie.
Là, le roman sombre dans l'excès inverse : Gilbert Dandieu ne hait plus sa femme défunte mais se met à l'aimer plus que jamais ! Et sa folie dans l'amour est aussi forte que celle qu'il manifestait dans le dégout de son épouse avant la découverte de son journal intime.
Il décide de consacrer toute son énergie à aimer une femme morte : « Je vais travailler à cette œuvre, ma seule œuvre, sans relâche. Mon œuvre qui sera ta vie. »
L'homme fonde l'Église d'Élisologie où de nombreux chercheurs retracent l'histoire de la femme aimée et dresse son parcours depuis sa naissance. Toute la vie d'Élise est analysée, disséquée, détaillée ; il y aura « des spécialistes de tes étés, des spécialistes de tes lectures d'été, des spécialistes de tes problèmes de santé, des spécialistes de ta toilette, des spécialistes de tes jambes » confie Dandieu à celle qu'il aime désormais plus que tout au monde.
On ne le dira jamais assez : Yann Moix est l'écrivain de l'excès. Mais c'est un excès fin, intelligent et érudit mêlant absurde, humour et pathétisme. Ses idées, ses digressions, ses dialogues, ses réflexions sont lumineux et criants de vérité. Moix dit les choses avec excès pour mieux appuyer sur la réalité. Son écriture est vraie, sincère, authentique, pointilleuse, exigeante et rend sans cesse hommage à la littérature française par sa qualité et sa beauté.
Fou ou génie, peu importe car comme il le dit lui-même : la littérature et la pathologie sont « des mondes connexes ».
Enfin, notons que ce livre au titre magnifique complète Jubilations vers le ciel et Anissa Corto au sein d'une trilogie consacrée à l'amour fou.
[Critique publiée le 10/05/20]

A N I S S A C O R T O
Yann Moix - 2000
Grasset - 294 pages
18/20
Journal intime d'un névrosé
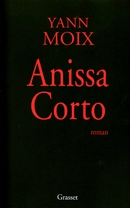 Le narrateur relate sa relation obsessionnelle aux femmes tout au long de ce récit en forme de journal intime.
Le narrateur relate sa relation obsessionnelle aux femmes tout au long de ce récit en forme de journal intime.
Comme l'a défini la psychanalyse, les épreuves de la petite enfance - il faut aussi y ajouter celles de la vie in utero et celles vécues par nos ancêtres d'après la psychogénéalogie - conditionnent notre développement et sont à l'origine des nombreux traumatismes et refoulements qui nous font tant souffrir à l'âge adulte.
En vacances à la mer durant l'été de l'année 1972, un enfant, alors âgé de quatre ans, est confronté à la noyade de sa copine Anne. Cela est déterminant dans sa construction amoureuse : « Mon intimité avec les femmes était devenue dangereuse. Je les aimais trop : en elles je réclamais Anne. »
1972 devient alors l'année de l'obsession, celle de la musique de Neil Young qu'il continue d'écouter sans cesse, celle d'Anne qu'il ne cesse de chercher dans les relations amoureuses qu'il entreprend.
Adulte, il se réfugie dans cette année charnière par la pensée, le souvenir. Yann Moix dresse ainsi une cartographie du temps, une géographie temporelle. Il écrit : « Nous avons tous une année fétiche, une année éternelle qui coule ses jours innocents, préservés de toute guerre, à ras bord de jeunesse, et nous protège du présent, et nous préserve de l'avenir. »
Après des études sans motivation aucune, il décroche un emploi chez Disney à Marne-la-Vallée. Affublé du costume de Donald Duck, l'anonyme prend alors la peau du célèbre canard. Ce déguisement rend palpable le masque que nous portons tous dans nos sociétés modernes. La vie occidentale n'est qu'une grande pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Ici, la farce est portée à son paroxysme à travers un être humain déprimé et névrosé qui pose avec parents et enfants, entre Mickey et Pluto, en arborant sans cesse un sourire de pacotille.
Comme dans la plupart de ses livres, Yann Moix dénonce la vacuité de l'existence rythmée par une consommation effrénée, les chemins de vie pathétiques que les esclaves du travail se construisent. Les « engouffrés », comme il les nomme, passent leur vie à s'engouffrer dans le métro, le travail, la cantine, le lit, ... Durant leurs rares vacances, ils se retrouvent tous ensemble à parcourir le monde dans des circuits préfabriqués vendus par les mêmes agences de voyage. Chacun croit fuir un système et le dominer mais, en réalité, y reste enfermé comme une mouche dans un bocal.
Comme chez Houellebecq, il y a ce côté déprimant dans les thèmes chers à Moix qui ménage rarement le lecteur en lui renvoyant en pleine figure qui il est réellement. Mais cette lucidité, cerclée de son écrin littéraire, est parfois salvatrice en permettant de prendre du recul sur nos vies éphémères, notre monde financier et de développer notre esprit critique de la société. C'est ainsi que je l'interprète pour ma part...
Comme il le fera plus longuement dans Podium avec moult détails sur les épreuves permettant de devenir sosie de Claude François, Moix décrit avec précision l'entretien et l'examen nécessaires pour devenir marionnette chez Disney. Ses dialogues délirants et décapants avec l'examinateur, ses descriptions ubuesques des épreuves à concourir constituent des pages délirantes et ô combien jouissives.
Cet humour qui confine souvent à la tragédie est la marque de fabrique de l'auteur. Dans chacun de ses romans, Yann Moix, tel un clown triste, nous fait rire et désespérer simultanément sur notre quotidien. Il sait pointer du doigt les situations absurdes et décrire avec une grande finesse les tourments psychologiques qui nous agitent tous. Clairvoyant sur l'âme humaine et extrêmement doué sur le plan littéraire, il est sans conteste l'un des plus grands écrivains contemporains français.
Durant son époque Donald, le narrateur tombe fou amoureux d'une jeune femme d'origine algérienne. C'est une relation à sens unique : elle ne s'aperçoit de rien tandis que lui ne pense plus qu'à elle jusqu'à l'obsession. Il la suit, tel un psychopathe, et découvre qu'elle loge dans un HLM de la cité Henri-Barbusse. Il apprend aussi qu'elle se nomme Anissa Corto.
À partir de là, il n'y a plus de mot pour décrire la fièvre qui l'anime, la névrose qui l'habite nuit et jour. Le narrateur confie : « Elle m'obsédait ; sa beauté m'empêchait de dormir la nuit. »
Le nom même de la cité où vit Anissa Corto devient un sujet d'intérêt capital : « Très vite, Henri Barbusse devint pour moi un écrivain culte. »
Il rôde sans cesse près des bâtiments, s'imprègne du quartier, étudie Barbusse et s'empresse de louer l'appartement de celle qui incarne son amour de 1972 lorsque celui-ci est libéré. De façon rétroactive, il parvient ainsi à vivre avec elle en dormant dans sa chambre, en ouvrant les mêmes portes, ...
Yann Moix, féru de mathématiques à travers les références qu'il glisse dans la plupart de ses écrits, distord même le référentiel du temps pour transformer les quelques secondes que dure un regard échangé entre son personnage et son amour en une longue période de vie commune. Tout n'est qu'une question de référentiel finalement ! Et dans cette ré-écriture temporelle, l'auteur réussit à presque vivre avec Anissa Corto.
Le génie de Moix est d'aller très loin dans ses réflexions, digressions et délires en tout genre. Pour autant, son discours ne sombre jamais dans l'incohérence mais garde toujours une rigueur et une logique inébranlables, à condition que le lecteur reste concentré...
L'écrivain né en 1968 théorise tout, offre un angle de vue cérébral sur les grands thèmes que sont l'amour, la vie et la mort. Anissa Corto, son troisième roman, le prouve une fois de plus. À ces grands motifs shakespeariens vient s'ajouter la folie qui, en accompagnant le lecteur dans le numéro final, apporte toute sa dimension à cette bouleversante tragédie.
[Critique publiée le 03/09/17]

R O M P R E
Yann Moix - 2019
Albin Michel - 108 pages
19/20
Perpétuellement condamné à détruire toute relation amoureuse
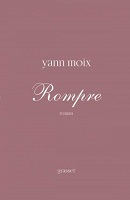 Rencontrer l'âme sœur, tomber amoureux, débuter une vie de couple, l'écrivain Yann Moix l'a réalisé maintes et maintes fois. En revanche, faire durer le bonheur, l'état de grâce, la relation épanouie que peut procurer l'amour, voilà une gageure qui lui semble inaccessible tant il est incapable de ne point mettre un terme à toute relation.
Rencontrer l'âme sœur, tomber amoureux, débuter une vie de couple, l'écrivain Yann Moix l'a réalisé maintes et maintes fois. En revanche, faire durer le bonheur, l'état de grâce, la relation épanouie que peut procurer l'amour, voilà une gageure qui lui semble inaccessible tant il est incapable de ne point mettre un terme à toute relation.
Sa terrible enfance explique en grande partie son comportement actuel : « Toute notre vie, nous cherchons à collecter les hématomes du passé. Se retrouver en situation de supplice, telle est la passion, jusqu'à sa mort, de celui qui enfant s'est fait rouer de coups, a subi les outrages les plus abjects. »
Car le jeune Yann a beaucoup souffert. Il a déjà abordé ce sujet dans plusieurs de ses précédents livres et il le fera encore certainement tant les plaies sont toujours à vif et l'impact sur sa vie actuelle omniprésent. Il est injuste et inhumain de penser qu'au pays de son enfance, on lacérait à coup de rallonges électriques, on tapait dans les côtes, on cognait le visage, on menaçait de mort avec un couteau de boucher à la main. Sans compter les excréments à avaler, les humiliations en famille, les poèmes, premiers romans et livres d'étude volés, confisqués, détruits. Terrifiant...
« Avoir été frappé enfant a gâché toute ma vie, a souillé, a gangréné mon existence tout entière. »
C'est en partie sa précédente et excellente œuvre, Dehors, qui l'a indirectement conduit à écrire ce nouvel opus. Il s'est tellement investi dans son enquête sur le traitement honteux des migrants par notre République qu'il a fragilisé son couple avec sa compagne, Emmanuelle. La machine infernale s'est ainsi mise en branle, alimentée par son besoin de souffrir dû à son enfance torturée.
Avec une acuité et une logique dans lesquelles il excelle, Yann Moix décrypte le mécanisme de la rupture depuis sa date de début jusqu'au point de non-retour qui acte que la relation est définitivement révolue. Dès lors, l'amant éconduit devient « triste à mourir, abattu sur ma moquette, le nez dans les acariens, reniflant comme un maudit ». La douleur est telle qu'il rajoute dans le plus pur style moixien : « Je contre-existe. Je contre-vis. Je contre-respire. Mon cœur contre-bat. »
Rompre se lit comme une longue confidence sur son mode de fonctionnement avec les femmes. Comme à son habitude, il frappe fort dans l'analyse presque clinique de ses sentiments, il cérébralise la notion de couple jusqu'à la déconstruire brillamment : « Je suis sidéré par cette aliénation de l'homme, de la femme, qui n'ont de cesse de se cadenasser dans ce qui apparaît comme le contraire même de l'amour et de la vie : une institution morbide, livide, rigide. Le couple sanctionne et punit ; il brime et surveille ses occupants. Il est équipé de miradors. »
Parfois, les livres de Moix me font penser à des équations mathématiques tant la logique et la rigueur du propos dominent le texte. L'homme avait débuté des études en maths sup, cela explique sans doute en partie son esprit cartésien.
« Le passé est supérieur à l'avenir. Le passé est le lieu où l'on naît ; l'avenir, le lieu où l'on meurt. On prétend que l'optimiste aime l'avenir et le pessimiste, le passé. Or, préférer l'avenir au passé, c'est préférer ce qui va mourir à ce qui est né. Aimer l'avenir, c'est aimer la mort. Le passé n'est ni statique, ni clos. L'avenir est borné par la mort quand le passé, lui, reste ouvert de toutes parts, béant, mouvant, renouvelé, évoluant ; il remue ; il surprend ; il étonne. Il palpite. Il ne cesse de charrier des nouveautés, de publier des inédits. [...] Rien n'est moins achevé que ce qui est révolu ; rien n'est plus infini que ce qui est terminé. »
À cette précision dans le contenu vient s'ajouter la forme. Le texte est ciselé avec un talent hors-norme. Les formules percutantes, les aphorismes, le riche vocabulaire, les références littéraires sont un délice et témoignent de sa qualité d'écrivain. Peut-être le plus brillant de sa génération.
C'est en 1977, en CM1, que le petit Yann, alors privé de classe de neige, se réfugie dans l'édition 1974 du Petit Larousse illustré et découvre sa vocation, sa vie : « première sensation que rien, au monde, ne serait plus puissant que la littérature. »
Plus loin, il clame encore son amour des lettres : « Être écrivain détermine tout ce que je suis. Je ne me définis qu'ainsi dans mon rapport aux autres et au monde. »
Enfin, moins dans ce roman que dans le génial Podium entre autres, Yann Moix glisse quelques phrases délicieuses par leur caractère burlesque ; ainsi, par exemple, lorsqu'il parle d'une « compagne délaissée depuis longtemps, pour qui je n'ai jamais eu plus de sentiments qu'à l'égard d'un pigeon, d'un pot de yaourt ou d'un morceau de trottoir ».
Moix, génial écrivain de la rigueur et de l'absurde !
[Critique publiée le 19/04/19]

T R O I S J O U R S E T U N E V I E
Pierre Lemaitre - 2016
Albin Michel - 279 pages
16/20
Le poids du secret
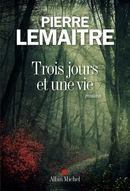 Ce récit narre la vie d'Antoine Courtin sur trois époques : 1999, 2011 et 2015.
Ce récit narre la vie d'Antoine Courtin sur trois époques : 1999, 2011 et 2015.
La première période correspond à l'accident tragique dont il va être responsable. Âgé de douze ans, Antoine, dans un accès de violence involontaire, tue par accident un petit garçon de six ans nommé Rémi Desmedt. Contrarié par la mort du chien de Rémi, dont ce dernier n'était en rien responsable, Antoine le frappe alors qu'ils sont dans la forêt qui borde Beauval, leur petit village provincial.
Très vite après ce meurtre surgit la grande tempête de 1999 qui dévaste une bonne partie de la France. La région forestière où se situe l'action n'est pas épargnée par les dégâts. Antoine, qui a caché le corps de Rémi dans la forêt sans vraiment réfléchir à son acte, bénit ce cataclysme météorologique qui redistribue les cartes et rendra les fouilles plus complexes lorsque la disparition du garçonnet sera découverte.
Le meurtrier s'enferme dans le déni et le mensonge durant des jours, des mois et des années.
Le lecteur découvre alors, en 2011, la vie d'Antoine devenu adulte. Installé loin de Beauval qui lui rappelle trop le drame, il tente de se construire une existence. Mais le passé peut surgir à tout instant et ses démons avec...
Ce roman se lit facilement ; l'écriture de Pierre Lemaitre est fluide et va à l'essentiel. Ainsi, le lecteur est vite happé par cette histoire qui traite avant tout du poids de la culpabilité, du remord, du mensonge.
Ce qui m'a attiré dans ce récit dramatique est de découvrir comment Antoine surmonte au quotidien le terrible secret qu'il garde en lui. Jusqu'où peut-il tenir ? Inévitablement, le lecteur est amené à réfléchir sur la façon dont il aurait procédé. Le point de bascule réside dans les premiers instants après l'assassinat : doit-on libérer sa conscience ou peut-on s'enfermer dans le mensonge jusqu'à ne plus croire à la réalité ? Cette dichotomie psychologique est fascinante et chacun peut être amené à la vivre un jour malheureusement...
Le lieu de l'action est également judicieusement choisi. Ainsi, à l'enfermement psychologique d'Antoine se rajoute l'isolement géographique d'un village de province. À Beauval, tout le monde se connaît et chacun soupçonne son voisin. La terrible tempête qui s'abat expose encore davantage les habitants à la promiscuité en coupant de nombreuses voies d'accès vers l'extérieur.
Enfin, notons que l'auteur, prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut, remercie à la fin de son livre quelques auteurs que j'apprécie énormément : Yann Moix, Marc Dugain et David Vann entre autres.
[Critique publiée le 19/04/19]

S U K K W A N I S L A N D
David Vann - 2008
Gallimard - 232 pages
18/20
Noirceur absolue
 Jim part avec son fils Roy sur une île totalement déserte sur laquelle il acheté une maisonnette. L'endroit, Sukkwan island, est situé aux confins de l'Alaska dans une région dont la géographie est extrêmement découpée et la densité humaine très faible.
Jim part avec son fils Roy sur une île totalement déserte sur laquelle il acheté une maisonnette. L'endroit, Sukkwan island, est situé aux confins de l'Alaska dans une région dont la géographie est extrêmement découpée et la densité humaine très faible.
Jim a quitté son travail de dentiste et veut prendre un nouveau départ après deux histoires d'amour ratées. Durant une année, il compte ainsi faire sa propre introspection, vivre paisiblement au contact de la nature et surtout offrir à Roy, son garçon de treize ans, une expérience de vie hors du commun.
Les premières semaines sont rythmées par les activités de pêche, chasse et travaux d'amélioration de leur maison en bois. Les deux hommes, confrontés à la solitude la plus extrême, doivent en effet subvenir eux-mêmes à leurs besoins en nourriture et chauffage notamment.
Cependant, la richesse des relations humaines fait vite défaut dans cet endroit hostile du bout du monde où les éléments naturels montrent toute leur rudesse. Roy ne sait pas vraiment pourquoi il a suivi son père. Très vite, il se met à penser à sa mère et sa petite sœur chez qui il vivait avant ce voyage.
Et surtout, il entend son père sangloter chaque nuit et marmonner des angoisses qui semblent le ronger mais dont il n'évoque jamais l'existence en journée. L'adolescent s'interroge et se sent finalement aussi responsable de son père que réciproquement.
Jusqu'au jour où tout bascule. L'inévitable se produit. Le cauchemar commence.
Impossible d'en dire davantage sans dévoiler la mauvaise surprise qui se produit au milieu de l'histoire. Un conseil tout de même : avant la lecture, ne regardez surtout pas la dernière page du premier chapitre sous peine de tomber sur la phrase choc qui défie totalement la logique du lecteur. Car moi non plus je n'avais rien vu venir. Bien sûr l'ambiance lourde et sombre laissait présager un dénouement tragique. Mais pas de cette façon !
Comme dans le roman La route de Cormac McCarthy, il faut s'accrocher pour supporter la noirceur du récit dès la première page. Rien de positif ne vient émailler le texte, tout n'est que pessimisme, solitude, tempête, destruction, pleurs, nostalgie, repli sur soi, ...
Le style littéraire illustre également ce dénuement avec des phrases sèches, sans fioriture et des dialogues livrés de façon brute au lecteur.
C'est en 2008 qu'un journaliste du New York Times tombe un peu par hasard sur ce court livre publié à l'époque chez un petit éditeur universitaire américain. Il en livre une critique dithyrambique qui offre à l'ouvrage une tribune inespérée. Dès lors, et particulièrement en France, le succès est phénoménal. La presse s'emballe pour le roman de David Vann et The Guardian affirme même : « Jamais pareil livre n'avait été écrit. »
L'auteur, né sur une île d'Alaska en 1966, a perdu son père de façon tragique et s'est évidemment inspiré de son enfance tourmentée pour écrire Sukkwan island. Aujourd'hui, il poursuit son œuvre dans cette veine littéraire qui explore les méandres de l'âme humaine et explique comment, dans certaines situations de huis clos notamment, ceux-ci peuvent conduire à l'explosion de la cellule familiale.
[Critique publiée le 03/09/17]

U N B O N J O U R P O U R M O U R I R
Jim Harrison - 1973
10/18 - 223 pages
14/20
L'Amérique des « loosers »
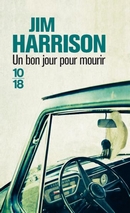 Le narrateur, un type de vingt-huit ans, rencontre par hasard lors d'une partie de billard dans un bar un prénommé Tim. Les deux compères, sur un coup de tête, se lancent alors dans une virée folle à travers l'Amérique des années 70 avec pour dessein de faire exploser un barrage en construction sur le Grand Canyon.
Le narrateur, un type de vingt-huit ans, rencontre par hasard lors d'une partie de billard dans un bar un prénommé Tim. Les deux compères, sur un coup de tête, se lancent alors dans une virée folle à travers l'Amérique des années 70 avec pour dessein de faire exploser un barrage en construction sur le Grand Canyon.
Ils prennent la route et font une halte dans une petite ville où Tim invite son amie, Sylvia, à les accompagner.
Tim est un beau gosse dont le visage est profondément marqué par une cicatrice, mauvais souvenir du Vietnam. Le narrateur évoque vaguement sa vie familiale à travers sa femme et sa fille qu'il semble vouloir fuir. Sylvia, elle, est une beauté qui s'accroche à Tim malgré l'indifférence de celui-ci. Les deux tourtereaux entretiennent une relation amoureuse complexe faite de hauts et de bas.
Le trio se lance donc à travers les États-Unis pour atteindre ce fameux barrage qu'ils accusent de tous les maux dont la nature est victime car construit « par pure cupidité et dans le mépris le plus total de la nature et de ses exigences ».
Passionné de pêche, le conteur de cette histoire craint plus que tout la destruction des forêts et des magnifiques rivières qui les traversent. Dynamiter un barrage est un acte de résistance, une façon d'exister dans une Amérique à deux vitesses où de nombreux individus sont broyés par le système libéral et peu démocratique bien souvent.
Les trois amis mènent une vie de débauche totale. Ils ingurgitent médicaments, drogues, alcools et cela dans des mélanges souvent douteux et dangereux. Le désir sexuel est aussi synonyme de dépravation à travers la présence de Sylvia qui rend le narrateur fébrile tout au long du road-movie. Bref, ces personnages n'ont ni tabou, ni pudeur et brûlent leur vie par les deux bouts sans penser au lendemain.
Sylvia, souvent nue dans une douche ou sur son lit, électrise l'ambiance et pimente cette chevauchée de la perdition. L'histoire finit en drame bien sûr, comment cela pourrait-il être sinon ?
Second livre de Jim Harrison, ce n'est ni son plus grand succès ni son meilleur. Mais tout son univers et sa verve si typique sont déjà là : la pêche, les arbres, les rivières, les grands espaces, les jolies filles, les paumés et éclopés en tout genre. Et tout cela dans un style littéraire direct, franc, sans langue de bois. Harrison balance ce qu'il a à dire et il a toujours fonctionné ainsi semble-t-il.
Né en 1937, cet écrivain a eu une vie tourmentée. Borgne à sept ans, scénariste pour Hollywood avec l'ami Jack Nicholson, consommateur de drogues, alcools et filles, en proie à plusieurs profondes dépressions, « Big Jim » a depuis de nombreuses années trouvé un équilibre paisible entre l'écriture de romans, les parties de pêche en rivière et son gargantuesque appétit pour la bonne cuisine.
Dans l'ensemble de ses livres, on retrouve un peu de lui dans chacun de ses personnages. Son besoin permanent de nature et de paysages grandioses transpirent dans ses écrits. Son désir de vivre tel un épicurien est également très prégnant.
Au final, dans ce récit dont le contenu n'est finalement pas très dense, Harrison embarque le lecteur dans un road-movie mené par un triangle amoureux compliqué. On est en immersion dans l'Amérique profonde, celle du revers de la médaille, des loosers, des vieilles carcasses Ford sur le bord de la route poussiéreuse et des pin-up abimées par la vie dans des motels sordides. Il ne manque plus que Bill Monrœ et son bluegrass dans les oreilles pour s'y croire vraiment...
[Critique publiée le 19/11/16]

L A G R A N D E N A G E U S E
Olivier Frébourg - 2014
Mercure de France - 154 pages
12/20
Un homme partagé entre ses rôles de père, mari, peintre et marin
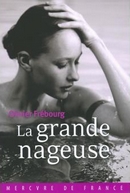 Au sein de la presqu'île de Quiberon, le narrateur nous livre ses premiers émois d'adolescent au sujet de Gaëlle, une femme d'origine bretonne et vietnamienne, blonde aux yeux bleus et à la peau de couleur résine.
Au sein de la presqu'île de Quiberon, le narrateur nous livre ses premiers émois d'adolescent au sujet de Gaëlle, une femme d'origine bretonne et vietnamienne, blonde aux yeux bleus et à la peau de couleur résine.
Quelques années plus tard, il s'éprend de Marion, la fille de Gaëlle. Svelte, sportive et intelligente, Marion se passionne pour la nage et la plongée en mer.
Lui, fils de capitaine de la marine marchande, fait l'École navale à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Affecté en Martinique, à Fort-de-France, il s'y installe avec la belle Marion. Elle partage son temps entre la plongée en apnée dans les chaudes eaux antillaises et l'étude de la culture gréco-romaine.
Parallèlement à sa carrière brillante dans la Marine nationale, le narrateur est obsédé par la peinture. Durant ses deux années loin de la Bretagne, il décrit ainsi son univers : « Mon horizon : Marion, la peinture, la mer. »
La naissance de leur fille, Louise, vient compléter cet horizon par le statut de père.
Dans ce couple, chacun est finalement happé par ses obsessions : elle, la mer ; lui, la peinture et le travail. Philosophe, il pose le constat suivant : « Le monde est ainsi fait : les hommes sont des marins et les femmes des nageuses. »
Puis, c'est le retour en Bretagne où il se voit proposer le commandement du Jaguar, un bateau école qu'il fait manœuvrer dans la rude mer d'Iroise.
La peinture et la plongée happent chacun aux confins de sa passion jusqu'au drame final...
Olivier Frébourg est un écrivain et éditeur passionné de mer. Également navigateur, il fait ici voyager le lecteur entre le Morbihan auquel il semble très attaché et les Antilles où la vie des deux tourtereaux paraît lascive, déconnectée des réalités quotidiennes.
Le sujet majeur du livre réside dans le tiraillement intérieur, presque métaphysique, auquel est confronté le personnage principal. À la fois père, mari, peintre et marin, il ne semble pas réussir à tout endosser dans son esprit et chaque jour lui apporte de nouvelles questions sur sa place dans cet ensemble de rôles et responsabilités.
L'essoufflement du dialogue dans un couple est également un thème qui apparaît en filigrane.
Concernant les réflexions autour de la peinture, j'ai relevé une phrase intéressante : « La peinture, ce devait être la désobéissance. »
En effet, un art se renouvelle et explore de nouveaux modes d'expression lorsque les artistes qui en sont les dépositaires osent dépasser, transcender, remettre en question les règles implicitement établies, les codes admis et ancrés chez chacun. En peinture, on peut et doit tout oser.
Le style littéraire de ce roman est d'une veine très classique, entre Flaubert et Proust. Très peu de dialogues jalonnent une écriture lente, descriptive et contemplative. Finalement, c'est essentiellement l'histoire en elle-même qui m'a quelque peu ennuyé.
[Critique publiée le 27/10/15]

P L U S R I E N Q U E L E S V A G U E S E T L E V E N T
Christine Montalbetti - 2014
P.O.L - 285 pages
12/20
Désenchantement américain au bord du Pacifique
 Le début de cette histoire américaine relate l'arrivée d'un personnage dans une bourgade côtière après un long périple sur les routes de Californie.
Le début de cette histoire américaine relate l'arrivée d'un personnage dans une bourgade côtière après un long périple sur les routes de Californie.
Le lecteur ne saura pas d'où il vient ni qui il est vraiment mis à part qu'il est français.
Échoué à Cannon Beach, petite ville de l'Oregon située en bordure du Pacifique, le narrateur loue une chambre dans un motel et prend ses quartiers dans le bar de Moses, lieu de rassemblement des quelques locaux en cette morte saison. Il y fait la connaissance de trois personnages : Colter, Shannon et Harry Dean. Marqués par la vie, ceux-ci tentent de refaire le monde et ressassent leurs histoires du passé au goût amer.
À travers le prisme de son personnage principal, Christine Montalbetti entrelace ainsi plusieurs parcours de vie et aborde même, à travers une histoire d'amour déchue, la traversée de l'Amérique d'est en ouest entreprise par les explorateurs Lewis et Clark en 1804...
Non loin rôde un autre personnage au charisme inquiétant. Mc Cain, d'origine irlandaise, symbolise à lui seul la cruauté des États-Unis. Entouré de quelques malfrats, il règne sur ce petit monde provincial à la manière d'un chef de bande.
De façon insidieuse, des signes que le français ne perçoit pas véritablement vont s'accumuler au fil des pages et faire monter la tension jusqu'à l'événement final. Une allusion de Colter aux « grenouilles » pour désigner les français ou un reproche de Shannon à l'encontre des mêmes français pour ne pas avoir levé le petit doigt lorsque son frère est mort en Irak illustrent ces messages à demi-mot que le narrateur ne saura pas interpréter.
L'auteur tisse un roman âpre et brosse le portrait d'une Amérique loin de l'American way of life. Elle s'inscrit dans la veine du roman social qui montre que cette nation de héros comporte sa face sombre, sa misère, ses individus broyés par le système libéral, ses victimes des crises financières et sociales, son racisme ethnique sous-jacent dont notre français fera les frais.
Cette tragédie est d'autant plus forte qu'elle prend place dans un décor où la nature sauvage est omniprésente, où l'océan impose sa force et les volcans leurs éruptions chaotiques.
Le style littéraire de Montalbetti est original. Les phrases sont souvent très longues car remplies de digressions. Néanmoins, cela est extrêmement plaisant à lire et n'amène en aucun cas une lourdeur stylistique.
Globalement, même si la forme de ce livre m'a donc séduit et que le début est très prometteur, j'ai trouvé le propos un peu déconcertant et poussif. Le message délivré par l'auteur n'est pas clairement établi, l'histoire se traîne et manque d'unité, la chute finale laisse sur sa faim. Quant au narrateur, on regrette aussi de ne pas en connaître davantage à son sujet.
Ce titre a obtenu le prix Henri Queffélec 2015 remis par six jurés, dont Makibook, sous la présidence d'Alain Jaubert au festival Livre & Mer de Concarneau.
[Critique publiée le 27/10/15]

U N E F E M M E S I M P L E
Cédric Morgan - 2014
Grasset - 169 pages
12/20
Hommage à une bretonne du XIXe siècle
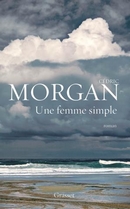 Jeanne est une géante, de carrure imposante, pleine de force à revendre. Dans la Bretagne du XIXe siècle, elle occupe la fonction de batelière-passagère dans les méandres du golfe du Morbihan.
Jeanne est une géante, de carrure imposante, pleine de force à revendre. Dans la Bretagne du XIXe siècle, elle occupe la fonction de batelière-passagère dans les méandres du golfe du Morbihan.
Sur une petite embarcation à voile et équipée d'avirons, elle transporte ainsi personnes, marchandises et animaux entre le port de Logeo et Vannes. Quels que soient le temps et la mer, elle assume la mission qu'elle s'est donnée et n'hésite jamais à mettre sa vie en péril pour sauver naufragés et cargaisons tombées à l'eau.
Jeanne se marie avec Louis, un pêcheur d'Islande. Leur premier enfant meurt au bout de quelques mois. Elle surmonte cette horrible épreuve et met au monde deux autres filles. Plus tard, elle perd malheureusement son mari, emporté par les affres d'un terrible métier dans des eaux froides et éloignées du nid breton.
Son incompréhension est totale : « Elle sentait la colère monter en elle, l'envahir. Elle en voulait au bon Dieu, soi-disant bon, soi-disant tout-puissant, qui déjà lui prenait sa fille et qui, en supplément, au lieu d'exaucer les prières de l'enfant, lui arrachait un père, tuait l'époux. »
L'écrivain Cédric Morgan nous plonge dans une Bretagne enracinée dans ses traditions, dans ses croyances religieuses, dans l'âpre vie quotidienne de la première moitié du XIXe siècle. Comme dans l'œuvre de Thomas Hardy, la fatalité s'abat impitoyablement sur les vies et broie les destins de façon brutale.
Quant au contexte de création du roman, l'auteur a imaginé la vie de cette femme à partir de très rares indications.
Ainsi, Jeanne a réellement existé ; dans une impasse du port du Logeo se trouve une plaque portant l'inscription « Jeanne Le Mithouard (1778 - 1842) ».
Le livre témoigne d'une belle démarche qui vise à mettre en lumière la vie d'une femme oubliée de tous.
Cédric Morgan imagine même une personne aux idées subversives qui n'hésitait pas à rejeter le lourd carcan de la religion de mise en Bretagne à cette époque : « Aux yeux de la religion la vertu d'une jeune fille, voire d'une femme, consistait dans l'absence de désir. Cette idée lui avait paru très tôt contre nature. »
[Critique publiée le 27/10/15]

L A L I S T E D E M E S E N V I E S
Grégoire Delacourt - 2012
Le Livre de Poche - 183 pages
8/20
L'argent ne fait pas le bonheur...
 Jocelyne, mercière à Arras, est mariée à Jocelyn. Ils mènent une vie simple et assez routinière, chose qui semble tout à fait convenir à leur équilibre et à un certain bonheur.
Jocelyne, mercière à Arras, est mariée à Jocelyn. Ils mènent une vie simple et assez routinière, chose qui semble tout à fait convenir à leur équilibre et à un certain bonheur.
Bien sûr, ils nourrissent comme tout le monde quelques rêves inaccessibles et doivent accepter le lot de contrariétés que la vie amène toujours : le départ de leurs deux enfants ayant quitté le nid familial pour partir « faire » leur vie, une relation amoureuse qui s'est étiolée avec le temps et qui ne possède plus la fougue et la passion des débuts, un mari qui aime un peu trop l'alcool, etc.
Jocelyne s'épanouit socialement avec deux copines, commerçantes elles aussi dans le même quartier, et à travers un blog qu'elle a créé afin de donner des conseils en couture ; celui-ci, les dixdoigtsdor connaît un joli succès.
Poussée par ses deux amies, Jocelyne tente sa chance à l'Euro Millions. Elle remporte la coquette somme de dix-huit millions d'euros !
Elle récupère le chèque auprès de la Française des Jeux, le plie et le cache dans une chaussure en décidant de ne rien dire à personne malgré l'agitation qui secoue Arras lorsque la nouvelle s'y répand.
Jocelyne se contente principalement de faire des listes de ce qu'elle souhaiterait posséder en se demandant si cela contribuera à lui apporter du bonheur. À côté de cela, elle regrette de ne rien pouvoir améliorer au sujet de son père qui souffre d'une maladie lui causant une amnésie totale toutes les six minutes.
C'est Jocelyn qui découvre par hasard le chèque et précipite le couple dans le chaos...
Ce livre court possède évidemment une portée philosophique dans le sens où il fait réfléchir le lecteur sur la notion de bonheur.
Le bonheur est-il immatériel ? Argent et amour sont-ils compatibles ? Vivre l'instant présent est-il suffisant pour être heureux ? L'accumulation d'argent rend-il fou ?
Malgré le vaste horizon de réflexion ouvert par ce roman, j'ai trouvé son contenu étriqué. Le lecteur étouffe un peu dans le monde de Jocelyne qui semble gris, terne, chaque jour ressemblant au précédent. Même si cela est parfaitement crédible, j'aurais préféré découvrir un personnage plus empathique, plus passionné, plus expressif. La quasi-absence de dialogue contribue sans doute aussi à ce manque d'air.
D'autre part, la décision de Jocelyn est brutale, ses états d'âme lorsqu'il découvre le chèque ne sont pas assez développés à mon goût. Les conditions de survenue de la dernière partie du récit sont par conséquent trop légèrement évoquées.
Bref, le rythme global manque de profondeur. La portée philosophique reste trop peu exploitée et est dépourvue d'ambition. La littérature permet d'aller bien plus loin. L'adage « L'argent ne fait pas le bonheur » est ici décliné sous une forme littéraire assez fade, manichéenne et naïve. L'auteur a un long passé professionnel de publicitaire, cela est-il un début d'explication ?
Succès public - il en faut pour tous les goûts -, le livre de Delacourt a été aussitôt transposé en film avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine dans les rôles principaux. Gageons que celui-ci soit plus stimulant que le roman.
[Critique publiée le 27/10/15]

L A B A L L A D E D E L ' I M P O S S I B L E
Haruki Murakami - 1987
France Loisirs - 502 pages
17/20
Beau et sombre
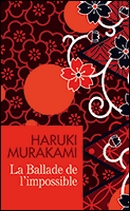 Alors qu'il est à bord d'un Bœing 747, Watanabe entend le doux morceau des Beatles intitulé Norwegian Wood. Aussitôt, cette musique le replonge dans sa jeunesse, à l'aube de ses vingt ans, durant l'automne de l'année 1969.
Alors qu'il est à bord d'un Bœing 747, Watanabe entend le doux morceau des Beatles intitulé Norwegian Wood. Aussitôt, cette musique le replonge dans sa jeunesse, à l'aube de ses vingt ans, durant l'automne de l'année 1969.
À cette époque, dix-huit années auparavant, Watanabe étudiait les grandes œuvres du théâtre dans une université de Tôkyô, logeait au foyer étudiant et travaillait chez un petit marchand de disques pour pouvoir subvenir à ses besoins. Naoko et Kizuki, ses meilleurs amis, l'accompagnaient dans cette période d'insouciance où tout semblait simple...
Mais un drame se produit avec le suicide de Kizuki.
Amoureuse de ce dernier, Naoko se retrouve seule auprès de Watanabe. Ils deviennent hantés par cette mort soudaine, cette réalité sombre qui les a pris au dépourvu en les faisant entrer brutalement dans les tourments de l'âme.
Les deux étudiants se perdent de vue puis, au hasard d'une rencontre, se rapprochent de façon intime. Malheureusement, Naoko, bouleversée par ses démons, s'éloigne à nouveau et rejoint une maison de repos, la Pension des Amis, située au cœur des montagnes surplombant Kyôto. Là, elle vit en colocation avec Reiko, une autre patiente de trente-huit ans, professeur de musique et qui a décidé de rester dans ce lieu pour aider d'autres malades après sa guérison.
Watanabe est invité à rejoindre Naoko quelques jours. Il fait ainsi la connaissance de Reiko et découvre le fonctionnement de cet hôpital très particulier où chacun s'entraide et où patients et médecins sont sur un pied d'égalité.
Les deux filles vivent dans un petit studio entouré d'une nature apaisante et occupent leurs journées à cultiver des légumes, loin de toute radio ou télévision, outils peu propices à la déconnexion avec le monde anxiogène qui les ont plongées dans leurs souffrances.
Dans le milieu universitaire, Watanabe rencontre lui de nouveaux amis. Il est notamment fasciné par Nagasawa, un étudiant aristocrate qui collectionne les filles et pousse Watanabe au-delà de ses principes en l'invitant à profiter de jolies jeunes femmes le temps d'une nuit après quelques verres d'alcool.
Il fait aussi la connaissance de Midori, une ravissante étudiante un peu excentrique, qui tombe rapidement amoureuse de lui.
Midori est elle aussi marquée par la mort, celle de ses parents dans son cas.
Watanabe se retrouve tiraillé entre Naoko et Midori. Engagé auprès de la première, il tient à ses principes et fait preuve d'intégrité en croyant en sa guérison prochaine et en lui promettant de lui être fidèle aussi longtemps que nécessaire. De nombreux échanges épistolaires rythment le quotidien des amoureux. Mais encore une fois, seul le destin, incontrôlable, conduira Watanabe à résoudre son dilemme...
Haruki Murakami, célèbre écrivain japonais, nous plonge dans la période difficile du passage à l'âge adulte. Son personnage principal, Watanabe, est sérieux, intègre et donc attachant. Solitaire, il se réfugie essentiellement dans les livres et la musique. L'auteur cite ainsi au fil des pages de nombreuses références littéraires et musicales. John Updike, Scott Fitzgerald, Truman Capote, Raymond Chandler, Joseph Conrad, Thomas Mann, Thelonious Monk, Miles Davis, Bill Evans ou encore Henry Mancini sont notamment mentionnés.
Le pouvoir du livre est ainsi décrit par Watanabe : « Je lisais et relisais mes livres, et, fermant les yeux de temps en temps, j'aspirais profondément leur odeur. D'ailleurs, le seul fait de respirer l'odeur d'un livre et d'en feuilleter les pages me rendait heureux. »
Quant à la musique, le titre original du livre fait directement référence à une chanson des Beatles. Reiko joue d'ailleurs de nombreux morceaux pour apaiser l'âme tourmentée de Naoko : Desafinado, La Fille d'Ipanema, Here comes the sun, ...
Dans ce roman reviennent sans cesse deux pulsions extrêmes : celle de la vie et celle de la mort.
La mort s'exprime à travers les suicides (qui ont toujours eu une certaine prévalence au Japon) et les maladies (pour les parents de Midori par exemple) tandis que la vie s'illustre dans le bouillonnement de l'activité sexuelle. Le livre est ponctué de quelques scènes explicites, mais qui, dans ce souci d'équilibre constant entre vie et mort, ont toute leur place.
Le passage dans le monde adulte révèle les craintes souvent enfouies durant l'enfance sous la protection bienveillante des parents. En grandissant, en quittant ses géniteurs, en découvrant la liberté de la vie et l'angoisse du chemin à suivre, certaines personnalités peuvent se renfermer sur elles-mêmes jusqu'à développer des maladies mentales. Murakami décrit avec beaucoup de psychologie ses personnages et tout le roman repose sur l'étude de ces âmes bouleversées perdues entre désir, crainte et réalité. Roman initiatique, étude psychologique, éducation sexuelle, voyage dans l'exotisme d'un pays fascinant : voici les grands thèmes abordés à travers une prose fluide, délicate et poétique par l'illustre Murakami.
À la suite de la lecture de La ballade de l'impossible, j'ai visionné l'adaptation cinématographique réalisée par Tran Anh Hung en 2010. Le film est très réussi : la mise en scène, les acteurs, l'ambiance générale, les décors et le rythme sont fidèles et respectent avec beaucoup de sensibilité l'œuvre littéraire originale.
Une dernière remarque concernant la mise en page chez France Loisirs : de nombreuses erreurs typographiques parsèment le texte. Ainsi, le mot « monde » est à plusieurs reprises mal écrit, des signes de ponctuation mal placés, ...
C'est à se demander si l'éditeur fait encore un travail de relecture ! Décevant.
[Critique publiée le 27/10/15]

T E S S D ' U R B E R V I L L E
Thomas Hardy - 1891
Omnibus - 365 pages
19/20
L'impitoyable fatalité
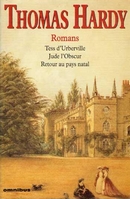 Ce roman victorien débute par la rencontre entre John Durbeyfield, pauvre paysan dans le petit village anglais de Marlott, et le pasteur Tringham qui lui annonce, à sa grande surprise, qu'il n'est autre qu'un des descendants de l'illustre famille des chevaliers d'Urberville.
Ce roman victorien débute par la rencontre entre John Durbeyfield, pauvre paysan dans le petit village anglais de Marlott, et le pasteur Tringham qui lui annonce, à sa grande surprise, qu'il n'est autre qu'un des descendants de l'illustre famille des chevaliers d'Urberville.
Aussitôt requinqué par cette nouvelle inimaginable, Durbeyfield s'empresse de claironner haut et fort sa nouvelle noblesse et charge l'ainée de ses enfants, la jeune Tess, d'aller quémander reconnaissance et travail auprès d'un parent éloigné qui porte encore le précieux nom « d'Urberville ».
Tess, fille pure et innocente dévouée au bonheur de sa famille, quitte donc Marlott, sa bourgade natale située dans le val de Blackmoor au sein du comté de Wessex, un lieu imaginaire créé par l'auteur et faisant partie de la mythologie géographique construite au fil de son œuvre littéraire. Se sentant responsable de la mort du cheval de ses parents lors d'un tragique accident de carriole, Tess arrive à Trantridge chez son noble parent écrasée par la culpabilité d'avoir fait perdre un bien si vital aux yeux de sa famille et investie d'une mission réparatrice.
Alec d'Urberville, le jeune aristocrate qui la reçoit est immédiatement sous le charme de la jeune femme, un charme qui annonce déjà en filigrane une issue fatale : « A travers les écheveaux de fumée qui se répandaient dans la tente, il observait Tess et sa gentille et inconsciente façon de croquer. Tandis qu'elle baissait innocemment les yeux sur les roses de son corsage, elle ne pressentait guère que, derrière la brume bleuâtre du tabac, se cachait le "malheur tragique" de sa vie, celui qui allait devenir le rayon sanglant dans le spectre lumineux de sa jeune existence. Elle possédait un don qui, en ce moment, lui était funeste. »
Engagée pour s'occuper de la basse-cour, Tess s'installe chez celui qui s'est fièrement proclamé son « cousin », encore ébaubi par la vision de cette douce présence venue lui demander assistance.
Exhibant fermement ses sentiments amoureux et refusant d'accepter l'indifférence de Tess à leur égard, Alec d'Urberville commet l'irréparable et viole sa servante dans un bois englué par le brouillard lors d'un retour tardif de fête.
De retour au sein du giron familial, la jeune et innocente fermière met au monde un fils, fruit de sa liaison illégitime, qu'elle baptisera elle-même et qui sera malheureusement la pauvre petite victime d'une mortalité infantile élevée en ces temps anciens.
Brisée physiquement et moralement, bafouée pour avoir commis une lourde faute aux yeux de la société, Tess d'Urberville n'a d'autre choix que de tenter de se reconstruire et surtout continuer à subvenir à ses besoins vitaux.
C'est dans la laiterie de Talbothays, située dans une « plaine verdoyante arrosée par la Froom » qu'elle décide d'offrir ses services. Elle y rencontre Angel Clare, fils de pasteur, pensionnaire lui aussi à la vacherie. Le jeune homme de vingt-six ans y étudie les bestiaux et se forme aux méthodes de culture et d'exploitation. Là encore, l'histoire semble jouée d'avance et Thomas Hardy excelle à inscrire dans les paysages le reflet de l'histoire future : « Dans cette grasse vallée de la Froom aux chauds ferments, où suintait la fertilité, en cette saison où l'on croyait entendre, sous le bruissement de la fécondation, le flot impétueux de la sève, il était impossible que le plus simple caprice d'amour ne devînt passion. Les cœurs étaient tout prêts à le recevoir, imprégnés par ce qui les entourait. Juillet avait passé, et la chaleur de thermidor qui vint à sa suite semblait un effort de la nature pour rivaliser avec le feu qui dévorait les âmes à la laiterie de Talbothays. L'air, si frais au printemps et aux premiers jours de l'été, devenait stagnant, amollissant. Les lourdes senteurs accablaient et, à midi, le paysage semblait en pâmoison. Ces ardeurs éthiopiennes grillaient le haut des pâturages en pente, mais l'herbage restait d'un vert éclatant là où gazouillaient les cours d'eau. Clare n'était pas moins oppressé par le poids de l'été que par la ferveur croissante de sa passion pour Tess, la douce et silencieuse. »
Pourtant rongée par une faute dont elle n'est point responsable, la fragile Tess se laisse porter par ses sentiments envers Clare. Lui cachant son douloureux passé, incompatible avec les conventions sociales de l'époque, elle accepte sa demande en mariage.
Lors de leur séjour nuptial dans une ferme à Wellbridge, Clare apprend la vérité et s'estime trompé sur la pureté de son épouse. Thomas Hardy se fait ici l'avocat de Tess avec brio et une belle philosophie de vie : « Et, en considérant ce que Tess n'était pas, il négligeait ce qu'elle était, et il oubliait que l'imperfection peut être supérieure parfois à la perfection même. »
L'intrigue est jusqu'ici une histoire assez classique traitant des mœurs amoureuses au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. La suite du roman devient plus palpitante car elle conduit à la chute finale, propulsant Tess au cœur d'un tragique destin qu'elle n'aura quasiment jamais pu contrôler depuis cette rencontre fortuite entre son père et le pasteur.
Voilà l'effet effroyable de la fatalité qui est la marque de fabrique de l'écrivain anglais Thomas Hardy et à laquelle sont soumis les individus peuplant son œuvre littéraire.
Né en 1840 dans le comté du Dorset, ce garçon hypersensible, passionné par l'œuvre de Shakespeare notamment, a grandi au sein d'une nature exubérante à laquelle il fait jouer un rôle de premier plan dans ses récits. Ainsi, l'invention du comté du Wessex et de ses cités et le parallèle qui existe entre les paysages et les scènes qui s'y déroulent témoignent d'un grand attachement au milieu rural et d'un hommage à la nature qui, même si elle peut devenir cruelle, est aussi capable d'accompagner des amants vers la félicité absolue.
Le personnage de Tess, par son innocence et ses croyances religieuses, renvoie parfaitement l'image de cette nature mystique. Hardy le décrit de sa plus belle plume dans le passage suivant évoquant le retour au pays natal, le val de Blackmoor : « Les superstitions restent longtemps attachées à ces terres lourdes. Jadis forêt, celle-ci paraissait revêtir à cette heure son ancien caractère ; le proche et le lointain se confondaient ; les arbres, les hautes haies, prenaient des proportions démesurées. Les croyances aux cerfs légendaires, aux sorcières pourchassées, aux fées pailletées de vert et dont le rire moqueur poursuit le voyageur attardé y fourmillaient encore, évoquant en ces parages des multitudes d'esprits malins. Tess passa ensuite près de l'auberge d'un village dont l'enseigne grinçante répondit au salut de ses pas. Elle se représenta sous les toits de chaume, dans les ténèbres, les corps aux muscles détendus sous leurs courtepointes en mosaïques de petits carrés violets, recevant des mains du sommeil des forces nouvelles pour reprendre le labeur du lendemain, dès que la première trace de rose nébulosité apparaîtrait sur les hauteurs de Hambledon. »
L'écrin final dans lequel sont situées les dernières pages est romantique et grandiose. La station balnéaire de Sandbourne, inspiré par la cité de Bournemouth, est décrite comme « un lieu féerique », « un lieu de flânerie méditerranéen sur les bords de la Manche ». Aux alentours, une forêt de pins offre des instants précieux à Tess qui déclare : « Tout est tourment dehors, ici tout est bonheur. »
Cette course folle s'achèvera sur le site mégalithique de Stonehenge qui symbolise à nouveau cette puissance des décors naturels devant lesquels Tess se résignera encore et toujours à accepter sa condition, aussi injuste fût-elle.
Tess d'Urberville est devenu un classique de la littérature mondiale et est, à mes yeux, un chef-d'œuvre incontournable. De nombreuses adaptations en ont été tirées dont le film très réussi de Roman Polanski sorti sur les écrans en 1979 et dans lequel l'actrice Nastassja Kinski a endossé le rôle de Tess avec éclat et conviction.
[Critique publiée le 15/02/13]

R A D E T E R M I N U S
Nicolas Fargues - 2004
P.O.L - 326 pages
16/20
Les expatriés à Madagascar
 Ce roman présente la vie de différents personnages qui, pour une raison ou pour une autre, ont un lien fort avec Madagascar.
Ce roman présente la vie de différents personnages qui, pour une raison ou pour une autre, ont un lien fort avec Madagascar.
Le premier chapitre relate le parcours de Philippe, de l'ONG Ecoute et Partage, venu sur la Grande île apporter un soutien financier et humain aux plus démunis. Derrière la bonne cause se cachent un système financier opaque, des intérêts pas toujours louables et une désillusion profonde quant à l'efficacité réelle du travail des associations sur le terrain.
Tout cela est renforcé par l'attitude détestable, et malgré tout comique, de son jeune associé Amaury. Ce dernier ne veut rien comprendre aux pays du sud et reste focalisé sur sa petite personne de matérialiste occidental. Sa première nuit en tant que « vazaha » est relatée dans un chapitre entier où sa peur des moustiques lui fait lâcher une bordée de jurons monumentale offrant au lecteur une tragédie désopilante. Un passage à lire absolument !
Il y a également le cas de Maurice, le retraité, qui tombe dans le piège classique d'un amour trop beau pour être vrai. Passionnément amoureux d'une malgache, Phidélyce, il décide de tout plaquer pour aller vivre auprès de sa belle malgré les avertissements clairvoyants de ses enfants, restés en France.
Maurice va vite s'apercevoir, une fois là-bas, que Phidélyce aime surtout son nouveau confort financier.
Enfin, un autre chapitre pourrait se lire de façon totalement indépendante tant il symbolise à lui tout seul le fort message de ce livre à mon sens.
Il s'agit du parcours inverse de celui effectué par les autres protagonistes : Grégorien, futur étudiant à Toulon, quitte son île natale pour rejoindre la France, véritable promesse de bonheur, eldorado inaccessible pour la majorité des malgaches. L'auteur décrit essentiellement son arrivée à l'aéroport de Roissy et sa tentative de transfert vers celui d'Orly. Et ce qui nous paraît ordinaire et banal va s'avérer être un véritable exploit pour lui, engoncé dans la légendaire gentillesse malgache qui ne recevra qu'une froide indifférence en métropole.
Dans la peau de ce jeune homme touchant, le lecteur découvre toute l'absurdité de notre monde dit civilisé qui demeure finalement une vraie jungle pour l'étranger. Et, comme le souligne si bien la quatrième de couverture, le bout du monde n'est-il pas autant ici que là-bas ?
Nicolas Fargues a écrit une fiction plaisante et agréable à lire. Les différents acteurs de son histoire nous éclairent de façon pragmatique sur la vie des français à Madagascar.
Le lieu de l'action est situé dans la baie de Diégo-Suarez où l'auteur a exercé un mandat de directeur de l'Alliance française entre 2002 et 2006 (sous la présidence de Marc Ravalomanana renversé depuis, lors du coup d'État de 2009).
Fargues dénonce avec justesse cette attitude toujours actuelle qui fait croire à certains français expatriés ou simplement venus faire du tourisme que l'ancienne colonie leur est définitivement acquise, qu'ils peuvent y régner impunément en maîtres.
Le rôle des ONG est également remis en cause à travers Philippe et sa vision de l'intérieur qui montre l'inadéquation parfois criante entre nécessités quotidiennes, freins administratifs et états d'âme des intervenants.
Voilà un roman qui s'intéresse à Madagascar, terre francophone un peu trop souvent oubliée et qui pourtant renferme des trésors naturels et culturels incroyables. On n'y trouvera cependant ici aucune description digne d'une carte postale idyllique mais juste l'évocation du parcours chaotique d'une poignée d'individus en proie à de profondes remises en cause dans un pays où ils pensaient tout connaître.
Voici pour conclure un petit extrait qui relate le drame vécu par Amaury suite à une piqûre de moustique. Attention, oreilles sensibles s'abstenir : « Il était 3h17 du matin et la chambre avait retrouvé son aspect initial. Il inspecta son mollet. Le petit impact rouge qu'il y distingua lui rappela confusément quelque chose :
"Non... Ne me dis pas que c'est ça ! Non ! C'est pas ça ! C'est pas possible ! NON !! Putain de bordel de merde !! C'est pas un putain de bouton de moustique, ça ? Je me suis fait bouffer le mollet par une saloperie de moustique tropical pendant ma première nuit dans ce pays de merde ? J'y crois pas ! Je vais crever ! C'est sûr, là, j'ai le palu ! C'est fini ! Je vais crever comme un con ! Maman ! Pourquoi j'ai accepté cette mission de merde ? Je le savais ! De toute façon je m'en fous, avant que je crève ils vont payer, ces bâtards ! Ils vont me le payer, ces enculés d'Ecoute et Partage de mon cul ! Je vais leur en faire baver comme des porcs ! Oncle Jean, c'est TOI qui m'as envoyé là en plus ! Tu sais pas ce que tu as fait, tu te rends pas compte, Maman va te tuer ! Oh là là ! J'aimerais pas être à ta place ! C'est peut-être ta petite sœur, mais elle va te casser ta face ! Ils se prennent pour qui, ces enculés, à jouer avec la vie des gens comme ça ? T'habites tranquille dans un pays civilisé, t'as des mecs qui se sont battus pour la médecine, t'as des savants qui se sont cassé le cul pour te faire vivre vieux, et t'as trois enfoirés de sa race qui te font prendre un avion pendant douze heures pour t'envoyer pourrir au Moyen Age ? Dans un pays de merde, de putes, de clodos, de ruines, de 4L et de palu ?" »
[Critique publiée le 13/10/12]

L ' A D V E R S A I R E
Emmanuel Carrère - 2000
Gallimard - 220 pages
16/20
Le terrible destin d'une famille
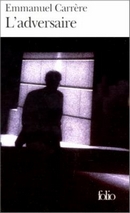 Le 9 janvier 1993 Jean-Claude Romand tue sa femme Florence et ses enfants Antoine et Caroline, respectivement cinq et sept ans. Il commet le même crime à l'encontre de ses parents et de leur chien chez qui il se rend ensuite. Il tentera, en vain, de supprimer également sa maîtresse. Puis, il passera la fin du week-end prostré sur son canapé devant sa télévision et avalera, dans un dernier geste désespéré, des barbituriques avant de mettre le feu à sa demeure. Les pompiers, alertés par les éboueurs, arriveront à temps pour le sauver.
Le 9 janvier 1993 Jean-Claude Romand tue sa femme Florence et ses enfants Antoine et Caroline, respectivement cinq et sept ans. Il commet le même crime à l'encontre de ses parents et de leur chien chez qui il se rend ensuite. Il tentera, en vain, de supprimer également sa maîtresse. Puis, il passera la fin du week-end prostré sur son canapé devant sa télévision et avalera, dans un dernier geste désespéré, des barbituriques avant de mettre le feu à sa demeure. Les pompiers, alertés par les éboueurs, arriveront à temps pour le sauver.
Jean-Claude Romand a construit sa vie sur un mensonge qui l'a entraîné dans une spirale infernale. Ce mensonge est ce poste d'éminent chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Par pudeur et modestie, il parlait très peu de ses activités professionnelles, comportement qui ne faisait qu'accroître l'admiration que nourrissait son entourage à son égard.
L'homme et sa famille étaient installés dans le pays de Gex, entre le Jura et le lac Léman. Dans ce lieu résidaient de hauts fonctionnaires possédant riches villas et voitures de luxe.
Afin de sauver les apparences, le pseudo-chercheur empruntait de l'argent à ses proches en leur promettant des placements mirobolants. Cette source de revenus assurée, il errait du matin jusqu'au soir sur les aires d'autoroutes à lire des revues scientifiques ou arpentait les chemins boisés de sa région.
Devant entretenir une maîtresse, les dépenses du faux docteur devinrent de plus en plus élevées jusqu'à le mettre dans une situation très embarrassante. Les proches commencèrent à poser des questions sur leurs placements auxquels ils ne semblaient plus avoir accès. Rattrapé par cet engrenage diabolique, l'homme a ainsi supprimé ceux qu'il aimait le plus au monde pour leur épargner la terrible désillusion de vingt années inventées...
Comment ne pas être bouleversé, intrigué, interloqué par ce drame atroce et la solitude de l'individu face à son secret ?
Emmanuel Carrère a hésité avant de se lancer dans ce récit et a commencé par entreprendre une correspondance avec Romand afin de lui proposer son projet d'écriture. Au final, le texte est fluide et équilibré entre l'art du roman et la minutie de l'enquête. L'auteur se veut le plus fidèle au déroulement des faits mais est également bien obligé d'extrapoler parfois en se mettant à la place du meurtrier.
Dans nos sociétés libérales, nous jouons tous plus ou moins la grande comédie : nous devons paraître heureux, épanouis au travail, posséder des biens matériels qui assoient notre niveau social, exister devant les autres, ... Jean-Claude Romand a joué cette farce jusqu'à son paroxysme, jusqu'au point de non-retour. Il a été jugé et il est hors de question de remettre en cause sa peine ici. Mais force est de constater que la lecture du récit nous laisse un sentiment de pitié à l'égard de cet homme perdu face à ses démons. N'y a-t-il pas là aussi le signe d'une société complètement folle où l'individu n'existe plus qu'à travers ses performances financières, sa réussite sociale ? A titre d'exemple, le climat malsain visant à fustiger les chômeurs durant la campagne présidentielle de 2012 témoigne une fois de plus des limites humaines atteintes par le capitalisme triomphant.
[Critique publiée le 12/02/12]

L E M A Î T R E D E S I L L U S I O N S
Donna Tartt - 1992
Plon - 706 pages
19/20
Le destin terrifiant d'un groupe d'étudiants
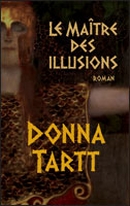 Ce pavé nous plonge dans l'univers troublant d'un campus universitaire américain.
Ce pavé nous plonge dans l'univers troublant d'un campus universitaire américain.
Le narrateur, Richard, vingt-huit ans et originaire de Californie, nous raconte son arrivée dans la petite ville de Hampden en Nouvelle-Angleterre. Cette région du Vermont abrite une université fondée en 1895.
C'est pour y suivre des études littéraires que le jeune homme décide de s'y inscrire ; et plus précisément de grec ancien.
Curieusement, le professeur qui enseigne cette discipline, Julian Morrow, n'accepte qu'un nombre très limité d'étudiants. Ses méthodes sont d'ailleurs remises en cause par bon nombre de ses collègues de l'établissement.
Richard persiste et devient le sixième élément de cette classe très spéciale. Le contenu des premiers cours le fascine : « C'était un causeur merveilleux, magique, et j'aimerais pouvoir mieux rendre compte de ce qu'il disait, mais un intellect médiocre est incapable de restituer le discours d'un intellect supérieur - surtout après tant d'années - sans l'appauvrir considérablement. La discussion ce jour là traita de la perte de soi, des quatre démences divines de Platon, des folies de toutes sortes ; il a commencé à parler de ce qu'il appelait le fardeau du soi, et avant tout de pourquoi les gens veulent d'abord échapper au soi. »
Le narrateur rentre alors dans un club très fermé auprès de ses nouveaux amis : Francis, un homosexuel issu d'une très riche famille de Boston ; Henry, un génie linguistique plongé en permanence dans ses ouvrages de langues anciennes ; Charles et Camilla, des jumeaux aux mœurs amoureuses très complexes ; et enfin Bunny, un jeune homme excentrique et riche qui n'est en cours que pour faire de la figuration...
Ce petit groupe d'étudiants vit replié sur lui-même et n'a quasiment aucun contact avec les autres élèves du campus. Richard se retrouve donc dans un nouvel univers, une nouvelle famille qu'il devra appréhender : « J'étais étonné de la facilité avec laquelle ils m'incorporaient à leur mode de vie cyclique, byzantin. Ils étaient tous tellement habitués l'un à l'autre que je crois qu'ils me trouvaient rafraîchissant, et ils étaient intrigués par mes habitudes les plus banales, comme d'employer des rasoirs jetables du supermarché et de me couper les cheveux moi-même au lieu d'aller chez le coiffeur ; même par le fait que je lisais les journaux et que je regardais les informations à la télévision de temps en temps (ce qui leur paraissait une scandaleuse excentricité, à mon seul usage ; aucun d'eux ne s'intéressait en rien à ce qui se passait dans le reste du monde, et leur ignorance des événements actuels et même de l'histoire récente était plutôt ahurissante. Une fois, à dîner, Henry a été surpris d'apprendre de moi que des hommes avaient marché sur la lune. »
Cette caste d'étudiants prendra ses quartiers tous les week-ends dans la maison de famille de Francis. Située à une heure de route de l'université, la grande maison bourgeoise aux allures victoriennes deviendra leur repaire. Entre consommation excessive d'alcool, travaux littéraires et longues promenades bucoliques dans la campagne alentour, Richard et sa bande prendront ainsi du bon temps à l'abri de tout souci.
Mais cela est sans compter la volonté de Henry de mettre en pratique les concepts étudiés dans les livres sur la « folie dionysiaque ». Voulant faire revivre les bacchanales, ces fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité en l'honneur de Dionysos, il va commettre l'irréparable en tuant par accident un fermier du coin. Dès lors, c'est la plongée dans un affreux cauchemar duquel personne ne ressortira indemne.
L'essentiel du récit va ainsi concerner la gestion psychologique de cette irrémédiable erreur par les différents protagonistes. Les conséquences et dommages collatéraux seront tragiques et mèneront certains en enfer...
Donna Tartt a mis huit ans à écrire ce premier roman qui a été traduit dans vingt-quatre langues.
Le lecteur avide d'actions en trouvera peu. Ici, on est avant tout dans la transcription littéraire d'un climat psychologique. L'auteur explore les tréfonds de l'âme humaine et tente de décrypter le complexe cheminement de l'esprit lorsque celui-ci bascule du côté obscur. La tension est palpable jusqu'à la fin.
L'écriture est très soignée et témoigne d'un travail méticuleux, de très haute facture. Le contexte universitaire dans lequel se situe l'action contribue fortement à cette qualité. Les langues anciennes, les références à Platon et les quelques digressions philosophiques rehaussent l'œuvre. Une attention particulière est également apportée à la description de la nature du Vermont : le climat dur en hiver, l'isolement de la région, les montagnes et rivières qui offrent leur magnifique écrin au récit.
Le seul bémol, à mes yeux, concerne le rôle trop effacé du professeur Morrow. Dès le début du récit, on imagine son influence très forte et bien que cela soit sans doute avéré, son personnage reste trop en retrait dans le déroulement des événements. Sa psychologie complexe avait tout à gagner à être davantage étoffée...
Malgré cela, l'ensemble reste un très beau roman comme on n'en lit que trop peu.
[Critique publiée le 26/10/11]

J O U R S D E T R E M B L E M E N T
François Emmanuel - 2010
Seuil - 176 pages
15/20
Immersion en Afrique
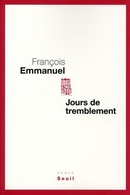 Ce court roman relate les huit jours d'une croisière pour touristes à bord d'un paquebot de luxe : le Katarina.
Ce court roman relate les huit jours d'une croisière pour touristes à bord d'un paquebot de luxe : le Katarina.
Le voyage au sein « d'un décor splendide de terre et d'eau » se situe dans un pays d'Afrique et a pour objectif de remonter un fleuve, jadis lieu mythique de la Route des Comptoirs.
L'auteur a volontairement choisi de ne pas situer de façon explicite l'action et a donc créé de toute pièce les noms aux consonances africaines des ports jalonnant le trajet des bateaux de commerce.
Le lecteur embarquera ainsi dans la baie de Mattopara pour joindre en ultime étape Sassié après avoir visité Batongo, Diaguilé et Oumsara.
Seulement, dans cette ancienne colonie française, la situation politique est très instable après des élections douteuses et une corruption omniprésente chez les dirigeants. L'ambiance sur le Katarina est lourde et des signes semblent annoncer des changements importants.
Une guérilla s'engage entre rebelles et armée gouvernementale. Elimane Ba, sorte de prophète illuminé, est le symbole de cette révolte qui gronde aux portes du fleuve.
L'impact destructeur de la colonisation est bien sûr visé car comme le prêchent les paroles du prédicateur : « un jour l'homme blanc est arrivé sur un bateau à aube avec une main qui tient l'arme et une autre le cadeau, il a planté l'esprit blanc dans la pensée des hommes du fleuve, et quelque chose s'est mis à changer. »
Le narrateur, François, venu filmer les berges riches en oiseaux migrateurs est le témoin privilégié du putsch.
Son statut de journaliste lui offre la possibilité de s'approcher au plus près du chef rebelle local, près du barrage de Batongo. Enregistrer la bonne parole, faire de la propagande, sont en effet des armes efficaces dans un pays en proie à la désorganisation des moyens de communication la plus totale.
François observe également les rapports humains à bord du bateau. Naginpaul, écrivain alcoolique, Marie et son vieillard aristocratique, Livia la troublante italienne ou Dasqueneuil le vacancier impatient et colérique vont devenir avec les autres passagers une monnaie d'échange pour négocier avec le parti au pouvoir.
Jours de tremblement traite plusieurs problématiques.
Le relatif anonymat géographique du lieu où navigue le Katarina permet de transposer facilement la situation politique de ce pays à de nombreuses contrées africaines. L'actualité le démontre chaque année avec des scénarios qui se ressemblent malheureusement très souvent. De Madagascar au Gabon en passant par la Côte d'Ivoire, les élections débouchent généralement sur des conflits d'intérêt autour du rôle de président détenu par des dictateurs de père en fils et soutenu financièrement par un système véreux, héritage de la Françafrique... Le peuple est la première victime de ces événements qui conduisent aux émeutes presque toujours.
Le roman aborde également les rapports entre le touriste occidental et l'ancienne colonie. Le voyageur se positionne bien trop souvent comme un simple « consommateur » d'un exotisme acheté dans un catalogue de papier glacé. Fuyant l'immersion, il a peur d'être confronté à la dure réalité. L'instabilité politique en est une et la beauté des rivages d'un fleuve ne résume pas à elle seule l'essence d'un pays.
L'auteur résume ainsi parfaitement cette idée : « lieu mythique de la destination du voyage du jour sept du programme, avec son Hostellerie maure, ses comptoirs restaurés, ses quatre minarets, son fort légendaire, son monument aux esclaves, Sassié qu'ils nommaient aussi ville blanche, dont les murs étaient régulièrement repeints par les services de la ville afin qu'elle fasse oublier l'Afrique et ressemble aux villages blancs des îles grecques ou des Alpujarras, comme les touristes du Nord les aiment, inoubliables et purs, avec leurs rues étroites chamarrées, leurs souks, leurs commerces, leur petit port pittoresque. »
Enfin, j'ai noté la référence au thème de l'enfant soldat : « ces tirailleurs de quinze ans, sans-grades dépenaillés, épuisés par cinq jours sans sommeil, factionnaires hagards des forêts de Fasha Fasha. »
Cette visite de l'Afrique dans un climat tendu est un joli clin d'œil à l'œuvre de William Conrad : Au cœur des ténèbres. Elle résume avec précision la géopolitique complexe des terres africaines si riches et si fragiles.
Seul bémol peut-être, un style littéraire un peu froid et distant avec le lecteur, accentué sans doute par l'érudition apparente de l'auteur...
[Critique publiée le 16/12/10]

P L A T E F O R M E
Michel Houellebecq - 2001
Flammarion - 370 pages
15/20
Luxure et dérive des religions
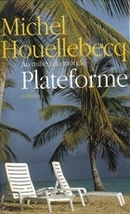 Michel, un fonctionnaire quadragénaire, mène une vie de célibataire à Paris. Pas de passion particulière, pas d'imprévu, bref un quotidien routinier qui tend vers l'ennui. La mort de son père, qui le touche à peine, est l'événement qui le pousse à prendre des vacances. Il part ainsi avec le voyagiste Nouvelles Frontières en Thaïlande pour un séjour clé en main au sein d'un groupe de touristes français.
Michel, un fonctionnaire quadragénaire, mène une vie de célibataire à Paris. Pas de passion particulière, pas d'imprévu, bref un quotidien routinier qui tend vers l'ennui. La mort de son père, qui le touche à peine, est l'événement qui le pousse à prendre des vacances. Il part ainsi avec le voyagiste Nouvelles Frontières en Thaïlande pour un séjour clé en main au sein d'un groupe de touristes français.
La première partie du livre nous décrit tout ce petit microcosme et son comportement en immersion dans un pays lointain. Michel partage ainsi les charmes de l'Asie avec douze personnes dont Lionel, un étudiant, Josette et René, un couple de retraités ou encore Robert, un beauf d'une cinquantaine d'années.
Des affinités se créent rapidement et comme dans tout groupe, des sous-groupes apparaissent. Michel, pour sa part, n'a aucun état d'âme à profiter des mains expertes des masseuses thaïes dans les salons de body massage. Et c'est notamment sur ce sujet que certaines dissensions naissent entre les touristes français.
Durant le séjour, une jeune femme de vingt-huit ans se lie d'amitié avec le narrateur. Originaire de la campagne guingampaise, Valérie est elle aussi à la recherche d'une identité affective et c'est tout naturellement le jour du retour que les deux nouveaux amants vont échanger leurs coordonnées.
Le deuxième chapitre présente Michel tel un homme transformé par cette rencontre, cette « deuxième chance » dans une vie déjà bien entamée comme il le qualifiera lui-même. Avec Valérie, c'est l'union parfaite. Celle-ci occupe par ailleurs un poste de haute responsabilité dans le domaine du tourisme et se voit confier avec son chef la reprise de la chaîne Eldorador (une dizaine d'hôtels-clubs) devenue filiale du groupe mondial Aurore.
Étude de marché, analyse sociologique des comportements en vacances, recherche de partenaires commerciaux, choix d'un slogan pertinent vont devenir les enjeux professionnels dans la vie commune du couple installé à Paris.
Pour Michel, mis à contribution indirectement, l'occidental veut jouir des plaisirs sexuels lorsqu'il voyage dans les pays pauvres. Selon lui, il y a la demande et l'offre qui va avec, l'avenir du groupe d'hôtels est donc tout trouvé.
Mais ces succès sentimentaux et professionnels vont brutalement prendre du plomb dans l'aile en l'espace de quelques lignes ; quelques secondes pour que tout bascule du très mauvais côté. À l'intensité du sexe va répondre celle de la mort.
Houellebecq est un écrivain controversé et ce roman a d'ailleurs fait naître une polémique concernant ses propos sur l'Islam et sur le tourisme sexuel qui est ici l'axe principal du récit. Il traîne ainsi une image d'artiste névrosé pour certains. Le lire est le seul moyen de se faire sa propre opinion et ma démarche m'a permis de découvrir une histoire bien écrite et très instructive. Malgré une seconde partie un petit peu disproportionnée par rapport aux deux autres au niveau de la longueur, le lecteur acquiert des connaissances sur l'anthropologie du touriste occidental.
Ici, la vie de Michel n'est qu'un prétexte pour dénoncer et déplorer notre société ultra-libérale qui, malgré les richesses matérielles qu'elle fournit, ne fabrique que des individus dénués de l'essentiel, des êtres lobotomisés par la course à la consommation qui ont oublié la réelle signification du mot « bonheur ». L'auteur de La possibilité d'une île dresse un portrait des pays riches qui est loin d'être flatteur tant les besoins en futilités y sont immenses. Michel, par son ennui et sa vie pathétique en début de roman, symbolise tout l'échec d'un monde dit civilisé.
La religion et le terrorisme qui en découle dans les cas les plus extrêmes sont aussi abordés et donnent une dimension dramatique et percutante à la trame du roman.
Sur le plan littéraire, le style est fluide et le rythme prenant. Quelques rappels historiques sur la Birmanie ou Cuba viennent émailler les propos sociologiques ou économiques sur l'histoire du tourisme européen. Les scènes érotiques sont évidemment très présentes à travers les relations charnelles entre Michel et Valérie ainsi que d'autres partenaires libertins occasionnels.
On aime ou on n'aime pas, mais Houellebecq ne laisse pas indifférent et cela est déjà un succès. Attention tout de même, ce livre n'est pas gai et risque de vous plomber le moral après sa lecture...
Extrait : « Moi-même, j'étais absolument incompétent dans le domaine de la production industrielle. J'étais parfaitement adapté à l'âge de l'information, c'est-à-dire à rien. Valérie et Jean-Yves, comme moi, ne savaient utiliser que de l'information et des capitaux. [...] Mais aucun de nous trois, ni aucune personne que je connaisse, n'aurait été capable, en cas par exemple de blocus par une puissance étrangère, d'assurer un redémarrage de la production industrielle. Nous n'avions aucune notion sur la fonderie des métaux, l'usinage des pièces, le thermoformage des matières plastiques. Sans même parler d'objets plus récents, comme les fibres optiques ou les microprocesseurs. Nous vivions dans un monde composé d'objets dont la fabrication, les conditions de possibilité, le mode d'être nous étaient absolument étrangers. Je jetai un regard autour de moi, affolé par cette prise de conscience : il y avait là une serviette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, un livre de poche de Milan Kundera. »
[Critique publiée le 18/06/09]

T A R E N D O L
René Barjavel - 1946
Gallimard - 583 pages
17/20
L'Amour par Barjavel
 Ce roman, paru dans les jeunes années de Barjavel, conte une histoire d'amour magnifique entre deux jeunes gens.
Ce roman, paru dans les jeunes années de Barjavel, conte une histoire d'amour magnifique entre deux jeunes gens.
Jean aime Marie. Marie aime Jean. Avec une simplicité d'écriture que beaucoup d'écrivains peuvent envier, avec ce style poétique inimitable, et avec cet humour souvent caustique envers le progrès et les hommes, l'auteur peint la rencontre de deux adolescents, l'amour fou qui va les unir, la guerre stupide qui va les séparer et le destin qui va les lier à tout jamais, là-bas dans la clairière où les fleurs sentent l'amour...
Une histoire qui se lit vite, qui serre le cœur, qui élève au plus haut rang des sentiments l'Amour absolu, celui avec un grand A. Une tragédie construite autour d'une galerie de personnages attachants et profondément humains. Très émouvant...

L E G A R D I E N D U F E U
Anatole Le Braz - 1900
Terre de brume - 184 pages
19/20
Une écriture somptueuse
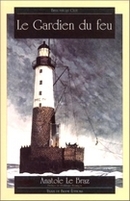 Ce livre est une invitation à la découverte de la vie des gardiens de phare au début du XXe siècle. Là-bas, dans la dangereuse mer d'Iroise, au large de la pointe du Raz se dresse un phare de pierre : le phare de Gorlébella (« la roche la plus éloignée ») plus connu sous le nom de phare de la Vieille. Une équipe de trois gardiens assurent à tour de rôle le bon fonctionnement du phare et protègent donc ainsi les équipages qui croisent au large d'un naufrage éventuel.
Ce livre est une invitation à la découverte de la vie des gardiens de phare au début du XXe siècle. Là-bas, dans la dangereuse mer d'Iroise, au large de la pointe du Raz se dresse un phare de pierre : le phare de Gorlébella (« la roche la plus éloignée ») plus connu sous le nom de phare de la Vieille. Une équipe de trois gardiens assurent à tour de rôle le bon fonctionnement du phare et protègent donc ainsi les équipages qui croisent au large d'un naufrage éventuel.
Le gardien-chef, Goulven Denès, est originaire du Léon (nord Finistère) et a fait connaissance lors d'une escale antérieure d'une jeune fille de Tréguier prénommée Adèle... Les deux jeunes gens vont s'aimer et partir s'installer sur la pointe du Raz car Goulven doit assurer périodiquement la relève à Gorlébella.
Tout se passe pour le mieux même si la rudesse des paysages rend nostalgique Adèle qui songe tristement à son Trégor natal...
Un poste vacant au phare et c'est un autre trégorrois (Louarn), cousin éloigné de l'épouse du gardien, qui vient s'installer dans le coin. Cette tierce personne va tragiquement faire basculer Goulven dans la folie.
Alertée par l'îlienne, cette femme sombre et mystérieuse, le narrateur va comprendre la tromperie. Mariée à lui devant Dieu, la belle Adèle en aime un autre devant le diable. Laissant les deux amants dans l'ignorance de son dégoût, Goulven va méthodiquement tisser un piège diabolique afin de se venger efficacement du tandem maudit...
Ce roman est sombre tant dans l'histoire elle-même de cette vengeance préméditée que dans le contexte où elle se déroule. Le paysage dur et semi-désertique du Raz de Sein vient ajouter une dimension mélancolique et tragique au désespoir du mari trompé. Une sorte de fatalité est inscrite dans le décor ainsi que le sent le couple lorsqu'il arrive dans ce pays (on retrouve ici un pessimisme identique à celui développé dans les œuvres de l'anglais Thomas Hardy à la même époque). Tout au long de l'intrigue, la noirceur de Goulven ne fera qu'augmenter.
Une histoire terrible où les moments de félicité sont plus que rares, mais une histoire ô combien magistralement écrite d'une main de maître par le costarmoricain Anatole Le Braz.
On devine aisément à travers son texte qu'il est aussi poète car force est de constater que c'est superbement bien écrit. Le livre est une peinture où la gravité des caractères et des paysages sont autant de coups de pinceaux tempétueux sur une toile gigantesque qui représenterait un couple déchu sur les landes bretonnes déchirées par le fracas des vagues.
Il est intéressant de re-situer l'œuvre dans son contexte de fin du XIXe siècle : les rapports géographiques et par conséquent socio-culturels n'ont pas grand-chose à voir avec la situation présente. Ainsi, Léon et Trégor sont presque deux pays différents et le mariage entre Goulven et Adèle est déjà pour certains un mauvais signe. L'auteur décrit à merveille la Bretagne d'antan et définit avec précision les différences dans les traits de caractère entre habitants du nord et habitants de l'ouest.
À noter qu'Anatole Le Braz s'est inspiré d'un fait divers.
Le film de Philippe Lioret, L'équipier sorti en 2004, ressemble étrangement au livre Le gardien du feu et même si la folie destructrice de la fin n'a pas lieu, on retrouve la même intrigue en triangle entre un gardien, sa femme et la relève...

Dernière mise à jour :
[ - Site internet personnel de chroniques littéraires. Mise à jour régulière au gré des nouvelles lectures ]

Copyright MAKIBOOK - Toute reproduction interdite
contact [at] makibook.fr


