 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire
 Makibook
Makibook
Chroniques d'une évasion littéraire

Romans > Science-fiction
A U R O R A
Kim Stanley Robinson - 2015
(traduit de l'anglais US par Florence Dolisi)
Bragelonne - 596 pages
20/20
Un voyage totalement grandiose !
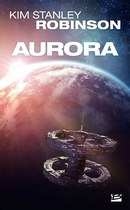 En 2545, un immense vaisseau a quitté la Terre à destination du système Tau Ceti situé à 11,9 années-lumière du Soleil. Voilà maintenant cent cinquante-neuf ans qu'il est parti ; désormais, il est entré dans une phase de décélération de plusieurs années nécessaire à cause de sa vitesse extrêmement élevée équivalente à un dixième de celle de la lumière.
En 2545, un immense vaisseau a quitté la Terre à destination du système Tau Ceti situé à 11,9 années-lumière du Soleil. Voilà maintenant cent cinquante-neuf ans qu'il est parti ; désormais, il est entré dans une phase de décélération de plusieurs années nécessaire à cause de sa vitesse extrêmement élevée équivalente à un dixième de celle de la lumière.
À son bord, les générations se sont succédé et les pionniers qui ont quitté la Terre ont laissé la place à leurs descendants. Deux mille cent vingt-deux personnes vivent maintenant dans la navette interstellaire constituée d'un axe central mesurant dix kilomètres et de deux anneaux ayant chacun une circonférence de cinquante-quatre kilomètres. Ces anneaux renferment un total de vingt-quatre biomes séparés par des sas et reproduisant les différents écosystèmes de la Terre avec la faune et la flore correspondants.
Au sein du biome de la Nouvelle-Écosse vit Freya, une adolescente de quatorze ans, et ses parents Badim et Devi. Le premier chapitre s'ouvre d'ailleurs sur une sortie en voilier, à bord du vaisseau, pour Freya et son père. Devi, quant à elle, est une ingénieure extrêmement impliquée dans le bon fonctionnement de la mission. Elle observe en permanence les différents paramètres et est reconnue pour son expertise dans la résolution de nombreux problèmes. Le navire interstellaire est en effet à l'image d'un être vivant : sa complexité gigantesque demande une veille constante que les humains, accompagnés par une Intelligence Artificielle s'appuyant sur un ordinateur quantique, assurent du mieux qu'ils le peuvent.
Devi est inquiète au sujet de sa fille, Freya, qui est très lente dans ses apprentissages. Ses observations la font naturellement s'interroger sur le potentiel effet d'un voyage aussi long quant au développement cognitif des êtres humains au fil des générations. Une régression est-elle possible dans ce milieu clos ? Son mari Badim se veut rassurant et philosophe : « Être lent, ça ne veut pas dire qu'on est déficient. On comprend moins vite, c'est tout. Les glaciers sont lents, mais ils avancent, et rien ne les arrête. »
Devi doit cependant se consacrer à la tâche principale qui l'attend auprès de ses concitoyens : l'arrivée dans le système de l'étoile Tau Ceti. Des sondes déjà envoyées en 2476 avaient préalablement permis de vérifier les potentielles conditions d'habitabilité de la planète E, que les colons vont nommer "Aurora", à travers l'analyse des gaz présents.
Freya fait désormais partie de la dernière génération des colons en transit et va devenir une adulte dans ce nouveau monde. Excitante et terriblement dangereuse à la fois, la mission lancée par les terriens cent soixante-dix ans auparavant est sur le point de révéler son potentiel, de s'avérer être un succès et de permettre une avancée prodigieuse de l'humanité ou bien alors de sombrer dans l'enfer d'un monde cauchemardesque loin du berceau des humains...
Il est impossible d'en dire davantage sans risquer de divulgâcher la trame du récit car celui-ci est d'une grande richesse et révèle bien des surprises. Disons-le tout de suite : Aurora est un chef d'œuvre de la science-fiction. L'histoire est prenante, admirablement narrée et ouvre des horizons vertigineux.
Kim Stanley Robinson, né en 1952, n'en est pas à son coup d'essai évidemment et s'est depuis longtemps révélé comme étant un écrivain majeur de la science-fiction américaine.
La trilogie martienne, à laquelle il fait d'ailleurs allusion ici, l'a révélé dans les années 90. D'autres titres, plus ou moins réussis selon les avis, ont suivi. Aurora est un grand cru dans sa longue bibliographie et je ne peux que paraphraser l'avis enthousiaste de l'acteur Tom Hanks : « Quelle saga ! De la science-fiction mêlant physique, biologie, sociologie, ainsi qu'un portrait réaliste et complexe de l'humanité. »
Car KSR fait preuve d'une grande crédibilité scientifique dans le genre qu'il affectionne plus que tout : la hard S-F. Il offre un panorama exhaustif d'une telle mission sans jamais être ennuyant en décrivant le mode de propulsion nucléaire de son vaisseau, ses écosystèmes, les constantes physiques et biochimiques qu'il faut veiller sans cesse, le système de Tau Ceti, les tensions politiques au sein d'un microcosme humain. Et tout cela au sein d'une importante réflexion sur la nature du langage humain, sur l'art de la narration, sur la question de la conscience pour une Intelligence Artificielle. Car l'IA est également au cœur du roman et se révèle même être un personnage très actif et très attachant.
Je n'oublie pas non plus cette incroyable visite de notre système solaire, planète par planète, jamais rébarbative et encore plus évocatrice qu'une véritable séance dans un planétarium !
Bref, voilà un roman décoiffant, totalement captivant, avec des personnages attachants, une solide culture scientifique, faisant réellement s'évader comme seule la littérature sait le faire et distillant un beau message écologique sur la protection de notre planète car Kim Stanley Robinson est aussi un écrivain qui construit son œuvre avec en ligne de mire l'urgence climatique que nous vivons.
[Critique publiée le 29/06/24]

2 2 / 1 1 / 6 3
Stephen King - 2011
Albin Michel - 937 pages
19/20
La "résistance" du passé selon King
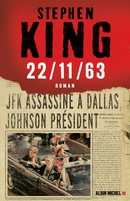 Jake Epping, professeur au lycée de Lisbon Falls dans le Maine, se lie d'amitié pour l'un de ses élèves qui est concierge dans l'établissement. Ce dernier, prénommé Harry Dunning, persiste à s'instruire pour combler les lacunes conséquentes à son passé difficile : sa mère et ses sœurs ont en effet été assassinées par son père le soir de la fête d'Halloween en 1958.
Jake Epping, professeur au lycée de Lisbon Falls dans le Maine, se lie d'amitié pour l'un de ses élèves qui est concierge dans l'établissement. Ce dernier, prénommé Harry Dunning, persiste à s'instruire pour combler les lacunes conséquentes à son passé difficile : sa mère et ses sœurs ont en effet été assassinées par son père le soir de la fête d'Halloween en 1958.
Pour fêter l'obtention du diplôme de Harry, Jake l'invite à manger un burger dans le petit snack dont il est client. Al Templeton, son tenancier, vend des repas à des prix défiant toute concurrence. Son état se dégrade cependant subitement lui faisant avouer à Jake qu'il souffre d'un cancer du poumon.
Plus tard, il demande également à le voir urgemment pour lui faire découvrir son secret : dans la remise de son établissement réside une porte temporelle permettant de voyager dans le passé. Réticent au début, Jake franchit en quelques pas les décennies passées et se retrouve plongé au même endroit le 9 septembre 1958 à 11h58 précises ! Revenu en 2011 par le même chemin et tentant d'encaisser le choc subi, il découvre que son ami Al va quotidiennement acheter sa viande au tarif des années 50 pour en garnir ses burgers et les vendre à un prix modique...
Plus sérieusement, il apprend que ce saut dans le temps peut se faire à tout moment, que la seule date d'arrivée possible est celle du 9 septembre 1958 et qu'enfin, quel que soit le temps passé à cette époque, seules deux minutes s'écoulent dans le présent de 2011.
Al Templeton a déjà réfléchi depuis longtemps aux conséquences vertigineuses que cette extraordinaire trouvaille peut engendrer. La question de changer le passé pour améliorer le présent est bien évidemment au cœur de ses pensées et déjà il précise à Jake : « Pour l'archiduc, ou Adolf Hitler, nous ne pouvons rien faire. Ils sont hors de notre portée. » En revanche, Al demande à Jake qui est plus jeune et vaillant que lui de plonger en 1958 afin d'empêcher le meurtre de John F. Kennedy prévu le 22 novembre 1963 ! Il est convaincu qu'empêcher la survenue de cet événement tragique pour les États-Unis rendra le monde meilleur en commençant par l'absence de la guerre au Vietnam.
Jake, malgré ses fortes réticences et inquiétudes liées au phénomène de l'effet papillon, finit par accepter l'incroyable challenge.
Il commence tout d'abord par s'intéresser à la famille de son élève Harry Dunning, un petit garçon à cette époque, sur lequel le sort doit d'acharner le soir d'Halloween. Empêcher le carnage, voir quelles seront les conséquences en 2011... Tant d'expériences sont possibles, tant de destinées sont modifiables pour le meilleur ou le pire. Le passé n'est-il pas placé dans un équilibre si fragile que le moindre mouvement d'air peut le faire violemment chavirer ?
Puis, à partir des notes prises avec minutie par Al sur la vie du célèbre tueur Lee Harvey Oswald, Jake, sous le pseudonyme de George Amberson, se lance dans le défi le plus inimaginable durant les cinq années séparant 1958 de 1963.
Profitant des résultats sportifs connus d'avance, il s'enrichit rapidement en faisant des paris pour ne pas être dans le besoin et postule en tant que professeur dans le lycée de Jodie afin de se construire une existence normale. La petite bourgade choisie stratégiquement à côté de Dallas, lieu de l'assassinat du président américain en novembre 1963, se révèle être un lieu de vie très agréable dans lequel il fait la connaissance de la magnifique bibliothécaire Sadie Dunhill. Une histoire d'amour se noue rapidement entre ces deux personnes compliquant évidemment la mission initialement prévue par Jake...
Inutile de raconter davantage que cette introduction qui donne déjà le ton du roman.
Il s'agit ici d'une très belle histoire d'amour inscrite dans un voyage dans le temps situé au cœur d'un contexte historique très marqué. King traite avec méticulosité son sujet : il s'est énormément documenté afin de reconstituer minutieusement le parcours de Lee Harvey Oswald entre son retour sur le sol américain en 1962, après un long séjour en URSS, et la date fatidique de l'assassinat de Kennedy. Journée qui demeure un moment traumatique encore aujourd'hui pour les américains avec bien sûr celle du 11 septembre 2001 depuis.
L'écrivain du Maine dresse un tableau très vivant des quartiers pauvres de Fort Worth, là où vont résider Oswald et sa femme russe Marina. Il sait décrire la misère sociale en une ou deux pages de façon admirable et juste.
En plus d'une plongée captivante dans l'Amérique du début des années 60, différentes lectures de 22/11/63 sont possibles : certains y verront principalement la relation amoureuse de deux êtres séparés dans le temps, d'autres aimeront l'enquête policière et cette traque subtile menée par le héros, enfin il y a ceux qui seront fascinés par la dimension fantastique du voyage dans le temps et la façon dont Stephen King l'aborde. Évidemment, certains paradoxes restent insolubles comme dans tout récit traitant ce sujet...
La dimension sociale des écrits de King est donc à nouveau démontrée ici pour ceux qui en douteraient encore en le cataloguant systématiquement dans le genre littéraire de l'horreur.
À mes yeux, il est avant tout un écrivain décryptant la réalité de la société américaine dans son quotidien le plus simple. Ainsi, on retrouve des sujets qui le hantent depuis longtemps comme le rapport à l'alcool qui détruit tant de familles partout dans le monde : « La même exaspération que j'avais pu ressentir avec Christy quand je rentrais à la maison pour la trouver déjà bien imbibée et pas loin d'être à nouveau complètement schlass en dépit de toutes ses promesses de redresser le cap, de rester sobre, et de renoncer à l'alcool une bonne fois pour toutes. » Cette phrase résume de façon très juste beaucoup de souffrance et témoigne d'un vécu personnel.
Le voyage dans les années 50 et 60 est aussi une fenêtre idéale pour l'auteur sur des souvenirs de jeunesse agréables qu'il a certainement gardés en lui. Le jazz pour commencer, dont le célèbre morceau In the mood de Glenn Miller, constitue une véritable bande sonore durant l'histoire. La danse de cette époque, tellement enjouée, acrobatique et dynamique, est aussi restituée avec beaucoup de réalisme. Quant aux voitures, "les belles américaines", elles sont présentes tout au long du roman et offrent du plaisir à un Jake qui devient frustré lors de son retour en 2011 : « Arrivé à la maison, c'est le frein à main de la Sunliner que je me suis surpris à chercher. En coupant le moteur, j'ai mesuré à quel point ma Toyota n'était qu'un tas de plastique et de fibre de verre tout à fait hideux, exigu et bas de gamme, en bref minable comparée à la bagnole qui avait été la mienne à Derry. »
La narration est soignée et fluide comme dans Revival qui est à ce sujet un vrai modèle d'écriture. Différents rythmes s'enchaînent ; certains passages mettant en scène une forte violence sont tendus et nerveux, d'autres sont plus contemplatifs et permettent au lecteur de respirer comme celui évoquant ces cinq semaines de repos et d'attente dans la région des lacs à l'ouest du Maine : « Quand je ne lisais pas ou ne me baladais pas en canoë, j'allais marcher dans les bois. Ah, ces longs après-midi d'automne tièdes et brumeux. Ces rais de lumière dorée poussiéreuse projetés en oblique à travers les arbres. Et la nuit, un silence si vaste qu'il semblait presque se réverbérer. »
Et bien sûr, il y a la scène la plus attendue, celle qui se profile dès le début, celle vers quoi tout tend : en trente pages, Stephen King met en scène à travers une écriture très cinématographique un long travelling montrant la course effrénée de Jake vers son but ultime. Ce passage est haletant, brillant, visuel et intense !
Malgré une période rendue anxiogène par un contexte extrêmement tendu par la guerre froide et en particulier la crise des missiles de Cuba en 1962, au sujet de laquelle l'écrivain parvient me semble-t-il à vraiment nous faire palper l'effroi ressenti par certaines personnes, de nombreuses autres références nous font regretter cette époque pleine d'élégance. Par exemple les costumes soignés des hommes et les robes chics des femmes, les automobiles, les films avec le distingué James Stewart ou encore les mystérieux tableaux d'Edward Hopper.
Enfin, j'ai à nouveau noté plusieurs clins d'œil à l'un des auteurs classiques préférés de l'auteur américain : Thomas Hardy. Tess d'Urberville et Jude l'Obscur, deux romans qui sont des chefs-d'œuvre selon moi, figurent en bonne place entre les mains de Sadie lorsqu'elle fait la lecture à Jake : « Je connaissais ces histoires et c'était réconfortant de les réentendre. »
La mythologie kingienne est elle-même abordée avec la rencontre des deux adolescents Richie et Beverly dans la monstrueuse ville de Derry immortalisée dans le grandiose roman Ça.
Pour terminer, voici encore une réflexion de Jake Epping tout autant sans doute que de l'auteur qui mesure à quel point notre époque contemporaine nous a fait reculer sur certains points : « Après une période de sevrage informatique, j'avais pris suffisamment de recul pour mesurer à quel point j'étais devenu accro à ce foutu ordi, passant des heures à lire des pièces jointes stupides et à visiter des sites Internet pour la même raison qui pousse les alpinistes à vouloir escalader l'Everest : parce que c'est là ! »
Gageons que ma petite chronique apporte tout de même un peu de contenu sur Internet !
[Critique publiée le 01/01/24]

D I X L É G E N D E S D E S Â G E S S O M B R E S
Jean-Marc Ligny - 2022
L'Atalante - 232 pages
16/20
Quand la frontière entre science-fiction et réalité disparaît
 Des températures affolantes qui empêchent l'homme de sortir durant la journée, des tempêtes extrêmement violentes qui donnent au ciel un aspect apocalyptique, des migrants qui tentent de fuir l'enfer pour rejoindre des zones préservées et réservées aux plus riches, des messies convaincus que seule la rédemption permettra d'éviter la catastrophe climatique, des ingénieurs qui se cassent la tête pour diminuer la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ... Voilà les thèmes qui sont abordés par l'auteur de science-fiction Jean-Marc Ligny qui indique en préambule que ces dix nouvelles « ont été écrites au fil de vingt années de réflexion sur le changement climatique en cours et l'avenir qu'il nous réserve ».
Des températures affolantes qui empêchent l'homme de sortir durant la journée, des tempêtes extrêmement violentes qui donnent au ciel un aspect apocalyptique, des migrants qui tentent de fuir l'enfer pour rejoindre des zones préservées et réservées aux plus riches, des messies convaincus que seule la rédemption permettra d'éviter la catastrophe climatique, des ingénieurs qui se cassent la tête pour diminuer la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ... Voilà les thèmes qui sont abordés par l'auteur de science-fiction Jean-Marc Ligny qui indique en préambule que ces dix nouvelles « ont été écrites au fil de vingt années de réflexion sur le changement climatique en cours et l'avenir qu'il nous réserve ».
Depuis les années 70, en France et ailleurs, des personnalités comme René Dumont tentent d'alerter l'opinion publique sur la nécessité de préserver notre planète sous peine de modifier son équilibre et d'en subir les fortes conséquences. Des philosophes, des écrivains, des dessinateurs et bien d'autres personnes l'ont rejoint et ont mis en lumière les risques encourus par les humains.
Jean-Marc Ligny a commencé à mettre sa plume au service de ce sujet au tournant du siècle. Les artistes, malheureusement peu écoutés, ont bien souvent une longueur d'avance et proposent des pistes de réflexion extrêmement utiles et intéressantes. Pris pour des hurluberlus bien souvent, ces agitateurs de conscience n'ont plus à prouver aujourd'hui qu'ils avaient raison face au capitalisme surpuissant et au règne de la consommation.
J'ai lu ce recueil durant l'été 2022 et ses périodes de canicule qui se suivent à n'en plus finir. Le changement climatique ne touche plus des populations éloignées, le problème n'est plus « ailleurs ». La France connaît aussi maintenant des migrants climatiques qui quittent le sud pour remonter vers le nord et la Bretagne, l'eau devient un bien précieux dont l'utilisation est restreinte dans une grande partie du territoire.
Dix légendes des âges sombres parle exactement de tout cela en poussant le curseur à peine plus loin, quelques décennies tout au plus. On y voit évidemment les conséquences en chaîne du changement climatique : davantage de conflits, davantage de repli identitaire et de religion, davantage de souffrance.
Les nouvelles de ce recueil sont globalement pessimistes. Espérons, mais peut-on encore y croire, que l'anticipation décrite ici et qui fait froid dans le dos ne devienne pas notre quotidien d'ici 2050. Car 2050, c'est demain...
[Critique publiée le 10/03/23]

P I R A T E R I E
Tancrède Voituriez - 2020
Grasset - 294 pages
13/20
Le retour de la sonde Voyager
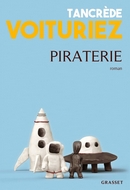 Grace a été sélectionnée par l'Agence Spatiale Européenne pour voler à bord de la Station spatiale internationale. Elle fait partie des six candidats durement choisis parmi un total de 8778 postulants. Autant dire qu'elle est brillante.
Grace a été sélectionnée par l'Agence Spatiale Européenne pour voler à bord de la Station spatiale internationale. Elle fait partie des six candidats durement choisis parmi un total de 8778 postulants. Autant dire qu'elle est brillante.
Camille est un informaticien surdoué travaillant sur l'intelligence artificielle et capable de pirater les données privées du monde virtuel. Il a ainsi travaillé de façon illicite dans de nombreux pays dérobant des fichiers pour satisfaire l'appétit de sombres commanditaires. Dans le jargon culturel, on dit de lui qu'il est un « nerd » : un être asocial, solitaire et obnubilé par des sujets intellectuels complexes et arides. Il est repéré par un homme d'affaires, Vincent Voragine, qui édite et publie les pensées de plusieurs de ses condisciples philantropes dont l'influence sur le monde économique est majeur.
Ces trois personnages vont être reliés par un événement totalement imprévu et inexplicable au sujet de la sonde Voyager 1.
L'auteur retrace ainsi avec pédagogie cette formidable aventure spatiale démarée en 1977. Cette année-là, deux sondes Voyager ont été lancées dans l'espace. À ce jour, elles sont parvenues dans le vide interstellaire après avoir traversé notre système solaire. Voyager 1 et 2 ont permis de mieux connaître les atmosphères des planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ainsi que d'y découvrir de nombreux satellites inconnus jusqu'ici. Leur vitesse de dix-sept kilomètres par seconde leur permettra d'atteindre l'étoile la plus proche de nous, située dans la constellation de la Girafe, dans quarante mille ans. Par ailleurs, elles possèdent chacune un disque de cuivre contenant des informations à destination d'hypothétiques êtres intelligents : un schéma localisant le Soleil et la Terre, les bases du système numérique, le mot « bonjour » traduit en cinquante-cinq langues, des chants de baleine et vingt-sept morceaux de musique choisis par le célèbre astrophysicien Carl Sagan.
Ici, l'auteur imagine qu'en 2006 la Terre a perdu le contact avec le signal de Voyager 1. Ce n'est qu'en 2015 qu'il est à nouveau entendu mais avec une anomalie majeure : la distance à laquelle se trouve la sonde, au lieu d'augmenter, diminue !
Camille, grâce à ses talents, intercepte l'information et la divulgue dans le milieu des hackers. Puis il se rend en compagnie de Voragine à un sommet international de l'ONU sur le développement durable à Rio de Janeiro ; c'est là qu'il voit pour la première fois la sensuelle Grace et qu'il ébruite l'information incroyable que le monde ne connaît pas encore mais que la NASA a volontairement caché durant plusieurs années.
Cette hypothèse renversante du retour de l'objet d'origine humaine le plus éloigné de la Terre est vertigineuse. Et malgré les nombreuses pistes d'explication rationnelle des scientifiques, l'idée d'une origine extraterrestre devient de plus en plus prégnante.
Pour étayer ses propos et asseoir son roman sur un socle scientifique solide, l'auteur évoque ainsi le paradoxe de Fermi ou encore la physique quantique et son fameux chat de Schrödinger. Il montre aussi comment une information peut être divulguée sous forme de rumeur et partage ses connaissances intéressantes sur l'économie, le capitalisme et l'altermondialisme ainsi que sur le monde du « darkweb ».
Grace s'envole pour la Station spatiale internationale lorsque la sonde se rapproche de la Terre. Je ne vais pas dévoiler davantage l'intrigue ni la découverte qui sera faite...
À l'image de L'anomalie, prix Goncourt 2020, Piraterie aborde de nombreux sujets et les relie au cœur d'une histoire de science-fiction. Malheureusement, la construction global du récit ne m'a pas convaincu. Malgré le sujet passionnant du retour de Voyager 1, je ne me suis pas attaché aux personnages principaux que sont Grace et Camille. Les relations humaines manquent de chaleur, le mélange entre le piratage informatique et le sommet sur le développement durable m'a un peu dérouté.
Bref, je suis ressorti de ma lecture en me demandant si j'avais raté quelquechose. Cela est vraiment dommage !
[Critique publiée le 10/03/23]

L ' A N O M A L I E
Hervé Le Tellier - 2020
Gallimard - 327 pages
14/20
Bug informatique ?
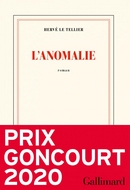 En juin 2021, un phénomène incompréhensible se produit : le vol Air France 006 en provenance de Paris et à destination de New York s'apprête à atterrir. Le problème est que ce même avion avec les mêmes deux cent quarante-trois passagers a déjà atterri trois mois plus tôt en mars.
En juin 2021, un phénomène incompréhensible se produit : le vol Air France 006 en provenance de Paris et à destination de New York s'apprête à atterrir. Le problème est que ce même avion avec les mêmes deux cent quarante-trois passagers a déjà atterri trois mois plus tôt en mars.
L'affaire, estampillée aussitôt « Classified Information » par les américains, est prise en charge par le département de la Défense et les meilleurs experts du FBI, de la CIA et de la NSA. Les passagers du vol ainsi que le personnel de bord sont immédiatement identifiés. Ceux ayant débarqué sur le sol américain en mars sont repérés et approchés par des agents du renseignement tandis que ceux arrivés fraîchement aux États-Unis sont invités à rester en quarantaine dans un immense hangar de la McGuire Air Force Base. Il est évidement question de doublons humains...
Pendant ce temps-là, le « nouveau » Bœing 787 est immobilisé et analysé dans les moindres détails.
Le récit est construit selon une symétrie autour du point de basculement constitué par cette tempête dantesque qui a modifié le destin d'un avion de ligne. Il oppose les vies d'une dizaine de personnages avant l'événement à celles dédoublées après l'anomalie.
Hervé Le Tellier ne revendique pas l'écriture d'un roman d'anticipation ou de science-fiction. Il parle d'une « expérience de pensée » en voulant amener le lecteur à réfléchir du point de vue philosophique sur le sens de la vie, les choix irréversibles qui peuvent être réalisés, les accidents qui surviennent, la réalité du monde, ...
Sur la forme, il joue avec les styles en décrivant différents destins dont celui d'un tueur professionnel ou ceux d'un couple que l'écart d'âge sépare peu à peu. Tous ces protagonistes, confrontés à l'invraisemblable, auront à faire des choix.
Évidemment, l'histoire convoque aussi bien les scientifiques que les militaires ou les religieux. L'image dépeinte de ces derniers n'est pas très avantageuse, leur consultation ne débouche que sur une cacophonie inaudible. La place de la religion est bien sûr à prendre en compte dans cette situation inédite mais comme il fallait s'y attendre des crispations naissent chez les fous de Dieu. L'auteur semble ici s'amuser et renvoyer dos à dos toutes les croyances face à un phénomène qui dépasse leurs textes sacrés.
Sur les plans scientifique et cartésien, j'ai particulièrement apprécié les personnages de Meredith et Adrian, deux mathématiciens de l'université de Princeton, et pris du plaisir à lire l'élaboration du fameux « protocole 42 ». Les hypothèses qu'ils formulent sont passionnantes et celle qui est retenue est totalement vertigineuse.
Le lecteur reconnaîtra aussi avec plaisir des personnages contemporains comme un président « présentant une forte ressemblance avec un gros mérou à perruque blonde » ou son homologue français Emmanuel Macron qui est lui cité nommément. Il y a aussi ce mathématicien célèbre portant accrochée au revers de sa veste « une araignée d'argent » ; il s'agit évidemment de Cédric Villani. Les références sont nombreuses au fil des pages de La Grande Librairie à Dune en passant par Interstellar, Star Trek, Romain Gary, Elton John ou encore Ryan Gosling !
Cependant, ne nous trompons pas encore une fois, le thème de la science-fiction n'est qu'un prétexte pour aborder des sujets très contemporains comme le libre arbitre ou les illusions que l'homme érige en vérité pour s'affranchir de la confrontation avec une réalité angoissante.
Là où Le Tellier m'a plu, c'est lorsqu'il fait référence aux catastrophes écologiques qui sont en marche et dont l'homme a la responsabilité. Ainsi, le philosophe Philomède annonce lors d'un échange télévisé : « Regardez le changement climatique. Nous n'écoutons jamais les scientifiques. Nous émettons sans frein du carbone virtuel à partir d'énergies fossiles, virtuelles ou non, nous réchauffons notre atmosphère, virtuelle ou non, et notre espèce, toujours virtuelle ou non, va s'éteindre. Rien ne bouge. Les riches comptent bien s'en sauver, seuls, en dépit du bon sens, et les autres en sont réduits à espérer. »
L'auteur, en plus des destins individuels qu'il interroge, joue avec la focale pour confronter l'humanité toute entière à un phénomène inattendu. Et la conclusion est sans appel : « Rien ne va changer. [...] Nous sommes aveugles à tout ce qui pourrait prouver que nous nous trompons. »
Il y a donc beaucoup de choses, moult idées, réflexions qui sont lancées sur des sujets qui touchent à la science, à la philosophie, à la religion, à l'amour, ... J'ai eu le sentiment que l'auteur aborde, avec finesse certainement, chacun de ces sujets mais sans prendre le temps de les déployer suffisamment.
L'anomalie aurait pu être l'occasion de construire un roman total. La tâche aurait certes été plus rude et le prix Goncourt se serait certainement éloigné.
J'attendais également une intrigue plus riche qui entremêle bien davantage les différents personnages entre eux ainsi qu'une chute plus audacieuse, comme un Ctrl-Z final par exemple (ceux qui auront lu comprendront)...
Force est donc de constater que le livre manque de puissance, de digressions, de profondeur à certains moments malgré ses promesses. Ken Grimwood a abordé des questions similaires sur le destin individuel dans l'excellent Replay. Et chez moi, l'exigence ne peut être que placée à un niveau élevé après avoir été émerveillé par des titres comme Les derniers jours du monde de Dominique Noguez ou Là où les tigres sont chez eux de Jean-Marie Blas de Roblès qui poussent bien plus loin les limites de l'exercice. Sans compter des livres de « vraie » science-fiction comme Spin de Robert Charles Wilson qui interroge véritablement sur la place de l'homme dans l'univers.
[Critique publiée le 20/06/21]

A R C A
Romain Benassaya - 2016
Critic - 434 pages
18/20
Un premier roman de science-fiction brillant
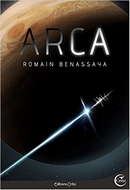 En 2157, un gigantesque vaisseau interstellaire quitte la Terre.
En 2157, un gigantesque vaisseau interstellaire quitte la Terre.
Arca, qui mesure cinquante kilomètres de long, est un immense tronc autour duquel gravite lentement vingt-huit cités reliées chacune par une branche métallique longue de trois kilomètres.
À la proue se situe le bureau du commandant Jonah Aquilio tandis qu'à l'autre extrémité se trouvent les propulseurs. Le reste du bâtiment central est occupé par des réservoirs d'eau, de nourriture, des serres géantes, des bureaux et laboratoires ainsi que des espaces publics.
Les vingt-huit cités sont quant à elle réservées aux trois mille six cents terriens embarqués dans l'aventure.
La destination est sans retour pour ces arconautes : la Griffe du Lion située à vingt-quatre années-lumière de notre planète. Il s'agit d'une exoplanète ressemblant à la Terre par la présence d'eau liquide et d'oxygène et tournant autour de l'étoile HD 4628.
Arca se rend dans un premier temps, durant un voyage de huit mois, aux abords de Jupiter. L'endroit est nommé « le Seuil » car c'est à partir de là que les propulseurs vont être véritablement mis en route afin d'atteindre une vitesse supraluminique permettant d'atteindre la Griffe du Lion en huit années seulement !
La matière à l'origine de la fabuleuse source d'énergie nécessaire à ce voyage a été découverte dix années plus tôt par Sorany Desvœux. En mission à cette époque auprès du professeur Henri Stern sur Encelade, l'un des satellites de Saturne, la jeune femme avait relevé une alerte dans les instruments de mesure qui lui avait permis de découvrir une nouvelle matière dans des tunnels de glace souterrains.
La fameuse substance, nommée « Artefact d'Encelade », a ensuite été exploitée par le groupe Horizon afin de mettre en place le projet Arca. Cependant, à l'heure du décollage, ses multiples propriétés demeurent toujours un grand mystère...
L'installation sur une exoplanète, telle la Griffe du Lion, est devenue l'unique et dernier espoir pour les habitants d'une Terre surpeuplée dont les ressources naturelles se sont considérablement raréfiées. Un groupe concurrent à celui qui a imaginé le projet Arca voit pourtant l'avenir de la race humaine sur la toute proche planète Mars. Et depuis plusieurs années, la planète rouge aux conditions naturelles inaptes à toute vie humaine est en voie de terraformation à travers le « service martien » qui oblige chacun et chacune à s'y rendre durant une année entière pour travailler durement dans des mines.
Frank Fervant, le héros du roman, a fait ses preuves sur Mars où il a passé cinq rudes années et réussi l'exploit de sauver d'une mort assurée des terriens abandonnés à leur sort après une rébellion des Loups de Mars, une faction radicalisée cherchant à faire basculer l'ordre établi. Recruté par le futur commandant de l'Arca à l'époque de cet acte héroïque, il l'accompagne désormais afin d'assurer le succès et la sécurité du voyage vers la lointaine étoile.
Il s'agit en effet d'ouvrir l'œil autour de la question religieuse au sein d'une communauté vivant désormais totalement en vase clos. L'église « enliléenne » est une mouvance sectaire née sur la Terre et faisant la synthèse des plus grandes religions. Son culte, bien qu'autorisé, semble créer des tensions et modifier certains comportements au sein du vaisseau. Les « irréguliers » comme ils ont été surnommés peuvent-ils représenter une menace pour le succès de la mission ? Sont-ils manipulés ? Quel est le lien qu'ils cherchent à établir avec Sorany, celle qui a découvert cette fameuse matière qui permet de dépasser la vitesse de la lumière, et qui fait aussi partie du voyage ?
Ce premier roman de Romain Benassaya, dont l'illustration de couverture est vraiment splendide, est une réussite. L'histoire est captivante et conserve un rythme prenant de la première à la dernière page. Même si la psychologie des personnages est très manichéenne, les scènes d'action, de dialogue, les flashbacks, les descriptions et les moments d'émotion sont parfaitement agencés. Le socle scientifique est solide et l'absence d'explications sur l'exploitation de la matière d'Encelade afin de propulser le vaisseau à une vitesse supérieure à celle de la lumière ne nuit en rien à la crédibilité du récit.
Les chapitres sont courts et se terminent généralement par une note de suspense incitant le lecteur à poursuivre le voyage.
Parcourir une œuvre de science-fiction bien écrite et soignée sur le plan de la narration et de la rédaction est aussi très agréable. Romain Benassaya, exerçant le métier de professeur de français à l'étranger, a une plume élégante et produit un écrit de qualité.
Lire Arca permet de s'évader totalement, de s'immerger dans un monde inconnu, de s'extraire de notre planète pour prendre du recul et réfléchir à l'infini de l'univers qui nous entoure. Cela laisse augurer d'excellents futurs romans pour ce nouvel écrivain de science-fiction français !
[Critique publiée le 10/03/23]

P Y R A M I D E S
Romain Benassaya - 2018
Critic - 553 pages
18/20
Un space opera vertigineux
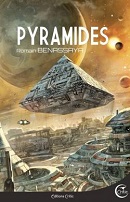 En 2182, un gigantesque vaisseau interplanétaire, le Stern III, quitte la Terre ravagée par la pollution et les guerres conséquentes à la raréfaction des ressources vitales. Transportant mille six cents personnes placées en sommeil prolongé, l'engin a pour destination la planète Sinisyys - mot finnois désignant un bleu particulier - afin d'y installer une colonie humaine.
En 2182, un gigantesque vaisseau interplanétaire, le Stern III, quitte la Terre ravagée par la pollution et les guerres conséquentes à la raréfaction des ressources vitales. Transportant mille six cents personnes placées en sommeil prolongé, l'engin a pour destination la planète Sinisyys - mot finnois désignant un bleu particulier - afin d'y installer une colonie humaine.
Le récit commence lors du réveil des colons. Le commandant ainsi que son second Éric sont les premiers à sortir de la longue phase de biostase. Rapidement, ils se rendent compte que le système informatique ne fonctionne plus et les empêche d'avoir accès aux données de navigation. Où et en quelle année sont-ils ?
Plus étrange encore : le Stern III est posé sur une surface dure et aucune étoile n'est visible sur la voûte céleste.
Pendant que l'ensemble de l'équipage sort doucement de sa longue torpeur, dont Johanna la compagne d'Éric, une première phase d'exploration est mise sur pied : un équipage descend au pied du Stern III et découvre une surface crayeuse et uniforme.
À bord d'un engin roulant, les sorties se succèdent et permettent de déterminer que le vaisseau humain est coincé à l'intérieur d'une structure en forme de tunnel.
Petit à petit, deux voies s'ouvrent aux terriens : renoncer à la quête de la planète Sinisyys et s'installer durablement dans l'artefact inconnu ou explorer davantage les lieux afin d'en trouver la sortie.
Le vaisseau humain, long de plusieurs kilomètres, est une véritable arche contenant entre autres une forêt en son sein. Celle-ci est entretenue par une variété d'insectes volants génétiquement modifiés et faisant preuve d'une capacité d'adaptation et d'apprentissage phénoménal.
Éric est partisan de l'exploration et rêve de rejoindre une planète viable. Johanna, quant à elle, ne voit la survie de la colonie que dans son déploiement sur leur site présent d'arrivée. Les ressources en alimentation et énergie ne manquent pas à bord du Stern III et de l'eau à l'état gelée est également découverte à quelques jours de route...
Dès les premières pages, le lecteur est plongé dans un space opera vertigineux. Les courts chapitres se succèdent sans temps mort tout au long de ce pavé. Voilà déjà une première réussite.
La seconde est bien entendu l'histoire elle-même qui est passionnante. Elle reprend une trame classique déjà souvent exploitée en littérature de science-fiction comme dans le désormais classique Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke.
Ici, le récit détaille le choix qui s'offre aux colons. Les chapitres alternent entre l'implantation humaine à l'extérieur du vaisseau par la création d'une cité appelée « Nouvelle Ramille » et la découverte du tunnel à bord d'un appareil, L'Ookpik, spécialement conçu pour en parcourir les dimensions gigantesques. Comme dans toute communauté humaine isolée, de vives dissensions voient le jour entre les explorateurs et les bâtisseurs.
Le roman aborde donc de nombreux sujets à travers les dimensions politique, sociale, scientifique et philosophique. L'auteur privilégie cependant l'action et le mouvement et s'affranchit de toute digression métaphysique ou de justification sur le contexte scientifique qui sert de base au récit. Pour autant, le socle est solide et cartésien, l'histoire est bien construite et argumentée, les rebondissements s'articulent parfaitement.
Le moteur de cette aventure réside dans ce mystère autour du tunnel. Cet artefact est-il artificiel ? Que contient-il ? Une sortie existe-t-elle ? Je ne vais évidemment pas livrer ici certains éléments de réponse.
Bref, voici un livre palpitant avec de l'exploration spatiale, du suspense, des guerres intestines, de l'émotion, des complots et des surprises ! Pyramides offre un beau voyage aux confins de l'espace-temps, il serait dommage de s'en priver !
L'auteur, Romain Benassaya, est né en 1984 et réside actuellement en Thaïlande où il enseigne le français. Pyramides est son second roman.
[Critique publiée le 10/05/20]

L E S N A U F R A G É S D E V E L L O A
Romain Benassaya - 2019
Critic - 440 pages
15/20
En quête d'une nouvelle planète
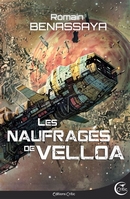 À la toute fin du XXIIIe siècle, la Terre est devenue exsangue à la suite des nombreux dérèglements générés par l'activité humaine. Les êtres humains sont dans l'obligation de la fuir. Les plus chanceux s'installent sur Mars et Vénus, deux planètes terraformées, tandis que les naufragés, au nombre de trois milliards, devront se contenter d'errer sur des mondes peu hospitaliers comme les sous-sols de la trop chaude Mercure ou les cités enterrées des satellites glacés de Jupiter et Saturne.
À la toute fin du XXIIIe siècle, la Terre est devenue exsangue à la suite des nombreux dérèglements générés par l'activité humaine. Les êtres humains sont dans l'obligation de la fuir. Les plus chanceux s'installent sur Mars et Vénus, deux planètes terraformées, tandis que les naufragés, au nombre de trois milliards, devront se contenter d'errer sur des mondes peu hospitaliers comme les sous-sols de la trop chaude Mercure ou les cités enterrées des satellites glacés de Jupiter et Saturne.
Au fil des siècles, Mars et Vénus vont asseoir leur domination et entrer en forte concurrence. Vénus est protégée des rayonnements cosmiques du proche Soleil par un immense anneau artificiel, le Parasol, et a développé les voyages spatiaux. De leur côté, les Martiens ont mis en place un programme de restauration du corps humain appelé la "métempsychose artificielle". Ils ont confié leur gouvernement à une IA représentant tous les habitants de Mars et nommée la Volonté Générale Martienne.
En 2772, lorsque l'histoire démarre, le capitaine Mark Slaska se réveille à bord d'un vaisseau, le Serpent des Neiges, parti cinquante-sept ans auparavant du système solaire afin de rejoindre la planète Alsafi c tournant autour de l'étoile Sigma Draconis située à dix-neuf années-lumière du Soleil. Comme pour la cinquantaine de ses coéquipiers, sa personnalité se voit restaurée dans un nouveau corps à l'issue du voyage.
La mission, menée conjointement par les Martiens et les Vénusiens, a pour objectif l'exploration de la planète Alsafi c. En effet, lors d'une précédente mission sur Mercure, Mark a pris connaissance d'une information extrêmement troublante : quatre cent soixante-treize ans plus tôt, lors des migrations massives pour fuir la Terre, un vaisseau rempli de migrants, L'Embrun 17, a atteint le système de l'étoile Sigma Draconis instantanément !
Comment un tel miracle est-il possible ? Quelle est la force à l'origine de ce déplacement incompréhensible ? Une conscience extraterrestre est-elle à l'œuvre ?
Mars et Vénus, en alliant leur savoir-faire dans cette périlleuse mission, veulent chacune acquérir cette technologie qui les rendrait extrêmement puissantes.
Mark, agent du Conseil de Défense de Mars, est plus particulièrement accompagné de la Vénusienne Karen et de la naufragée Línea qui a obtenu un statut particulier de réfugiée sur Vénus pour acte de bravoure.
Malheureusement, dès l'arrivée à destination de la planète, un drame survient laissant les trois protagonistes livrés à eux-mêmes et dans l'impossibilité de regagner leur système solaire d'origine...
Pour son troisième roman, le jeune auteur Romain Benassaya nous offre un space opera abordant de nombreux thèmes.
L'intelligence artificielle régit une grande partie de l'humanité tant au sens communautaire qu'au sens individuel. Le voyage spatial s'est considérablement développé au sein de notre système solaire et le transhumanisme est devenu une réalité. La terraformation d'autres planètes a également fonctionné avec succès.
À côté de ce qui peut paraître comme des avancées considérables, d'autres thèmes moins souriants sont omniprésents : l'homme n'a pas réussi à juguler la destruction de son environnement ni à contrôler les naissances, il n'a pas non plus réduit les inégalités mais a continué à entasser des milliards de migrants dans des esquifs de fortune ou sur des terres inhabitables ; enfin, il est toujours soumis au joug de la religion et de ses dérives extrémistes dès lors qu'il est confronté à de nouvelles peurs...
Ces très nombreux sujets sont traités dans des chapitres assez courts privilégiant le mouvement, les dialogues et les rebondissements. Ainsi, le lecteur est rapidement pris dans le feu de l'action. Pour autant, l'écriture de Romain Benassaya demeure toujours aussi soignée et précise. Sa prose est claire et agréable à lire.
Par rapport à ses deux précédents romans, Les naufragés de Velloa est tout de même d'un niveau moindre. L'histoire comporte quelques facilités et inégalités sur le plan de la qualité narrative. Par exemple, le voyage de Dayani à travers l'océan de Velloa, nom donné à la planète Alsafi c par ses autochtones, manque de caractère et fait penser à une histoire pour collégiens. Les monstres et extraterrestres sont presque trop présents par moment et leurs comportements un peu tarabiscotés... Tout cela contribue à donner une dimension un peu "old school" à cette science-fiction, comme à l'époque des magazines pulps des années 30 et 40. Ce style, qui plaira à certains, est certainement voulu comme en témoigne la référence aux Morlocks de H. G. Wells pour désigner les réprouvés vivant dans les grottes de Velloa.
Pour conclure, nous avons ici un livre divertissant, prenant et abordant une myriade de thèmes - ce qui explique peut-être son petit côté bancal - et qui peut difficilement rivaliser avec le titre précédent de l'auteur, Pyramides, qui était extrêmement percutant et vertigineux avec, chose qui me convient davantage, un côté plus scientifique et cartésien.
[Critique publiée le 29/03/24]

Q U A N T I K A | Vestiges (tome 1) |
Laurence Suhner - 2012
L'Atalante - 512 pages
17/20
Fouilles archéologiques sur une planète extrasolaire
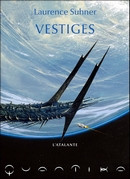 Après avoir tenté sans succès de coloniser la planète Mars, l'humanité s'est attelée à la conquête de Gemma, une planète extrasolaire située à 6,5 années-lumière de la Terre. Recouvert d'une épaisse couche de glace, l'astre est situé dans la constellation de l'Éridan et nécessite dix-sept années de voyage pour s'y rendre. De plus, il possède une lune nommée Marie-Antoinette et orbite autour de l'étoile double Alta-Mira.
Après avoir tenté sans succès de coloniser la planète Mars, l'humanité s'est attelée à la conquête de Gemma, une planète extrasolaire située à 6,5 années-lumière de la Terre. Recouvert d'une épaisse couche de glace, l'astre est situé dans la constellation de l'Éridan et nécessite dix-sept années de voyage pour s'y rendre. De plus, il possède une lune nommée Marie-Antoinette et orbite autour de l'étoile double Alta-Mira.
En 2310, cinq millions d'êtres humains peuplent désormais cette terre isolée après plus de cent années d'immigration.
Certains, surnommés "Les enfants de Gemma", n'ont jamais connu leur planète d'origine ; ils sont nés dans ce nouvel environnement, ont appris à l'aimer et à le défendre des griffes de ceux qui exploitent ses gisements riches en énergies fossiles et en minerais.
Il y a cependant ce qui pourrait s'apparenter à un simple détail vu de la surface de Gemma tant cela est petit et presque invisible à l'œil nu : un artefact extraterrestre de forme hélicoïdale, long de soixante-deux kilomètres, hérissé de pics et muni à ses extrémités de deux longues dents pointues, gravite autour de la planète de glace.
Malgré de nombreuses tentatives de contact, l'artefact semble être totalement éteint et inerte. Au fil des décennies, l'humanité a d'ailleurs fini par abandonner l'idée même d'entrer en relation avec les "propriétaires" de ce vaisseau de technologie totalement inconnue. Certains parviennent à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête tandis que d'autres observent avec anxiété ce qui a été dénommé Le Grand Arc.
La scientifique Ambre Pasquier est arrivée dans le système Alta-Mira il y a cinq ans. Comme d'autres de ses confrères, elle vit à bord de Nouvelle Prospérité qui est une ville spatiale gravitant à cinq mille mètres au-dessus de Gemma. À la tête d'une équipe de quinze chercheurs, elle est responsable du projet Archéa mis sur pied à la suite de relevés cartographiques depuis l'espace qui ont révélé l'existence de vestiges archéologiques vieux de douze mille années terrestres.
La mission consiste à forer les près de quatre kilomètres d'épaisseur de glace afin d'explorer ces nouvelles traces d'une civilisation extraterrestre. Et de peut-être répondre à la question suivante : leur origine est-elle la même que celle de l'artefact en orbite ?
Sans oublier de nombreuses autres interrogations... Pourquoi Ambre Pasquier fait-elle sans cesse et depuis des années des cauchemars lui intimant de pénétrer au cœur de ces ruines souterraines ? Quelle est l'histoire ancienne de Gemma ?
Petit à petit, le lecteur est embarqué dans un nouveau monde fait de mystères et de questions qu'une poignée de scientifiques tentent de comprendre de manière rationnelle et humaine à défaut d'autre chose. Leurs raisonnements seront mis à rude épreuve face à des phénomènes quantiques relevant de l'absurde le plus total. Les intérêts divergents au sein des habitants de la planète répartis entre scientifiques, industriels, autochtones et miliciens, seront également propices à de nombreuses tensions et multiples rebondissements.
Laurence Suhner parvient à mettre progressivement en place au fil des pages un univers original et unique qui positionne au premier plan la question fondamentale de la place de l'homme dans l'univers.
Les analyses cartésiennes des chercheurs offrent un socle solide au roman et lui confère une dimension scientifique qui vient équilibrer des considérations plus oniriques et mythologiques. Car l'autrice suisse intègre aussi à son récit de science-fiction de nombreuses références à l'hindouisme et à ses divinités, telle Shiva, à travers l'enfance indienne de son héroïne Ambre Pasquier.
L'écueil de l'anthropomorphisme est contourné avec justesse. Laurence Suhner y cède quelque peu pour faciliter la construction de son histoire semble-t-il mais n'élude pas pour autant la question en l'intégrant à plusieurs reprises dans le discours de ses personnages qui s'inquiètent à raison des biais d'interprétation que cela leur confère naturellement.
Ce premier tome de la trilogie Quantika a remporté les prix Bob Morane et Révélation Adulte des Futuriales en 2013. L'écriture est soignée tout en étant très fluide. Elle offre la vision d'un monde qui m'a parfois fait penser à celui des films Avatar mais plonge avant tout le lecteur dans des questionnements existentiels sur la possibilité d'une vie ailleurs dans l'univers. Question ô combien vertigineuse !
[Critique publiée le 10/11/25]

Q U A N T I K A | L'ouvreur des chemins (tome 2) |
Laurence Suhner - 2013
L'Atalante - 451 pages
18/20
Effondrement de la réalité
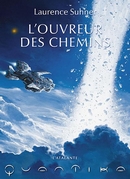 Ce second tome permet au lecteur de revenir à la surface de la planète glacée Gemma après l'exploration souterraine des vestiges extraterrestres décrite dans Vestiges.
Ce second tome permet au lecteur de revenir à la surface de la planète glacée Gemma après l'exploration souterraine des vestiges extraterrestres décrite dans Vestiges.
La scientifique Ambre a enfin rencontré celui qui, dans ses rêves, était surnommé le Dieu Sombre. Cependant, l'échange avec la créature inconnue s'avère complexe et la conduit à des accès de violence qui rendent l'humaine totalement désemparée et incapable de comprendre la terrible menace qui pèse sur Gemma. Car Ambre a provoqué malgré elle la libération d'une force maléfique aux pouvoirs destructeurs se situant au-delà de l'entendement humain, celle du Dévoreur de réalité...
De son côté, le xénologue Seth Tranktak vit une expérience quantique totalement incompréhensible, altérant son identité même et transcendant sa connaissance de l'univers tout entier. De plus, ses liens avec la milice contribuent malheureusement à renforcer encore davantage les désirs de domination des militaires.
La plupart des scientifiques vont être aidés par les indépendantistes qui possèdent une base totalement autonome et cachée à flanc de montagne. Ayant en leur possession Icare, un vaisseau volé aux miliciens, ils vont devoir prendre de la hauteur pour comprendre et tenter d'arrêter un phénomène hors-norme : une singularité gigantesque se matérialisant par un faisceau vertical de lumière blanche jaillissant de la surface du sol, entouré de blocs de glace de la taille d'une maison en suspension et faisant disparaître la matière !
La magnifique couverture de Manchu fait d'ailleurs référence à cette scène très impressionnante qui rend l'histoire totalement captivante : « A cet instant, le cœur de Kya s'arrêta. Elle attrapa la main de son père, qui ouvrit brutalement les yeux. Pas plus que Kya et le reste de l'équipage Stanislas ne comprit l'image qui avait envahi la vitre avant. Comment aurait-il pu ? Il n'y avait pas de terme scientifique pour décrire le phénomène qui se déroulait devant eux. »
Dans ce second épisode, Laurence Suhner continue de mêler des phénomènes dépassant la compréhension humaine à la rationalité d'un groupe de physiciens et biologistes tentant en vain de raisonner avec leurs connaissances de terriens. Malgré leurs tentatives de raisonnement faisant appel aux propriétés de la physique quantique, Stanislas ou Haziel restent interdits face à une singularité impossible selon leurs modélisations. Cet événement ainsi que l'expérience vécue par le linguiste Tranktak donnent une coloration vertigineuse au récit.
Le rythme du roman, avec ses courts chapitres contenant moult rebondissements, est bien dosé pour une lecture addictive.
L'autrice résidant dans le Valais Suisse équilibre de façon plutôt juste à mon goût les explications scientifiques et la dimension plus fantastique. Les réflexions de physique quantique qui sont tout à fait sérieuses ou encore les interrogations sur la place des mathématiques, évidente pour nous humains, dans l'explication de l'univers entrent en confrontation avec des phénomènes plus fantasmagoriques comme ceux liés à ces entités qui semblent mener un combat aux dimensions interstellaires.
La question du dialogue avec l'autre et ses différences est aussi au cœur de la réflexion. Dans notre monde d'aujourd'hui de plus en plus exposé à l'intolérance, la question de la communication a malheureusement repris tout son sens. On pourrait voir ici une analogie avec le rejet des migrants ou de certains étrangers par peur de leur différence.
La dimension poétique n'est pas oubliée non plus. Elle s'exprime à travers la culture indienne et la recherche par Ambre de ses origines mais elle réside aussi dans le personnage de Stanislas Stanford. Celui-ci, plongé dans la tentative de compréhension des singularités quantiques depuis déjà plusieurs années, est le portrait même du scientifique mêlant simplicité, humilité et grande expertise. Laurence Suhner s'est inspirée de Hubert Reeves et l'on retrouve en effet cette dualité dans le caractère de Stanislas entre l'analyse purement scientifique des phénomènes physiques et la volonté de réenchanter le monde grâce à la poésie. Hubert Reeves, contrairement à beaucoup de ses pairs, a toujours cherché à embrasser dans sa carrière ces deux pendants de la démarche intellectuelle : science et poésie. Merci pour ce clin d'œil à cet immense pédagogue.
Enfin, L'ouvreur des chemins n'est pas du tout un tome de transition comme cela arrive parfois dans une trilogie. Pour ma part, je pense l'avoir trouvé encore plus excitant et passionnant que le premier opus !
[Critique publiée le 10/11/25]

Q U A N T I K A | Origines (tome 3) |
Laurence Suhner - 2015
L'Atalante - 568 pages
17/20
Retour sur Timhkâ
 Ambre, Kya, Stanislas et leurs coéquipiers sont enfin parvenus à pénétrer dans le mystérieux artefact gravitant autour de la planète glacée Gemma. Là, un nouveau monde s'ouvre à eux. Aussi surprenant et déroutant que cela puisse paraître, le vaisseau d'origine extraterrestre est un monde à part entière contenant des montagnes, un océan, une végétation dense ainsi qu'une faune. En outre, il n'y a semble-t-il ni paroi, ni toit et le climat est chaud et tropical. Tout cela est évidemment source d'interrogations et d'inquiétudes parmi les pionniers embarqués dans un voyage incertain dont la destination est inconnue.
Ambre, Kya, Stanislas et leurs coéquipiers sont enfin parvenus à pénétrer dans le mystérieux artefact gravitant autour de la planète glacée Gemma. Là, un nouveau monde s'ouvre à eux. Aussi surprenant et déroutant que cela puisse paraître, le vaisseau d'origine extraterrestre est un monde à part entière contenant des montagnes, un océan, une végétation dense ainsi qu'une faune. En outre, il n'y a semble-t-il ni paroi, ni toit et le climat est chaud et tropical. Tout cela est évidemment source d'interrogations et d'inquiétudes parmi les pionniers embarqués dans un voyage incertain dont la destination est inconnue.
Ils vont cependant traverser l'espace-temps de façon totalement surprenante et vertigineuse pour fouler le sol de la planète d'origine de Tokalinan et du peuple Timhkân. À nouveau, voici un monde totalement inconnu qu'ils vont devoir appréhender avec leurs réflexes humains et leurs biais anthropomorphiques.
Sur la forme, les chapitres alternent entre les différents personnages afin de décrire leur progression respective sur une planète quasiment recouverte d'eau, hébergeant quelques créatures particulièrement monstrueuses et dont les trois lunes provoquent des marées d'une violence et d'une soudaineté extrême...
L'entité Ioun-ké-da est aussi du voyage tel le ver dans le fruit et Ambre sera la clé pour parvenir à stopper ses désirs d'annihilation.
Ce troisième opus est davantage axé sur un récit d'aventure proposant de l'action et même de la violence à travers des confrontations sanguinaires entre autochtones de la planète Timhkâ. Mais contrairement aux humains, le roman nous présente un peuple qui a su créer une intelligence collective afin de dominer les forces individualistes qui mènent bien souvent à l'autodestruction d'une espèce dite "intelligente". Grâce à cette conscience commune dont la puissance est quasiment infinie, les Timhkâns ont basé leur appréhension du monde sur ses "essences animées" et non sur les mathématiques comme nous.
À titre personnel, les digressions scientifiques et métaphysiques rencontrées en plus grand nombre dans les tomes précédents m'ont un peu manqué ici. J'ai également ressenti quelques longueurs dans la narration des parcours des protagonistes décrits tant dans Le Grand Arc que sur la nouvelle planète.
Hormis ces remarques, Laurence Suhner parvient tout de même à conclure avec brio cette œuvre de science-fiction assez imposante et qui ouvre de belles réflexions sur notre place dans l'univers, notre anthropomorphisme, les états quantiques ou encore la richesse de la culture hindoue. Certes, la destinée du personnage central, Ambre, peut sembler un peu déroutante à la fin par le mysticisme associé et le manque d'explication rationnelle dont je parlais à l'instant, mais la chute finale sur la destinée de la planète glacée Gemma est quant à elle totalement surprenante et l'autrice a su exploiter à merveille la physique quantique et le principe des états superposés comme l'illustre le célèbre Chat de Schrödinger.
La trilogie Quantika m'aura fait penser à d'autres univers plus ou moins inconsciemment j'imagine : Avatar bien sûr de James Cameron pour ces êtres humanoïdes vivant en parfaite symbiose avec leur riche environnement, V la série américaine des années 80 pour la base cachée des indépendantistes ou encore Les mondes d'Aldébaran cette série de bande dessinée de Leo pour les créatures exotiques, les anomalies quantiques ou le miracle se produisant sur la main amputée de Léna...
Terminons avec un extrait qui donne une idée de la profondeur des réflexions abordées dans ces trois romans salués d'ailleurs par le maître anglais de science-fiction Christopher Priest : « De tout temps, les humains avaient recherché la vie, l'intelligence, dans le vaste monde qui les entourait... Et si, en définitive, cette vie tant convoitée avait toujours été autour d'eux, à l'intérieur d'eux ? Et si elle était partout, dès l'origine, cryptée dans la trame même de l'univers ? Une vie, issue des fluctuations quantiques du vide... une vie, ou plutôt une conscience inorganique. Et si l'univers était un être vivant ? »
[Critique publiée le 10/11/25]

L E T E R M I N A T E U R
Laurence Suhner - 2017
L'Atalante - 184 pages
15/20
De Genève aux confins de l'univers
 Laurence Suhner nous présente dans ce recueil douze nouvelles qu'elle a écrites entre 1980 et 2017. Chacune d'entre elles est introduite par un petit texte précisant son contexte d'écriture. Cela permet, en filigrane, de mieux connaître la romancière suisse qui est entrée avec brio dans le monde de la littérature de science-fiction en 2012 grâce à la trilogie Quantika.
Laurence Suhner nous présente dans ce recueil douze nouvelles qu'elle a écrites entre 1980 et 2017. Chacune d'entre elles est introduite par un petit texte précisant son contexte d'écriture. Cela permet, en filigrane, de mieux connaître la romancière suisse qui est entrée avec brio dans le monde de la littérature de science-fiction en 2012 grâce à la trilogie Quantika.
On y apprend par exemple sa passion pour la science dès son plus jeune âge grâce, notamment, à Hergé et son célèbre professeur Tournesol.
Le titre de l'ouvrage reprend celui de l'une des nouvelles qui a aussi été publiée cette année dans la prestigieuse revue scientifique Nature.
Suite à la fabuleuse découverte d'un système extrasolaire de sept planètes de type terrestre autour de l'étoile Trappist-I, Laurence Suhner a laissé travailler son imagination dans deux textes. Elle y décrit un monde peuplé de créatures marines intelligentes et visité par l'homme dans un lointain futur. Les planètes étant en rotation synchrone avec leur étoile, elles lui présentent toujours la même face. Le « terminateur » est cette ligne imaginaire qui relie les deux parties d'ombre et de lumière. Tout cela est évidemment vertigineux pour le lecteur et permet d'être au courant des dernières avancées scientifiques...
Homéostasie est un récit pessimiste écrit en 2008. Notre planète est envahie par une neige noire qui annonce son agonie. Gaïa est vue comme un être vivant à part entière avec qui il faut impérativement communiquer pour éviter le pire.
Mais n'est-ce pas trop tard ? L'homme n'est-il pas allé trop loin ? Cette histoire résonne évidemment avec la terrible crise écologique que nous vivons aujourd'hui et qui est, selon moi, le défi majeur de notre siècle.
Dans Le corbeau, il est question d'un écrivain de la fin du XIXe siècle qui devient la victime d'un personnage de papier sorti de sa propre imagination. Laurence Suhner rend ici hommage, à travers l'ambiance du texte, à des auteurs majeurs comme Agatha Christie ou Edgar Allan Pœ.
Timhka se situe dans l'univers de Quantika et correspond à un travail de préparation et de recherche au sujet de la trilogie. Là encore, le lecteur est transporté sur une exoplanète et découvre le quotidien d'un ethnologue qui tente de comprendre les êtres intelligents qui y vivent. Comme bien souvent, la science-fiction permet d'aborder des sujets d'actualité et, ici, l'incompréhension couplée à l'arrogance des humains face aux entités extraterrestres n'est pas sans rappeler la destruction des peuples primitifs d'Amazonie, le rejet des migrants en Europe, ...
J'ai particulièrement aimé La valise noire et L'autre monde qui m'ont fait penser à la mythique série télévisée américaine de Rod Sterling : La Quatrième Dimension (The Twilight Zone en version originale). La première nouvelle nous confronte à différentes réalités qui cohabitent entre elles. La seconde nous met dans la tête d'Astor Pilgrim visitant une obscure boutique d'antiquités à Genève. La fin est brillante avec un changement de focale qui nous montre l'envers du décor...
Pour conclure, il y a comme dans tout recueil de nouvelles des textes que l'on aime beaucoup et d'autres qui nous laissent sur notre faim. Je lis très peu de récits courts car ce format ne me convient pas ; j'ai besoin de plonger dans de longs romans qui m'évadent durablement. Pour Laurence Suhner, j'ai néanmoins fait une exception et cela fût une expérience très intéressante !
[Critique publiée le 19/04/19]

A P O L L O 1 3
Jim Lovell / Jeffrey Kluger - 1994
Robert Laffont - 426 pages
14/20
Trois hommes à bord d'un module spatial gravement endommagé entre la Terre et la Lune
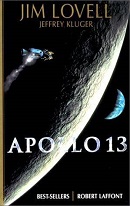 Le 11 avril 1970, la fusée Saturn V décolle de Floride afin d'envoyer les hommes de la mission Apollo 13 sur la Lune. Apollo 11 et 12 ont déjà permis de fouler le sol de notre satellite. Cette nouvelle étape du prestigieux programme américain Apollo lancé par Kennedy doit, entre autres, permettre d'étudier davantage la géologie lunaire. Trois hommes sont à bord : le commandant Jim Lovell et ses deux équipiers Jack Swigert et Fred Haise.
Le 11 avril 1970, la fusée Saturn V décolle de Floride afin d'envoyer les hommes de la mission Apollo 13 sur la Lune. Apollo 11 et 12 ont déjà permis de fouler le sol de notre satellite. Cette nouvelle étape du prestigieux programme américain Apollo lancé par Kennedy doit, entre autres, permettre d'étudier davantage la géologie lunaire. Trois hommes sont à bord : le commandant Jim Lovell et ses deux équipiers Jack Swigert et Fred Haise.
Alors que le vaisseau est à mi-chemin de son objectif, Swigert lance le brassage de l'oxygène contenu dans le réservoir numéro 2 sur demande du centre de contrôle de Houston qui pilote à distance l'ensemble des opérations. Soudain, les trois astronautes entendent le bruit d'une explosion. C'est à ce moment-là que Swigert prononce cette phrase devenue si célèbre : « Houston, we've had a problem. »
Dans un premier temps, l'ampleur du problème n'est pas bien comprise. Petit à petit, cependant, les ingénieurs de Houston qui contrôlent l'ensemble des paramètres du vol découvrent différentes anomalies : antenne de communication endommagée, piles à combustible déchargées, réservoir numéro 2 d'oxygène vide, réservoir numéro 1 en perte de pression, circuit électrique en panne.
Rapidement, les dernières ressources en énergie du module de commande s'épuisent. Le directeur de vol, Gene Kranz, prend alors la décision d'abandonner ce module et d'utiliser le vaisseau lunaire, Aquarius, pour ramener l'équipage sain et sauf au bercail. La tension est extrême car le module lunaire, en sommeil à ce stade de la mission, doit être réveillé par une source d'énergie extérieure. Celle-ci est puisée dans le peu restant dans le module de commande et couplée à celle prévue pour le module de descente sur la Lune, ce dernier objectif ayant bien évidemment été abandonné.
Aquarius est réactivé de justesse et devient alors le canot de sauvetage de l'équipage. Les trois hommes s'installent dans le module lunaire prévu pour accueillir deux personnes et coupent temporairement les équipements non indispensables afin de garder suffisamment d'énergie pour la dernière phase d'approche de la Terre.
Les ingénieurs de Houston doivent encore s'activer pour définir le meilleur scénario de retour possible en tenant compte des ressources limitées de l'appareil. La décision est prise par Kranz de continuer vers la Lune pour la contourner et bénéficier ainsi de la force d'inertie fournie.
Évidemment, je ne dévoilerai pas la fin en rappelant que l'équipage a été ramené sain et sauf sur la Terre malgré des chances initiales de réussite extrêmement faibles.
Cette histoire est d'autant plus incroyable qu'elle provient de la réalité et non d'une fiction. Le périple raconté ici par le commandant Jim Lovell et le journaliste Jeffrey Kluger a permis la publication d'un livre traitant d'un sujet difficilement imaginable. Un écrivain de science-fiction aurait-il fait mieux ? Ron Howard s'est même appuyé dessus pour la réalisation du film éponyme en 1995.
Bref, le programme Apollo aura été une véritable épopée digne d'Hollywood !
En ce qui concerne la lecture de ce récit, j'avoue tout de même avoir eu quelques moments de faiblesse.
L'écriture est aride car, malgré les efforts de vulgarisation, le vocabulaire reste souvent technique. Hormis quelques simplifications narratives, le livre retranscrit l'ensemble des échanges entre l'équipage d'Apollo 13 et le centre de contrôle de Houston. Les Capcom, EECOM et autres spécialistes enchaînent les conversations avec les hommes en route pour la Lune. Tous les détails sont mentionnés...
Selon l'intérêt de chacun dans l'approfondissement de la compréhension de la mission, certaines pages peuvent donc être plus ou moins rébarbatives ! Comme indiqué plus haut, cela est conforté par le fait que ce récit n'est pas une fiction et n'a pas vocation à être lu comme un roman. Il s'agit d'un document, d'un témoignage, aussi rocambolesque soit-il.
Le film étant très fidèle au livre, il peut parfaitement suffire à découvrir cette mission de sauvetage inouïe car Ron Howard a parfaitement su vulgariser sur le grand écran les étapes du voyage entre la Terre et la Lune.
[Critique publiée le 19/04/19]

L E S D A M E S B L A N C H E S
Pierre Bordage - 2015
L'Atalante - 377 pages
18/20
Un récit captivant, vertigineux et engagé
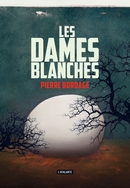 Cela pourrait se produire aujourd'hui, demain, dans dix ans... Une bulle géante qui apparaît dans un champ. Un enfant de trois ans et demi qui, de sa maison, la voit et décide de s'y rendre. Sa maman qui le cherche en vain et qui, malgré l'absence de trace, est bien obligée d'admettre l'impossible : le petit garçon a littéralement disparu.
Cela pourrait se produire aujourd'hui, demain, dans dix ans... Une bulle géante qui apparaît dans un champ. Un enfant de trois ans et demi qui, de sa maison, la voit et décide de s'y rendre. Sa maman qui le cherche en vain et qui, malgré l'absence de trace, est bien obligée d'admettre l'impossible : le petit garçon a littéralement disparu.
Voilà comment débute ce roman prenant de Pierre Bordage. Par un fait que l'on aurait pu qualifier de « divers » si ce n'est la présence incongrue de cette bulle digne du rôdeur de la mythique série Le prisonnier.
Doucement, en France et ailleurs dans le monde, de semblables phénomènes se répètent. À chaque fois, une sphère immobile apparaît comme par magie et les jeunes enfants des alentours disparaissent malgré toutes les précautions de leurs parents. Ils sont comme happés par ces objets diaboliques.
Les gouvernements tentent tout d'abord d'y répondre par la force : des explosifs de plus en plus puissants sont utilisés pour tenter de détruire ces « dames blanches ». En vain... Même les charges nucléaires sont inoffensives.
Finalement, des enfants ceinturés de charges explosives sont sacrifiés pour le bien de l'humanité. Les quelques effets positifs constatés sur l'apparence des bulles conduisent les décideurs politiques à promulguer la loi d'Isaac : celle-ci oblige chaque famille à condamner un enfant au bénéfice de la guerre mondiale que l'humanité a déclenché contre les envahisseurs.
Pierre Bordage, écrivain ô combien simple et sympathique, nous conte cette folle histoire sur une quarantaine d'années. Ses personnages s'étalent sur plusieurs générations, de celle ayant vu les toutes premières apparitions du phénomène à celle partageant la planète avec des millions d'hôtes autour desquels le mystère reste entier.
La science-fiction, comme le défend Bordage, permet d'aborder le réel mieux que tout autre récit dit de littérature blanche.
Ici, de nombreuses thématiques actuelles sont présentes. Avant tout, la peur de la différence, de l'autre est au cœur du sujet. La dame blanche symbolise l'étranger qui s'implante dans notre quotidien et avec qui l'on ne cherche pas vraiment à communiquer. Ce renoncement de l'échange conduit au rejet, à la simplification, aux raccourcis et à la malveillance.
L'auteur vendéen, à travers la loi Isaac, créé un monde dictatorial, une société cauchemardesque où des milices opèrent afin de faire respecter les décisions politiques. Le peuple entre, en grande majorité, dans la désobéissance civile. Cela mène à des combats aux quatre coins de la planète contre la réquisition toujours croissante des jeunes enfants. Le parallèle avec la résistance contre le nazisme dans les années 40 est évidemment saisissant.
Les dames blanches traite aussi du deuil. La plupart des personnages sont confrontés à la perte de leur enfant, drame sans doute le plus terrible qui puisse survenir à des parents. La fatalité de cette situation génère à la fois tristesse, colère et gâchis.
Enfin, Pierre Bordage fait prendre à son lecteur beaucoup de hauteur pour l'emmener, à travers un récit vertigineux, à réfléchir sur la place de l'homme dans l'univers et le sens de la vie. Et cette cerise sur le gâteau, seuls des romans d'anticipation peuvent l'apporter. Ainsi, louons ce genre aussi noble que n'importe quel autre, n'en déplaise à certains critiques repliés sur leurs préjugés poussiéreux !
Pour terminer, je souhaiterais mettre l'accent sur la fluidité de la narration. Bordage, surnommé « le Balzac de la science-fiction », peut également se targuer d'être un digne héritier du grand Alexandre Dumas. Ses chapitres, construits comme des feuilletons, sont équilibrés, efficaces et rythmés avec un brio remarquable. Une belle leçon d'écriture pour ceux qui chercheraient un modèle !
[Critique publiée le 03/09/17]

P O I N T S C H A U D S
Laurent Genefort - 2012
Le Bélial' - 235 pages
12/20
Invasion d'aliens
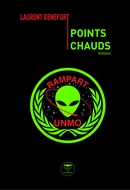 À partir de l'année 2019, des « bouches » s'ouvrent sur Terre.
À partir de l'année 2019, des « bouches » s'ouvrent sur Terre.
Ce phénomène incroyable et incompréhensible est concomitant à l'arrivée massive d'extraterrestres sur notre planète. Ces bouches, qui se multiplient de façon considérable, constituent des portes d'entrée et de sortie sur notre planète. Des troupeaux entiers d'aliens y apparaissent puis entament de longs périples et transhumances afin de trouver la porte de la station suivante.
La Terre se retrouve subitement au sein d'un gigantesque réseau interplanétaire de mondes connectés les uns aux autres.
Certains extraterrestres ne poursuivent pas le voyage et décident carrément de s'installer chez nous. Ces êtres venus d'ailleurs ne sont généralement pas belliqueux ; ils ne portent d'ailleurs aucune attention aux êtres humains qui ne sont pour eux qu'une espèce banale parmi tant d'autres.
À la fin du roman, un lexique décrit les différentes races en transit sur la Terre. Leurs mœurs, caractéristiques morphologiques, langages et caractères sont ainsi minutieusement répertoriés.
Bref, la vie dans l'univers existe et même foisonne ! Du jour au lendemain, la représentation humaine du cosmos est donc totalement ébranlée.
J'avoue avoir eu quelques difficultés à accepter le postulat de base. Mon esprit cartésien s'accommode assez mal avec le space opera qui demande de se projeter instantanément dans un monde très différent du nôtre. Je préfère les romans qui restent à la lisière entre notre univers et celui du mystère comme Spin ou Roadmaster par exemple.
Points chauds est pourtant le texte le plus accessible de Laurent Genefort. C'est lui-même, lors d'une rencontre au Festival Étonnants Voyageurs en 2016, qui m'a proposé de commencer par ce titre dans sa production dense.
La construction et le découpage du récit m'ont également légèrement dérouté. Plusieurs histoires s'entremêlent comme autant de petites nouvelles, ce qui ne facilite pas la mise en place d'un fil directeur dans la tête du lecteur.
En revanche, des points positifs existent bel et bien. Pour commencer, l'auteur boucle son roman avec élégance. Ensuite, il faut bien sûr voir dans ce livre de science-fiction une allégorie en totale résonnance avec l'actualité internationale : les aliens représentent les migrants, les réfugiés, qui, sans défense, recherchent une terre propice à leur épanouissement.
Vu sous cet angle, Points chauds prend une véritable dimension et invite le lecteur à réfléchir sur les motivations de ces étrangers, leur différence et la peur infondée qu'ils infligent à beaucoup d'entre nous. C'est dans cette réflexion que réside l'intérêt principal du récit de Laurent Genefort.
[Critique publiée le 19/11/16]

S P I N
Robert Charles Wilson - 2005
Denoël - 545 pages
18/20
Le destin de trois amis confrontés à une modification majeure du cosmos
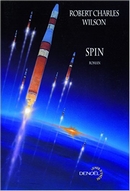 Dans un futur proche, un événement incroyable surgit brutalement : durant une nuit d'octobre, les étoiles disparaissent du ciel. Trois adolescents, Tyler, Jason et sa sœur jumelle Diane, sont témoins directs de cette modification cosmique alors qu'ils prenaient l'air dans leur jardin.
Dans un futur proche, un événement incroyable surgit brutalement : durant une nuit d'octobre, les étoiles disparaissent du ciel. Trois adolescents, Tyler, Jason et sa sœur jumelle Diane, sont témoins directs de cette modification cosmique alors qu'ils prenaient l'air dans leur jardin.
Terriblement anxiogène pour l'humanité, l'absence des étoiles perdure des années. La lune aussi a disparu. Le soleil, quant à lui, est un simulacre. Hormis une voûte céleste plongée chaque nuit dans l'obscurité la plus totale, le cycle de la vie sur la Terre n'est pas impacté car le climat est apparemment préservé. Du côté des technologies humaines, les conséquences retentissent davantage car l'usage des satellites devient impossible.
S'adaptant au mieux face à ce bouleversement, l'humanité poursuit son chemin en croulant sous le poids d'une infinité de questions métaphysiques et angoissantes sur l'origine de l'isolement de sa planète. Il s'avère en effet que la Terre est entourée d'une sorte de membrane nommée le Spin.
Les trois adolescents grandissent. Jason, fils d'un industriel influent, consacre sa vie à comprendre le phénomène sur le plan scientifique. Sa sœur Diane sombre, elle, dans le mysticisme et la religion. Tyler, le narrateur de l'histoire, devient quant à lui médecin.
À la tête de la fondation Périhélie qu'il crée avec son père, Jason est au premier plan dans les découvertes liées au Spin. Ainsi, le fait est que la membrane isole également temporellement notre astre : une année sur Terre équivaut à cent millions d'années dans le reste de l'univers.
La mort du Soleil devient alors un sujet terriblement contemporain. Les cinq milliards d'années qui paraissaient auparavant infinies à l'humanité ne vont « durer » que cinquante ans sur la Terre !
Que faire pour échapper à un sort funeste imminent ? Qui sont les « Hypothétiques », nom donné à l'entité responsable du Spin ? Quel est leur but ? Que va devenir l'humanité ?
Difficile d'en dire davantage sans déflorer l'intrigue qui renferme quelques belles surprises. Je pense notamment à l'exploitation du décalage temporel qui va permettre la mise en œuvre d'un projet pharaonique dédié à la planète Mars. Et cela ira bien au-delà du système solaire...
Robert Charles Wilson écrit un roman de science-fiction intelligent. Le point de départ est évidemment fascinant et, bien que terrifiant, parfaitement imaginable.
L'avantage de ce genre littéraire, c'est qu'il permet d'ouvrir le champ des possibles de manière incroyable. Barjavel déclarait même à Jacques Chancel, il y a quelques décennies, que la science-fiction « est devenue, je ne dirais pas un nouveau genre littéraire, mais une nouvelle littérature. Je crois, je n'appelle pas la science-fiction un genre littéraire, parce qu'elle comprend tous les genres ».
Spin montre une fois de plus que la science-fiction est en littérature un thème majeur et riche. Le pouvoir de l'imaginaire y est considérablement stimulé.
L'auteur joue avec les focales pour, d'un côté, aborder un sujet macroscopique à travers l'évolution de notre planète et du système solaire et, de l'autre, dresser le portrait sous l'angle sociologique d'une poignée d'individus. Cette mise en rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit est à l'origine d'une sorte de vertige que le livre crée chez le lecteur.
Robert Charles Wilson prend le lecteur par la main et lui fait lever les yeux vers l'infini du ciel. Les questions qui resteront toujours sans réponse de la part de l'humanité fondent le récit et ses rouages : qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Sommes-nous seuls ? Quand l'humanité disparaîtra-t-elle ?
En filigrane apparaissent également les inquiétudes de l'écrivain américain sur le plan de l'écologie. L'histoire qu'il nous conte met en relief la fragilité et la rareté des ressources de notre planète.
Le thème de la religion et de ses dérives possibles est également très présent à travers le personnage de Diane.
Spin est un roman sombre et assez désespéré. La fin est émouvante, grandiose et invite au voyage.
Deux autres tomes, Axis et Vortex, poursuivent l'aventure ; l'ensemble formant une trilogie.
Enfin, notons que Spin a remporté le très prestigieux prix littéraire Hugo en 2006 ainsi que le Grand prix de l'Imaginaire en 2008.
[Critique publiée le 19/11/16]

A X I S
Robert Charles Wilson - 2007
Denoël - 388 pages
14/20
Un monde étrange qui conserve ses secrets
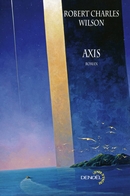 Dans la suite logique du premier tome qui invitait le lecteur à franchir l'Arc des « Hypothétiques » situé dans l'océan Indien, l'action se déroule désormais sur cette seconde planète située extrêmement loin de la Terre mais joignable très rapidement.
Dans la suite logique du premier tome qui invitait le lecteur à franchir l'Arc des « Hypothétiques » situé dans l'océan Indien, l'action se déroule désormais sur cette seconde planète située extrêmement loin de la Terre mais joignable très rapidement.
Sur ce Nouveau Monde, le continent Equatoria s'est progressivement peuplé et de nombreux villages ont vu le jour autour de sa capitale Port Magellan. Toutes sortes d'individus voulant changer de vie, de trafiquants, de mercenaires et de travailleurs ont franchi l'Arc en quête d'un nouveau départ ou de nouvelles ressources à exploiter sur l'astre inconnu.
Parmi eux, Lise Adams est venue pour retrouver son père, un scientifique en quête de réponses sur les « Hypothétiques » qui a disparu durant la rédaction d'un ouvrage intitulé La Terre comme Artefact.
Grâce à Turk Findley, pilote d'avion ayant fui les autorités sur Terre, Lise se rapproche d'une communauté de « Quatrièmes Âges » ; ce terme désigne les humains ayant pris le traitement martien de prolongation de la vie qui peut s'avérer efficace pour soigner une maladie entre autres. Elle y retrouve notamment Diane Lawton devenue infirmière au sein de la population Minang dans des lieux reculés du continent Equatoria.
Il est aussi question d'un jeune garçon prénommé Isaac au cœur du groupe des « Quatrièmes ». Inutile d'en dévoiler davantage mais l'auteur pose à travers lui la question de la manipulation génétique, du droit de disposer de la vie d'autrui pour faire avancer la connaissance humaine. Et sur Equatoria, le Département de Sécurité génomique pour lequel travaille l'ex-mari de Lise veille justement à ces questions d'éthique en luttant contre toute dérive dans cet univers où les questions existentielles sont devenues prédominantes et propices à toutes sortes d'expériences et de dérapages.
Le récit mêle ainsi une enquête quasiment policière menée par Lise à un univers imprévisible où des pluies de cendre phénoménales surviennent de plus en plus régulièrement donnant naissance à des objets incongrus dont personne ne comprend la signification : « En dix ans de Nouveau Monde, Turk n'avait jamais rien vu de semblable. Ce qui, en un sens, était tout à fait caractéristique. Le Nouveau Monde vous rappelait sans cesse qu'il n'était pas la Terre. Les choses s'y passaient différemment. »
Robert Charles Wilson nous livre ici ce qui ressemble bien à un tome de transition entre le premier volume qui avait créé la surprise par son originalité et le dernier de la trilogie qui sera, je l'espère, tout aussi fascinant.
Cette phase transitoire est un peu le piège classique au sein d'une trilogie et j'y ai effectivement ressenti un rythme plus mou, des situations qui se répètent, des chapitres qui deviennent moins captivants. Certes, des phénomènes troublants éveillent la curiosité du lecteur et ce dernier sait bien qu'il navigue dans un univers totalement hors de sa portée comme nous l'a prouvé l'auteur dans Spin ; mais Axis apporte trop peu de satisfaction dans la compréhension des « Hypothétiques » et manque de nouvelles données cartésiennes à se mettre sous la dent.
Je ressors donc légèrement asséché par cette lecture et espère un revirement total dans le titre suivant !
N'oublions pas pour autant de signaler la magnifique couverture signée une fois de plus par le grand Manchu.
[Critique publiée le 10/03/23]

L E S A F F I N I T É S
Robert Charles Wilson - 2015
Denoël - 325 pages
14/20
Extrapolation sur les réseaux sociaux
 Dans un futur proche, Adam Fisk, jeune étudiant originaire de l'État de New York et vivant à Toronto au Canada, pousse un peu par hasard et beaucoup par curiosité la porte d'un établissement proposant une analyse personnalisée du profil social. La société InterAlia offre ainsi la possibilité de passer des tests de personnalité qui, après leur exploitation par de puissants algorithmes, permettent ou pas d'affecter un individu à une Affinité. Celles-ci, au nombre de vingt-deux, regroupent des personnes qui sont naturellement enclines à s'entraider et coopérer et qui défendent les mêmes valeurs.
Dans un futur proche, Adam Fisk, jeune étudiant originaire de l'État de New York et vivant à Toronto au Canada, pousse un peu par hasard et beaucoup par curiosité la porte d'un établissement proposant une analyse personnalisée du profil social. La société InterAlia offre ainsi la possibilité de passer des tests de personnalité qui, après leur exploitation par de puissants algorithmes, permettent ou pas d'affecter un individu à une Affinité. Celles-ci, au nombre de vingt-deux, regroupent des personnes qui sont naturellement enclines à s'entraider et coopérer et qui défendent les mêmes valeurs.
InterAlia extrapole donc le concept des réseaux sociaux en l'adaptant à la vie réelle et non plus virtuelle uniquement. Les Affinités sont désignées par les lettres de l'alphabet phénicien : Tau, Het, Bet, ...
En froid avec son père qui a toujours préféré Aaron, le frère prodige, Adam trouve rapidement dans l'Affinité Tau à laquelle il est rattaché une nouvelle famille où la bienveillance et la protection lui apportent un cadre stable et rassurant. Cependant, le modèle n'est pas parfait et s'emballe rapidement. Les Affinités deviennent de plus en plus influentes sur le monde et des tensions naissent rapidement entre elles. De plus, l'appartenance à une Affinité suscite jalousie et convoitise chez les laissés-pour-compte pour qui les tests de personnalité n'ont pas été concluants.
Adam se retrouve au cœur d'une lutte sans merci où ses deux familles, celle de Tau, et celle qui lui a donné naissance, ne partagent ni les mêmes intérêts ni la même vision de l'avenir.
L'auteur canadien Robert Charles Wilson s'inspire cette fois-ci des réseaux sociaux et des algorithmes d'analyse de nos comportements sur Internet. On pense bien sûr aux nombreux amis sur Twitter ou Facebook ainsi qu'à la récolte de nos usages et l'analyse de nos clics par le géant Google. Mais au-delà d'une simple dénonciation des GAFA, l'auteur imagine un système plus puissant qui prend pied dans la vraie vie sociale, économique et politique. Son personnage est ainsi balloté entre l'utopie naissante d'une société meilleure et les dérives inévitables qui adviennent au fil du temps.
À mes yeux, Wilson est un auteur au ton assez pessimiste qui décrit le monde actuel ou à venir avec une certaine inquiétude. Il dépeint de grands bouleversements anxiogènes face auxquels les individus sont toujours dépassés : l'isolement de la Terre dans Spin ou un monde en proie au chaos d'une troisième guerre mondiale dans Les Affinités.
Le sujet traité dans ce roman est intéressant et les questions laissées en suspens enrichissent le charme mystérieux de l'histoire. J'aurais bien aimé quand même mieux comprendre la montée en puissance des Affinités ainsi que leur rôle dans la société. En outre, je tiens à mentionner que la traduction en français n'est pas toujours très élégante. Dommage pour un éditeur qui a pourtant créé une très belle couverture !
[Critique publiée le 19/04/19]

L A T R I L O G I E D E B É T O N
James Graham Ballard - 1973 / 1975
Denoël - 558 pages
10/20
Trois romans d'anticipation sociale
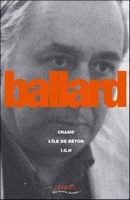 Ce recueil est constitué de trois romans écrits par l'anglais James Graham Ballard dans les années 70.
Ce recueil est constitué de trois romans écrits par l'anglais James Graham Ballard dans les années 70.
La thématique générale abordée dans La trilogie de béton est la déshumanisation de la société par notre civilisation urbaine et sans âme qui ne cesse de broyer l'individu par cette propension à tout bétonner et rationaliser.
Crash !, écrit en 1973, est le premier récit. Il décrit les relations très ambigües entre le narrateur, dénommé Ballard, et Vaughan qui est une sorte de pervers fasciné par les relations entre les accidents de voiture, les blessures qu'ils peuvent occasionner et le sexe. Entouré de quelques autres personnages, Ballard et Vaughan sacralisent les collisions entre véhicules en leur donnant une dimension sexuelle très forte.
Considéré comme culte par toute une génération, Crash ! a été adapté au cinéma par David Cronenberg en 1996. Je n'ai pour ma part absolument pas accroché à ce délire littéraire laborieux qui décrit à chaque page des tôles froisseés et des coïts. Ce ne sont pas les déviances sexuelles relatées qui m'ont dérangé mais cette trame romanesque longue, ennuyeuse, déroutante et sans finalité. Ce mariage incessant entre les séquelles provoquées par les accidents de la route et les comportements sexuels imaginés par Vaughan et le narrateur laisse interrogateur et dubitatif sur le message transmis au lecteur.
Pour cette première plongée dans l'œuvre réputée de Ballard, l'ennui m'a littéralement envahi...
Le second opus, quant à lui, est davantage captivant. Il relate l'histoire extraordinaire de Maitland, jeune cadre dynamique, qui est victime d'un accident sur une autoroute de la banlieue de Londres.
Sa voiture plonge dans une sorte de no man's land à la croisée de plusieurs voies rapides surélevées et de leurs échangeurs. Au sein de cette complexe infrastructure routière se niche une zone oubliée de tout le monde en forme de triangle.
Maitland, blessé, arpente cette île entourée de bitume et de voitures filant à toute allure du matin au soir. Sous ses airs de décharge à ciel ouvert, cet espace soi-disant abandonné va lui réserver quelques surprises...
Derrière une histoire originale, mais à la facture classique et un peu datée au niveau du style, se cache en réalité un message toujours d'actualité. Ainsi, Ballard dénonce cette modernité qui, sous prétexte de mieux les faire communiquer, isole encore davantage les êtres humains. Le lecteur peut facilement extrapoler le discours de L'île de béton et remplacer les réseaux routiers par les réseaux sociaux nés dans les années 2000 : aujourd'hui, l'homme moderne peut avoir des centaines d'amis du jour au lendemain mais, paradoxalement, la solitude et la souffrance engendrée touchent de plus en plus de personnes aussi bien jeunes qu'âgées...
Maitland aussi est au cœur du modernisme ; pourtant, plus personne ne fait attention à lui.
La trilogie se termine avec I.G.H (pour Immeuble de Grande Hauteur) qui décrit les relations humaines au sein d'une tour de quarante étages abritant deux mille personnes. Ballard observe à nouveau un microcosme fermé et montre comment un incident anodin peut conduire à une guérilla urbaine. Un grain de sable suffit pour enrayer la mécanique d'un modernisme arrogant et faire s'effondrer tout un modèle sociétal.
À noter que le thème de I.G.H est également abordé, sous un autre angle, dans l'excellent roman de Robert Silverberg intitulé Les monades urbaines.
Je reste globalement déçu par cette première incursion dans l'œuvre de Ballard. Le style a mal vieilli, la perversité est tellement omniprésente que le lecteur finit par être mal à l'aise ou simplement lassé. Le propos de fond reste cependant intéressant et toujours d'actualité. Voilà sans doute pourquoi l'homme suscite toujours autant d'intérêt aujourd'hui...
Enfin, je ne félicite pas les éditions Denoël qui ont pondu, pour un prix exorbitant, un recueil de mauvaise qualité : des fautes non corrigées dans L'île de béton, un papier jaunâtre du plus mauvais goût et enfin une conception graphique hideuse en première de couverture !
[Critique publiée le 13/01/15]

S O M M E I L D E S A N G
Serge Brussolo - 1982
Omnibus - 139 pages
15/20
Escale dans un monde inimaginable
 Dans les années 2000, l'homme construit des planètes artificielles en orbite autour de la Terre afin de fuir un monde devenu pollué, hostile et inhabitable à cause de l'activité humaine sans limite. Mais ces satellites se mettent à évoluer de façon autonome et deviennent par conséquent totalement incontrôlables. Des aberrations y surviennent qui font apparaître de nouvelles espèces monstrueuses et qui remodèlent entièrement la géographie originelle.
Dans les années 2000, l'homme construit des planètes artificielles en orbite autour de la Terre afin de fuir un monde devenu pollué, hostile et inhabitable à cause de l'activité humaine sans limite. Mais ces satellites se mettent à évoluer de façon autonome et deviennent par conséquent totalement incontrôlables. Des aberrations y surviennent qui font apparaître de nouvelles espèces monstrueuses et qui remodèlent entièrement la géographie originelle.
Le roman nous emmène sur l'un de ces mondes partis à la dérive. Le sol y est constitué d'un désert acide parsemé de montagnes vivantes. Ces dernières sont en réalité des « animaux-montagnes » : de gigantesques êtres vivants sommeillant pendant des millénaires et offrant leur corps aux habitants fuyant l'acidité des sols. Les animaux-montagnes ne se déplacent uniquement que lorsqu'ils agonisent afin de rejoindre leur sépulture.
Trois peuplades cohabitent dans ce monde inhospitalier : les carnivores, les autonomes et les végétariens.
Les premiers vivent de la viande et ont développé une véritable dynastie de « princes-bouchers ». Leur nourriture et leurs habits en sont constitués. Ils sont puissants et attaquent les animaux-montagnes en fin de vie afin de les dépecer entièrement et récolter leur peau. Ils cohabitent et exploitent les seconds, les autonomes, qui se nourrissent exclusivement de leurs propres cheveux et autres pilosités... Encore une aberration renversante dans ce décor de folie.
Quant aux végétariens, plus pacifiques, ils naviguent dans le désert à la recherche des montagnes pour s'y installer et y faire pousser leur nourriture lorsque des pillards ne les incommodent pas...
Le récit fait découvrir au lecteur ce lieu étrange et baroque que seul Serge Brussolo est capable d'imaginer tant il est riche, complexe et original. Quelques personnages clés, dont l'autonome An, sont au cœur de l'intrigue qui oscille entre univers abstrait et huis clos angoissant.
Sommeil de sang nous fait ainsi parvenir quelques bribes d'un univers fantasmagorique oscillant entre Mad Max, le Moyen Âge et la science-fiction de Mœbius. Le roman peut être lu sous un angle purement ludique mais aussi d'un point de vue ethnologique et social à travers les mœurs étranges des différentes castes qui vivent en symbiose ou dans une rivalité permanente.
En 1982, la problématique d'une planète bis est déjà posée ici. Ce livre est donc toujours d'actualité et mérite d'être lu jusqu'au dernier chapitre qui révèle l'envers du décor.
J'ai pu lire ou entendre à plusieurs reprises que Serge Brussolo écrivait des romans de gare. Au contraire ! Je vois ici une grande maîtrise de la langue française, une habileté syntaxique, une richesse du vocabulaire et une densité du propos. Il y a beaucoup de concepts à intégrer et la lecture requiert toute l'attention intellectuelle du lecteur !
[Critique publiée le 10/05/20]

L A N U I T D U B O M B A R D I E R
Serge Brussolo - 1989
Omnibus - 219 pages
16/20
Un récit totalement déjanté
 David Sarella, quatorze ans, est témoin du viol de sa mère qui est alors internée en asile psychiatrique.
David Sarella, quatorze ans, est témoin du viol de sa mère qui est alors internée en asile psychiatrique.
Pris en charge par sa grand-mère, il est rapidement envoyé en pension dans le collège de Triviana-sur-Mer dans les Landes. Cette ancienne station balnéaire à la mode au début du XXe siècle est devenue un lieu maudit depuis qu'un drame y est survenu quarante-deux années auparavant. En effet, à cette époque, un bombardier de la seconde guerre mondiale s'est écrasé sur le parc d'attractions causant de nombreux morts et blessés. Depuis, la ville abritant l'école n'est plus que l'ombre d'elle-même, remplie d'infirmes et de mutilés.
Dès son arrivée, David se heurte à l'indifférence méprisante des autres pensionnaires de l'établissement. Seul Moochie Flanagan, un asthmatique rejeté par tous, lui adresse la parole. Il lui explique ainsi que tous les étudiants sont répartis dans des clubs. Mais entrer dans l'un de ceux-ci n'est pas une tâche facile.
Les deux compères décident alors de fonder leur propre groupe, le Kit Scratch Club, consacré à la passion de Moochie : la construction de maquettes d'avions de la seconde guerre mondiale. Et l'histoire chaotique de Triviana-sur-Mer se prête particulièrement bien à ce thème...
David et son copain vont se mettre en quête d'en savoir davantage sur l'identité de l'avion destructeur. Ils vont alors rencontrer des personnages hallucinants, tous liés à leur façon à la catastrophe. Il y a Barney Coom, par exemple, qui reconstitue avec minutie depuis des années un diorama de quinze mètres carrés reconstituant la scène tragique ; ou encore Maxwell Portridge qui assemble et recoud des cadavres d'animaux épars pour en faire d'improbables créatures ; puis le ferrailleur Jonas Stroke, assimilé à un illuminé au tempérament violent, qui cherche désespérément des débris du bombardier.
Attention, car là, on atteint un sommet d'horreur baroque. Serge Brussolo entraîne le lecteur dans un récit complètement surréaliste.
L'histoire, parfaitement rationnelle à son début, monte crescendo vers un développement déjanté où le tragique en arrive parfois à devenir comique.
Bien sûr, on retrouve dans ce roman une référence autobiographique à l'auteur dont la mère a été réellement internée. D'ailleurs, l'homme est peu loquace sur son histoire personnelle et il y a fort à parier que ce grand écrivain populaire a vécu une jeunesse peu ordinaire. Car sinon, comment expliquer un tel délire dans chacune de ses productions ?
Pour conclure, j'émets tout de même un petit reproche sur le manque d'unité de la trame globale du récit. Le lecteur se retrouve un peu noyé par la profusion d'événements qui s'emballe jusqu'au dénouement final. L'œuvre a néanmoins le mérite de montrer tout le potentiel d'imagination que renferme un esprit comme celui de Serge Brussolo. Un potentiel hallucinant !
Voici un petit extrait d'une scène totalement hors norme qui se déroule dans un drugstore où David, le héros, est venu se restaurer : « La créature s'obstinait à manger ses frites avec le soin méticuleux d'un horloger réglant une montre. Pourquoi agissait-elle ainsi alors qu'elle n'avait nul besoin de cette nourriture ? Probablement parce que le corps qu'elle était en train de coloniser lui imposait encore sa loi, ses réflexes. David chercha un peu d'argent dans sa poche. Il devait décamper, Stroke avait raison, la maladie prenait de l'ampleur et il était déjà trop tard pour tenter quoi que ce soit. À cette seconde, l'homme au blouson jaune eut une contraction malhabile des mâchoires et se sectionna la langue !
David, horrifié, vit les dents d'acier se refermer sur l'appendice buccal rouge sombre... et le trancher sans aucun effort. Le tronçon de langue coupé net tomba dans l'assiette, au milieu des frites froides tandis que du sang poissait le menton de l'inconnu. L'adolescent étouffa un hoquet tandis que la créature continuait à manger, comme si rien ne s'était produit. Aucune nervosité n'altérait ses gestes, et il était visible qu'elle ne souffrait pas. Cette tranquillité hiératique était plus abominable encore que les manifestations de douleurs auxquelles on aurait été en droit de s'attendre. La fourchette poursuivait son va-et-vient mécanique. Elle finit même par piquer le morceau de langue sectionné et la ramena machinalement dans la bouche de l'homme aux yeux fixes.
"IL LE mange, constata David au comble de l'anéantissement, il est en train de manger sa propre langue !" »
[Critique publiée le 13/10/12]

M A V I E C H E Z L E S M O R T S
Serge Brussolo - 1996
Omnibus - 120 pages
17/20
Hymne à la tolérance
 David, douze ans, est un adolescent américain qui vit avec sa mère Joyce. Celle-ci, la trentaine, souhaite une vie plus stable pour son fils. Elle a en effet connu une période « baba cool » avec deux hommes, Kurt et Carlson, sur les plages de Californie. La débauche sexuelle maternelle de cette période a ainsi laissé le jeune David ignorant quant à l'identité réelle de son père parmi les deux amants...
David, douze ans, est un adolescent américain qui vit avec sa mère Joyce. Celle-ci, la trentaine, souhaite une vie plus stable pour son fils. Elle a en effet connu une période « baba cool » avec deux hommes, Kurt et Carlson, sur les plages de Californie. La débauche sexuelle maternelle de cette période a ainsi laissé le jeune David ignorant quant à l'identité réelle de son père parmi les deux amants...
Joyce et David décident de s'installer dans une réserve de morts où un poste d'intendante est vacant. En effet, un processus fantastique, mis au point quelques années auparavant, permet de réanimer les morts. Sur demande de la famille et en fonction de leur état, les revenants ont donc peu à peu investi les cités. Une commission est par ailleurs chargée de valider régulièrement leur apparence physique afin qu'elle reste agréable pour les vivants.
Finalement, seul leur comportement permet de les identifier vraiment. Ainsi, le mort ressuscité ne ressent pas la douleur, la faim, la soif, le manque de sommeil, la jalousie, la méchanceté, ... Il a désormais l'éternité devant lui et erre souvent un peu naïvement dans les rues, sur les routes, en arborant un sourire continuel.
De moins en moins acceptés par le commun des mortels, les revenants vont finir par subir des discriminations jusqu'à être parqués et isolés dans des prisons dorés.
David, en proie à la solitude, va lier une certaine amitié avec ces personnages dénués de toute agressivité. Il découvrira leur mode de vie et leur offrira également quelques services. Mais le gouvernement a bel et bien décidé de poursuivre le programme visant à éradiquer en totalité cette étrange population.
La référence aux grandes ségrégations de l'histoire est claire dans cette fable. En effet, comment ne pas penser à l'Apartheid ou à la Shoah lorsque les victimes sont poussées une à une dans des fosses ? Le revenant symbolise le persécuté. Totalement inoffensif, sa seule différence agace et dérange.
Serge Brussolo est peut-être l'auteur contemporain français le plus imaginatif. Écrivain prolifique depuis plusieurs décennies, il maîtrise parfaitement l'art de la fiction et sait exploiter des idées totalement déjantées et folles.
Boudé par certains critiques, éditeurs ou puristes, son nom figure rarement sur les listes des nominés aux prix littéraires. Il en a pourtant déjà eu (prix RTL-Lire en 1995, prix Paul Féval en 2004 décerné par la Société des Gens de Lettres) et tout un public loue son génie. Alors, Brussolo on le déteste ou on le vénère. Pour moi, c'est le deuxième verbe qui sied le mieux. Brussolo est un très grand auteur dont l'œuvre se situe bien loin des récits plats et narcissiques qui encombrent les étals des libraires à chaque rentrée littéraire.
Enfin, louons le professionnalisme des Editions Omnibus qui ont publié deux recueils consacrés à l'auteur. Cet éditeur propose de beaux objets agréablement manufacturés et fait depuis de nombreuses années un superbe travail d'anthologie littéraire. Merci à eux !
[Critique publiée le 12/02/12]

J ' A U R A I S P R É F É R É V I V R E
Thierry Cohen - 2007
France Loisirs - 238 pages
11/20
Un page turner qui s'achève de façon décevante
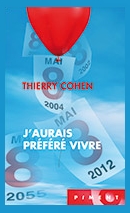 Nous sommes le 8 mai 2001. Jeremy, 20 ans précisément ce jour-là, met fin à ses jours. Victoria, son premier et intemporel amour, a décidé de faire sa vie avec un autre homme.
Nous sommes le 8 mai 2001. Jeremy, 20 ans précisément ce jour-là, met fin à ses jours. Victoria, son premier et intemporel amour, a décidé de faire sa vie avec un autre homme.
Un an plus tard exactement, Jeremy reprend conscience dans les bras de Victoria. Ils s'aiment et sont heureux. Mais le soir de ce merveilleux jour, le jeune homme sombre dans un état léthargique et perd pied avec la réalité...
Deux ans plus tard, c'est le même scénario : réveil dans une vie auprès de Victoria et d'un bébé avec à nouveau aucun souvenir des vingt-quatre mois écoulés. Et cela continue en 2010 et ainsi de suite. Une journée de conscience où Jeremy découvre le passé qu'il s'est construit suivie d'une chute dans le néant.
Au fil du récit, le lecteur va peu à peu s'apercevoir avec Jeremy du malheur que celui-ci fait vivre à ses proches : une Victoria de plus en plus délaissée, des enfants indifférents et des parents définitivement oubliés. Comment expliquer ce comportement bipolaire où un mauvais Jeremy fait de l'ombre à l'homme initialement prévenant et fidèle à son entourage ?
L'écriture est simple et parfaitement fluide. Le lecteur est dès la première page happé dans une spirale infernale aux côtés de Jeremy.
Chaque chapitre correspond donc à un nouveau réveil le 8 mai d'une année aléatoire ; et le narrateur doit à chaque fois affronter une nouvelle situation, totalement inédite, tel le héros fictif de la série américaine Code Quantum.
Ce roman est prometteur ; jusqu'à la dernière partie, qui passe à côté d'une fin totalement satisfaisante. Le dénouement sombre dans une explication mystique qui risque de déboussoler les plus cartésiens des lecteurs.
Certes, Thierry Cohen a mis en place une intrigue alambiquée dès le départ. Et celle-ci offre un défi à relever parsemé de nombreux écueils pour parvenir à une conclusion réussie. Mais à mon sens, l'auteur livre un épilogue lourd, convenu et sans audace.
Dans la veine de Guillaume Musso et Marc Levy - c'est la quatrième de couverture qui le précise -, il ne faut peut-être pas trop se torturer l'esprit et ne retenir que le bon potentiel de la principale partie du roman...
Et pour ceux qui souhaitent une excellente référence sur un thème similaire, lisez Replay de Ken Grimwood. Là, le voyage en vaut vraiment la peine.
[Critique publiée le 16/12/10]

L A R O U T E
Cormac McCarthy - 2006
Points - 252 pages
14/20
Pessimisme total
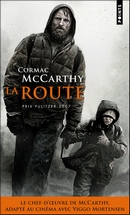 Les premières lignes nous plongent immédiatement dans un paysage froid, gris et mort.
Les premières lignes nous plongent immédiatement dans un paysage froid, gris et mort.
Deux hommes, un père et son jeune fils, marchent sur une route qui descend vers le sud des États-Unis.
Aucune indication sur la date à laquelle se déroule le récit ni de précision permettant de situer géographiquement les deux protagonistes. Seul compte cette route, lien ténu vers une latitude peut-être plus ensoleillée, ruban d'asphalte décharné en direction d'un hiver plus clément.
Cette quête de la côte méridionale est l'unique objectif à court terme de l'homme et l'enfant. À long terme, il vaut mieux ne pas se poser de questions. Car plus rien se subsiste de l'ancien monde, celui que nous, lecteurs, connaissons actuellement. Le soleil ne perce guère plus à travers les poussières et les cendres en suspension permanente dans l'atmosphère. Météorite, catastrophe nucléaire, bouleversements climatiques intenses et soudains ? Aucune réponse ne vient éclaircir cet univers sombre et glauque.
Le récit raconte ainsi le présent de ces deux individus qui ont renoué de force avec des besoins primaires : manger, se vêtir et s'abriter. Quelques lignes font néanmoins référence à un passé révolu et à la mère de l'enfant, celle-ci n'ayant sans doute pas survécu à la folie inhérente à ce monde sans espoir.
Traversant villes, villages, plaines, forêts, vallées, ils devront vivre en permanence à l'affût du moindre signe humain, guettant à chaque instant une nouvelle menace qui pourrait précipiter leur mort. Dans ce monde de désolation, chacun aura décidé de mener sa propre stratégie. Pour certains, le suicide aura été la solution la plus sûre, d'autres au contraire veulent vivre et forment des hordes de sauvages pratiquant communément le cannibalisme. Enfin, il y a ceux qui sont seuls, survivant au jour le jour et vivant cachés comme des rats...
Le père et le fils poussent un caddie contenant quelques denrées, principalement des boîtes de conserve glanées dans des demeures désertées, des couvertures pour affronter les nuits terriblement froides. L'homme ne continue cette lutte que pour son fils chez qui il entretient un optimisme quotidien. Le choyer, le protéger, le nourrir sont ses uniques préoccupations. Jusqu'au sud, jusqu'à la mer que le petit imagine bleue comme avant...
McCarthy, monument de la littérature américaine, livre là un roman d'une noirceur absolue. Aucune lueur d'espoir ne vient transpercer cette épopée macabre. D'ailleurs, que pourrait-il advenir de positif dans un monde où plus rien n'existe à part des ruines et quelques humains qui disparaissent les uns après les autres ? Ainsi, ceux qui s'évertuent à vivre justifient leur acte par le luxe de pouvoir choisir la mort quand ils le souhaiteront. Le rapport à la mort est totalement différent de celui de l'ancien monde et celle-ci est en partie vue comme une bouée de sauvetage, une délivrance potentielle à saisir à tout moment. Conserver ce « jeton » vers l'au-delà, décider du moment de sa propre fin est le dernier bien auquel ces rescapés peuvent encore prétendre.
La relation entre l'homme et son fils est finalement le seul rayon de soleil de ce récit. Un lien fort, absolu, infiniment rempli d'amour, qui est leur seule raison d'être. Mais l'auteur ne tombe pas dans l'émotion facile que pourrait susciter une situation aussi tragique. Pas de larmoiements pour ce couple qui avance l'un pour l'autre.
McCarthy adapte son écriture dépouillée aux paysages traversés. Pas de ponctuation dans les dialogues, la conjonction « et » omniprésente, pas de chapitrage ni de sous-titre mais de courts paragraphes qui se succèdent inlassablement au fil des kilomètres. Cette économie dans la forme littéraire contribue ainsi à renforcer cette sensation de vide instillée par ce fond lancinant.
En 2008, le réalisateur australien John Hillcoat a adapté l'œuvre au cinéma avec dans le rôle principal l'acteur Viggo Mortensen. Rarement une transposition à l'écran aura été aussi fidèle et réussie. Un film à voir absolument en complément de la lecture de La route.
Extrait : « L'air granuleux. Ce goût qu'il avait ne vous sortait jamais de la bouche. Ils restaient debout sans bouger sous la pluie comme des animaux de ferme. Puis ils repartaient, tenant la bâche au-dessus de leurs têtes dans le morne crachin. Ils avaient les pieds mouillés et transis et leurs chaussures partaient en morceaux. À flanc de collines d'anciennes cultures couchées et mortes. Sur les lignes de crête les arbres dépouillés noirs et austères sous la pluie. »
[Critique publiée le 24/03/10]

L E M O N D E T O U S D R O I T S R É S E R V É S
Claude Ecken - 2005
Le Bélial' - 362 pages
9/20
Trop cérébral
 Ce recueil rassemble douze nouvelles écrites par l'auteur français de science-fiction Claude Ecken.
Ce recueil rassemble douze nouvelles écrites par l'auteur français de science-fiction Claude Ecken.
Les thèmes abordés et les questions soulevées sont très contemporains et reflètent finement des grands sujets d'éthique auxquels l'humanité est ou sera confrontée dans un futur proche.
Le titre de l'ouvrage reprend celui du premier récit qui traite de l'impartialité de l'information dans un monde dominé par la course au sensationnel, la manipulation politique des médias et la cupidité des puissants.
Membres à part entière, la seconde histoire, inverse la logique dans laquelle nous vivons : les handicapés physiques ne sont plus une minorité mais une écrasante majorité. Les individus sans aucune tare sont relégués au bas de l'échelle sociale. Un jeu de miroir qui, outre l'intrigue originale, met en lumière la difficulté de vivre dans la différence...
L'unique brosse le portrait d'une société où le code génétique de l'homme est calibré et soigneusement sélectionné.
Deux nouvelles utilisent par ailleurs la science de la physique quantique, thème vertigineux qui ouvre les portes d'univers parallèles et l'accès aux trous noirs.
J'ai toujours eu quelques difficultés à lire des nouvelles. Ceci pour deux raisons qui sont liées entre elles.
La première est que le format induit, par définition, un nombre de pages relativement réduit. Et, à mes yeux, lire c'est s'immerger dans un monde différent du sien pendant un long moment, c'est passer des heures et des heures à rêver ce monde, c'est en sortir en y laissant un marque-page et y replonger avec délectation dès que possible. Dans ma conception de la lecture en tant que plaisir, la notion de zapping n'existe pas : aborder une œuvre écrite, c'est y consacrer du temps, c'est cultiver l'art de la lenteur, c'est attendre avec délice le moment où l'on va retrouver son compagnon de papier. Ainsi, dans cette perspective, je suis plus réceptif aux pavés de quelques centaines de pages.
La seconde raison est que le format court nécessite généralement une entrée rapide en matière. Et dans le cadre des sujets complexes abordés par Claude Ecken, cet exercice est souvent difficile. Le lecteur est plongé rapidement dans un univers où ses nouveaux repères ne sont pas encore en place et où, pourtant, l'intrigue est amorcée. Dès lors, la lecture de certaines nouvelles présentées ici peut devenir fastidieuse et cérébrale.
Sans doute que les amateurs de « hard-science » accrocheront davantage aux sauts quantiques récurrents qui animent certains personnages. Pour ma part, hormis deux ou trois textes, la lecture est restée un peu indigeste. Dommage !
[Critique publiée le 24/03/10]

L E M O N D E E N F I N
Jean-Pierre Andrevon - 2006
Fleuve Noir - 483 pages
17/20
La disparition de l'homme...
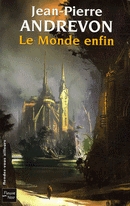 Déjà le titre mérite de s'y arrêter quelques instants : Le monde enfin.
Déjà le titre mérite de s'y arrêter quelques instants : Le monde enfin.
Le terme le plus emblématique est ici « enfin ». Il sous-entend le soulagement, c'est-à-dire un mieux-être qui apparaît. Finalement, ce titre renvoie à première vue une image plutôt positive du monde.
Si ce n'est qu'il est également accompagné de la mention Récits d'une fin de monde annoncée. Et là, le ton change ; en tout cas pour nous, êtres humains. Car il s'agit bien ici d'une fin du monde vue par l'homme, ce mammifère qui peuple la Terre depuis environ quatre millions d'années.
Et le titre cynique choisi en dit long sur l'état d'esprit de Jean-Pierre Andrevon. Car finalement, cet homme qui s'est depuis longtemps approprié la planète ne constituerait pas une immense perte s'il parvenait à disparaître. La Terre continuerait de tourner, la vie animale, végétale et minérale foisonnerait à travers des cycles plus réguliers. ENFIN, le parasite suprême, le bourreau d'innombrables espèces disparues, serait éliminé et la nature reprendrait ses droits.
La préface confirme cette utopie présentée comme « vieux fantasme » par l'auteur en dédiant l'ouvrage à des figures dont on connaît le fort engagement écologique. Sont ainsi cités René Dumont, Théodore Monod, Albert Jacquart, le WWF et la ligue ROC entre autres.
Bien sûr, cette position peut paraître extrémiste aux yeux de certains et on peut vite faire le rapprochement avec un courant intégriste de l'écologie qui prône volontiers une solution radicale pour l'avenir de l'espèce humaine. Mais Jean-Pierre Andrevon part d'une hypothèse qui le dédouane de toute agressivité directe envers l'homme (il croit même en lui, la fin le prouvera). Là où Robert Merle rejetait la faute sur les activités humaines et une guerre nucléaire fatale (lire Malevil), l'écrivain grenoblois base son synopsis sur un ennemi invisible : un virus. Une entité microscopique difficilement contrôlable par l'homme et qui va provoquer un fléau pourtant bien réel : la quasi-extinction de celui-ci. L'auteur se place ainsi en observateur et décrit ce qu'il voit alors...
L'histoire commence par le réveil de Paul Sorvino, un militaire américain qui a été sélectionné pour se faire enterrer dans un bunker appelé « unité autonome de survie prolongée » avec vingt-trois autres compagnons. Ces constructions, au nombre de cinquante sur le territoire américain, avaient été prévues en cas de conflit nucléaire avec les russes. Face à l'apparition d'un nouveau virus, nommé PISCRA, le programme de survie est activé et Sorvino est mis en sommeil profond en vue d'un réveil ultérieur.
Techniquement, le roman est découpé en différents « livres » qui présentent les péripéties de personnes qui n'ont à priori aucun rapport, mais dont les destins vont se trouver liés.
Chaque histoire permet de progresser dans la chronologie de la catastrophe, depuis l'apparition de la pandémie jusqu'à l'incroyable défi qui reposera sur les épaules d'une poignée de survivants. Parallèlement à cela, un fil conducteur transverse nous contera, à travers de courts chapitres en aparté, l'errance d'un cavalier survivant en route pour le sud de la France.
Parmi tous ces destins, il y a celui de Laurence, une petite fille qui perd ses parents, victimes du virus fatal et qui a sans doute développé un processus immunologique. Elle rencontrera Sébastien Ledreu, paléontologue du CNRS, qui deviendra une sorte de grand frère avant qu'ils ne se perdent mystérieusement de vue au cœur de l'Afrique.
Sébastien qui, plus tard, deviendra le dernier homme dans Paris et montera son cheval pour ce fameux sud tant espéré. Son quotidien ne sera plus alors qu'une succession de villes rattrapées par une nature exubérante où animaux exotiques ont élu domicile en toute liberté. Dans ce décor paradisiaque restera encore longtemps gravée la trace de l'homme : constructions urbaines immuables, squelettes figés dans des positions témoignant de l'effet fulgurant du PISCRA, nourritures non périssables en quantité importante, réseaux de routes sillonnant le territoire tels de longues saignées de bitumes, ...
La question de la survie de l'espèce humaine titillera les rescapés. Ainsi sera le but ultime d'Anne, une femme d'âge déjà mûr, qui n'aura de cesse de chercher un homme dans les villes désertes afin d'assurer sa descendance. Du côté d'Aix-en-Provence, devenu une copie d'Angkor, elle rencontrera furtivement Pierre.
Plus tard, enfermée dans un centre commercial Leclerc, véritable trésor en termes de denrées et lieu sûr, elle mettra au monde sa « petite princesse ». Et là, Andrevon nous contera la vie étrange d'un enfant né après l'apparition du virus mortel.
L'un des chapitres, le plus long d'ailleurs, est particulièrement captivant. Il nous raconte le destin extraordinaire d'une équipe d'astronautes à bord de la sonde spatiale ALPHA2 à destination d'un autre système solaire au moment de la catastrophe. Endormis en vue de leur long voyage, le pilote Isaac Sisséko et ses compagnons vont se réveiller et se rendre compte qu'ils n'ont pas encore quitté la proximité immédiate de la Terre. Hagards mais déterminés, ils décideront de rejoindre leur planète d'origine.
Installés dans un duplex à Montmartre, ils exploreront Paris, véritable nid de rats, à la recherche d'une explication sur cette disparition soudaine de leurs concitoyens.
Combien de survivants existent encore sur notre bonne vieille planète ? Un sur mille, un sur deux mille ? Que deviendra cette petite fille née après l'extinction ? Les astronautes réussiront-ils à s'adapter à ce nouvel environnement devenu hostile pour l'homme ? Le seuil de reproduction humaine sera-t-il atteint ? Comment réagira Paul Sorvino en sortant de son bunker de survie ?
Autant de questions qui seront soulevées et dont les réponses apparaîtront en filigrane vers la fin du roman.
Jean-Pierre Andrevon dresse là un scénario catastrophe, certes, mais bien plausible.
Régulièrement, de nouvelles menaces épidémiques reviennent au-devant de la scène et - coïncidence de mauvais goût ? - celle de la grippe A H1N1 est apparue lorsque je terminai Le monde enfin.
La première vague est partie du Mexique et aussitôt un plan d'envergure internationale pour la protection des voyageurs a été mis en place par l'OMS. Au 20 mai 2009, plus de dix mille personnes ont été contaminées dont quatre-vingt qui sont décédées dans une quarantaine de pays au total. Personne n'est épargné et des mesures sanitaires drastiques pourraient devenir inévitables si une seconde vague de contamination, plus agressive, prenait racine.
L'un des gros points d'interrogation dans l'évolution d'une pandémie est la faculté du virus à muter. Dans le cas de la grippe A H1N1, une recombinaison du matériel génétique avec celui de la grippe aviaire (virus H5N1) constituerait le scénario catastrophe que redoutent beaucoup. La grippe espagnole qui a tué entre vingt et cinquante millions de personnes en 1918, la grippe aviaire ou le Sras plus récemment témoignent de l'existence d'une menace qui pèse en permanence au-dessus de nos têtes, une sorte d'épée de Damoclès qui nourrit les peurs collectives de la même sorte que les risques d'explosion nucléaire...
Au final, un bon roman fleuve qui a l'allure d'un pavé par son épaisseur et la densité de ses pages. Et puis, bien sûr, il y a le plaisir de lire de la science-fiction française avec une intrigue qui se déroule majoritairement à Paris et en province. On s'est tellement habitué aux auteurs américains ou anglais dans ce domaine littéraire que les noms propres en français ont presque du mal à être crédibles dans nos têtes, le comble !
Andrevon est considéré comme le fils spirituel de René Barjavel, monument de la science-fiction en Europe ; et en effet, la référence à « l'arche » pour décrire cet abri anti-atomique où sont mis en sommeil une poignée d'êtres humains est à mes yeux un clin d'œil à l'auteur du titre Une rose au paradis. Cependant, on ne retrouve pas ici cette même écriture pleine de poésie qui fait que chaque texte de Barjavel est un véritable trésor au niveau de la forme.
La fin du livre est peut-être un peu précipitée et l'on aimerait en savoir davantage sur cette lueur bleue. L'homme n'est-il qu'un minuscule rouage dans une gigantesque machinerie cosmique ? Question métaphysique qui restera toujours sans réponse... Toujours est-il que la fiction déroulée ici démontre avec force la fragilité de notre espèce.
Et pour extrait, cette célèbre citation écrite au XIXe siècle par les Amérindiens et reprise dans le livre : « Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc ? Partout où il la touche, il laisse une plaie... »
[Critique publiée le 18/06/09]

C O N T A C T
Carl Sagan - 1985
Pocket - 568 pages
15/20
Et si...
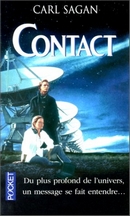 Ellie Arroway est astronome et responsable du programme SETI (recherche d'intelligence extraterrestre). Elle et son équipe passent ainsi des heures à scruter le ciel à l'aide de puissants radiotélescopes tournés vers les étoiles.
Ellie Arroway est astronome et responsable du programme SETI (recherche d'intelligence extraterrestre). Elle et son équipe passent ainsi des heures à scruter le ciel à l'aide de puissants radiotélescopes tournés vers les étoiles.
Et l'incroyable se produit. Un signal qui n'a rien de naturel est capté. Des tonnes d'informations en provenance de l'étoile Véga, située à vingt-cinq années-lumière de nous, sont déversées sur Terre. Tous les pays mettent en commun leurs infrastructures de télécommunications pour se relayer et capter le « message » dans son intégralité. Les plus grands spécialistes du décryptage sont consultés afin de décoder le contenu reçu.
De nombreuses voix s'élèvent en faveur ou contre la poursuite de la compréhension du message inconnu. De vieilles peurs se réveillent, de nouvelles religions voient le jour, la fin du monde est annoncée par des prédicateurs peu scrupuleux, la sécurité nationale des grandes puissances mondiales est directement menacée. Mais, à côté de cela, de nouveaux espoirs apparaissent aussi : une humanité enfin réconciliée avec elle-même qui, malgré sa mosaïque de peuples, se découvre du jour au lendemain une identité qui lui est propre ; et se lance avec une nouvelle fraternité mondiale dans un défi extraordinaire venu du plus profond de l'univers.
Carl Sagan était professeur et directeur de laboratoire à l'Université Cornell aux États-Unis. C'est lui qui est à l'origine du programme SETI et des plaques présentant la Terre et l'homme apposées sur les sondes Pioneer. Il est l'un des fondateurs de l'exobiologie, cette science récente qui s'intéresse à la possible vie au-delà de notre planète.
Grand vulgarisateur des sciences de l'astronomie, Sagan a finalement écrit là l'histoire qu'il aurait aimé voir se dérouler de son vivant.
Comme dans beaucoup de romans de ce type (Le moineau de Dieu en est un autre exemple), de nombreuses considérations théologiques sont abordées et parfois trop détaillées rendant certains passages un peu obscurs. Finalement, on se demande si, au cas où cela arrivait, ce ne sont pas les religions qui seraient le plus profondément bouleversées. Pour ma part et en tant qu'athée cartésien, j'ai un peu de mal à croire ce discours car beaucoup d'autres domaines philosophiques seraient remis en cause et cela en dehors de toutes considérations religieuses...
À noter que cette fabuleuse histoire a été adaptée au cinéma par Robert Zemeckis en 1997 avec dans le rôle principal l'excellente Jodie Foster.
[Critique publiée le 15/11/08]

L A N E F D E S F O U S
Richard Paul Russo - 2006
Le Bélial' - 417 pages
18/20
Rencontre avec une autre civilisation...
 Voici un livre très agréable à lire. Ceux qui aiment la science-fiction classique, plausible et bien argumentée seront ravis.
Voici un livre très agréable à lire. Ceux qui aiment la science-fiction classique, plausible et bien argumentée seront ravis.
Dans un lointain futur, notre planète n'est plus viable mais les humains ont depuis longtemps colonisé l'univers. Une de ces colonies vit à l'intérieur d'un immense vaisseau baptisé l'Argonos. Une véritable société s'y est formée (avec des castes de riches, de religieux et de soutiers).
Bartolomeo Aguilera est un être difforme car handicapé, mais il est appareillé par un système sophistiqué lui permettant de se mouvoir aisément. Malgré sa condition sociale modeste, il est un ami d'enfance du commandant du vaisseau : Nikos.
D'autres personnages jouent également un rôle important dans la trame de l'histoire : l'évêque Soldano, véritable tyran qui veut prôner la religion catholique dans tout l'univers et aimerait prendre les commandes du vaisseau, le père Veronica, confidente de Bartolomeo, Pär, un nain également fidèle ami du narrateur, ...
Bref, tout ce microcosme va soudain découvrir un vaisseau issu d'une autre technologie, visiblement abandonné.
Commencera alors une expédition passionnante à la découverte de la plus extraordinaire rencontre entre l'humanité et une autre civilisation. Petit à petit, l'équipe découvrira un monde totalement nouveau et progressera sous la direction de Bartolomeo (on pense bien sûr au chef-d'œuvre Rendez-vous avec Rama). Au bout de plusieurs heures d'exploration, une surprise de taille fera son apparition faisant basculer le récit dans une ambiance plus glaciale et intrigante.
La dernière partie du livre est, quant à elle, terriblement prenante. Le suspense y est à son comble et nous mène crescendo jusqu'au final !
L'auteur décrit avec rigueur son univers et nous fait progresser tout doucement dans les tourments de l'Argonos. Il aborde également la problématique de la croyance dans la religion catholique en opposant les idées de Bartolomeo et du père Veronica.
Le lecteur y découvrira un point de vue très intéressant concernant le pouvoir de libre arbitre offert aux hommes par Dieu.
L'histoire peint également avec précision les luttes de pouvoir au sein d'une société fermée et cloisonnée.
C'est au final un excellent roman, soigné à tout point de vue et surtout capable de bluffer l'imaginaire des plus cartésiens d'entre nous.

L A B R È C H E
Christophe Lambert - 2005
Fleuve Noir - 210 pages
14/20
Pour les amateurs d'uchronie
 Comment résister à une si belle couverture !? Le talent de Manchu (illustre dessinateur de mondes imaginaires) aura forcément participé au succès du livre. Outre le réalisme du dessin, la scène exposée interpelle : une plage de Normandie, un blockhaus, un officier allemand et... Un robot armé semblant tout droit sorti d'un futur éloigné.
Comment résister à une si belle couverture !? Le talent de Manchu (illustre dessinateur de mondes imaginaires) aura forcément participé au succès du livre. Outre le réalisme du dessin, la scène exposée interpelle : une plage de Normandie, un blockhaus, un officier allemand et... Un robot armé semblant tout droit sorti d'un futur éloigné.
C'est au difficile exercice de l'uchronie (on prend une date de l'histoire et on imagine ce qu'il se serait passé si tel événement ne s'était pas déroulé comme en réalité) que se livre le jeune auteur français Christophe Lambert (à ne pas confondre avec son homonyme du cinéma). Une uchronie qui prend pour explication un voyage dans le temps, thème ô combien passionnant. Mais thème très prise de tête aussi !
Le présent de l'histoire se déroule en 2060 et le voyage dans le temps est maîtrisé par les militaires. La télé-réalité est de plus en plus perverse et le nouveau show consiste à remonter le temps pour filmer des événements trashs du passé (la mort de Kennedy par exemple).
La loi de l'audimat régnant sur l'éthique, c'est le débarquement de Normandie que se propose de suivre l'équipe de l'émission. Bien sûr, les voyageurs du temps doivent respecter un système de règles ayant pour but de ne pas modifier le cours des événements. On devine aisément que ces règles vont être involontairement transgressées.
Un historien et un reporter de guerre acceptent la mission et sont débarqués le 6 juin 44 sur les côtes normandes. Dès lors, ils vont sombrer dans un enfer et ouvrir une « brèche » laissant cœxister deux futurs possibles. Ils devront réparer leur erreur et faire triompher le futur (pour eux présent) tel qu'il a eu lieu.
Ce livre présente trois intérêts notables : 1/ faire revivre le débarquement et l'auteur s'est apparemment beaucoup documenté pour cela. 2/ écrire une histoire de science-fiction et présenter une nouvelle vision du voyage dans le temps, on connaît à quel point c'est un défi car les paradoxes y sont toujours nombreux. 3/ dénoncer les dérives de la télé-réalité qui est devenue omniprésente aux États-Unis et qui défraye aussi régulièrement la chronique en Europe.
Au final, on obtient un bon bouquin duquel il est difficile de lâcher prise. La fin, quant à elle, pose de nouvelles questions sur la possibilité du voyage dans le temps. Seul bémol peut-être, on aurait aimé plus de densité dans le caractère des personnages, leurs relations, ...
Remarque : ce livre ressemble étrangement au roman Les jeux de l'esprit (Pierre Boulle, 1975). Coïncidence ou plagiat ??

R E P L A Y
Ken Grimwood - 1988
Points - 360 pages
19/20
Un bouquin génial !
 Jeff Winston meurt un beau jour d'une crise cardiaque mais se réveille aussitôt vingt-cinq ans auparavant. Il est étudiant, dans sa chambre universitaire, à côté de son camarade de classe mort depuis longtemps dans sa « précédente » vie ! Difficile à admettre comme tour de magie, mais facile de s'apercevoir la multitude d'idées que cela peut engendrer...
Jeff Winston meurt un beau jour d'une crise cardiaque mais se réveille aussitôt vingt-cinq ans auparavant. Il est étudiant, dans sa chambre universitaire, à côté de son camarade de classe mort depuis longtemps dans sa « précédente » vie ! Difficile à admettre comme tour de magie, mais facile de s'apercevoir la multitude d'idées que cela peut engendrer...
Recommencer sa vie en ayant la mémoire du futur ! Connaître les résultats des derbys, savoir que Kennedy va être assassiné et à quelle heure précise, cela a de quoi vite faire tourner la tête. Et quand ce phénomène extraordinaire recommence plusieurs fois de suite, on peut tout essayer dans la vie et expérimenter tous les fantasmes du commun des mortels !!
Ce livre se lit d'une traite et l'idée de départ est très bien exploitée. Il possède également une dimension métaphysique et spirituelle en tentant de donner un sens à notre vie, au temps présent, passé et futur.
Avec une aventure qui paraît être une chance pour le héros, l'auteur nous rassure en fin de livre et nous démontre encore une fois que le bonheur se conjugue toujours au présent...

M A L E V I L
Robert Merle - 1972
Gallimard - 634 pages
18/20
Le nucléaire : la folie de l'homme
 Tout commence très simplement. Un petit village en France, quelque part dans le sud. Et puis soudain, plus rien. Sauf l'odeur de la mort. Une température qui devient très forte pendant de longs instants, personne ne saurait d'ailleurs dire exactement ce que signifie le mot « instant » dans ces conditions-là.
Tout commence très simplement. Un petit village en France, quelque part dans le sud. Et puis soudain, plus rien. Sauf l'odeur de la mort. Une température qui devient très forte pendant de longs instants, personne ne saurait d'ailleurs dire exactement ce que signifie le mot « instant » dans ces conditions-là.
Dans un château, à Malevil, Emmanuel Comte et ses amis en pleine discussion politique au moment du drame ont survécu. Mais lorsqu'ils rallument la radio, ils se rendent compte du vide des ondes, un vide glaçant. Ils vont rapidement comprendre : la menace atomique est devenue réalité, un fou a fait tomber le premier domino de la dissuasion nucléaire.
Emmanuel et ses amis vont apprendre à reconstruire une société où les repères d'Avant ont disparu. Retour à la case départ du Moyen Âge. Retour aux famines, aux maladies et à la guerre.
Ce livre retrace avec détail et émotion le microcosme qui se développe dans une enceinte fortifiée. Avec de nouvelles règles militaires et sociales telles que la mise en place de sentinelles pour veiller jour et nuit sur d'éventuels brigands, la fin de la monogamie (les femmes étant minoritaires par rapport aux hommes), la richesse de la nature et des animaux, Robert Merle nous montre à quel point notre avenir et même notre présent sont en permanence menacés par une épée de Damoclès et nous apprend que l'humilité et le partage sont des valeurs toujours triomphantes.

S O L E I L V E R T
Harry Harrison - 1966
Pocket - 191 pages
13/20
Un écologiste avant l'heure
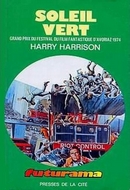 Ce livre, écrit dans les années 60, est plus que d'actualité aujourd'hui en 2004. L'auteur Harry Harrisson prend pour cadre New York en 1999 et imagine plus de trente ans avant ce qu'il pourrait s'y passer. Et à part une petite erreur au niveau de la date, on peut dire qu'il a vu juste. La situation de désastre décrite dans ce livre est exactement celle prédite par nos plus grands scientifiques pour la fin de ce siècle au plus tard !!!
Ce livre, écrit dans les années 60, est plus que d'actualité aujourd'hui en 2004. L'auteur Harry Harrisson prend pour cadre New York en 1999 et imagine plus de trente ans avant ce qu'il pourrait s'y passer. Et à part une petite erreur au niveau de la date, on peut dire qu'il a vu juste. La situation de désastre décrite dans ce livre est exactement celle prédite par nos plus grands scientifiques pour la fin de ce siècle au plus tard !!!
Mers polluées, ressources épuisées, surpopulation, voilà le contexte dans lequel évolue le personnage principal. Andy est policier et il est chargé d'élucider le meurtre d'un gros bonnet de la ville. Vivant avec son ami Sol, vieux personnage qui a connu les vertes prairies et la cuisine d'antan, Andy rencontrera l'amour sous les traits d'une magnifique fille prénommée Shirl.
L'intérêt de ce livre ne réside pas dans l'histoire policière, somme toute banale et sans grand rebondissement, mais bien dans la description du New York futur : ces gens qui se battent pour obtenir leur ration d'eau chaque jour, ces sans-abris entassés à même la rue auxquels les nantis ne font même plus attention et qui sont piétinés sans état d'âme, ces images du passé qui sont autant de trésors perdus, cette nourriture fade et uniforme faite à base de plancton marin... D'ailleurs, l'auteur lance un cri d'alarme dès les premières pages et établit un bilan de la situation à venir.
Quand l'anticipation rejoint la réalité... Visiblement, l'homme n'a pas modifié son comportement depuis et à au contraire augmenté sa consommation des ressources de la planète. À l'heure où l'on parle de plus en plus de la prochaine pénurie du pétrole, un changement de cap est-il encore imaginable ? Prions pour que la réponse soit oui et tout de suite.
Remarque : ce livre a été porté au cinéma en 1973 par le réalisateur Richard Fleischer avec pour acteur principal Charlton Heston. Fait rare, le film est bien meilleur que le livre car l'intrigue est grandement enrichie et un suspense latent mène le spectateur jusqu'à la fin pour découvrir un secret terrible.

D E S F L E U R S P O U R A L G E R N O N
Daniel Keyes - 1959
J'ai Lu - 311 pages
16/20
Une leçon de tolérance
 Charlie Gordon est un attardé mental, employé dans une boulangerie à faire le sale travail.
Charlie Gordon est un attardé mental, employé dans une boulangerie à faire le sale travail.
Deux scientifiques ont mis au point un traitement pour développer l'intelligence chez les sujets en retard. L'expérience sur la souris de laboratoire, Algernon, est un succès. Ils décident de la tester sur un être humain : Charlie.
Petit à petit puis de plus en plus rapidement, les capacités intellectuelles de Charlie vont s'accroître jusqu'à aller bien au-dessus de la moyenne. Surdoué, Charlie va découvrir la soif d'apprendre et se consacrer à améliorer les recherches le concernant. Il apprendra également le piano, de nombreuses langues. Sa découverte des femmes et du sentiment amoureux fera également partie de sa nouvelle « naissance ».
Malheureusement, Algernon va commencer à régresser puis dépérir jusqu'à la mort. Se sachant condamné, Charlie va entamer une longue descente en enfer, conscient d'avoir vécu une expérience unique.
Ce livre d'anticipation offre une vision de tolérance à l'égard des personnes handicapées mentales. Il pose également la question suivante : sommes-nous vraiment plus heureux qu'eux ?
Devenu un classique aujourd'hui, ce récit a obtenu le prix Hugo en 1960.

Dernière mise à jour :
[ - Site internet personnel de chroniques littéraires. Mise à jour régulière au gré des nouvelles lectures ]

Copyright MAKIBOOK - Toute reproduction interdite
contact [at] makibook.fr


